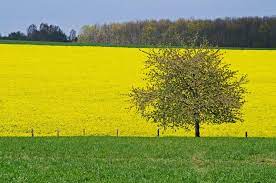Entretien avec Aexia Beaujeux, Cheffe de pôle Transition Agro-écologique au sein de l’association Terre et Cité
Suite de notre série sur les « Terres protégées du plateau de Saclay », à travers cet entretien avec Alexia Beaujeux, Cheffe de pôle Transition Agro-écologique au sein de l’association Terre et Cité, en charge notamment de la mise en œuvre de plusieurs projets du programme d’actions destiné y préserver la biodiversité.
- Pourriez-vous, pour commencer, rappeler en quoi consiste cette agro-écologie quand bien même en parle-t-on de plus en plus ?
Alexia Beaujeux : Sans prétendre vous en donner une définition digne du Larousse, je dirais que l’agro-écologie est une approche de l’activité agricole, qui vise à allier, à l’échelle d’une exploitation agricole, des ambitions productives – pour ne serait-ce que répondre aux besoins alimentaires de la population – et de préservation de l’environnement et de la biodiversité, l’enjeu étant aussi d’améliorer la qualité de la production. Concrètement, elle recouvre diverses pratiques qui vont de ce qu’on appelle les « infrastructures agro-écologiques » – des éléments permanents ou semi-permanents, installés au sein ou en bordures de parcelles comme, par exemple, les haies, dont Terre et Cité encourage la restauration ou la préservation -, les bandes enherbées, les bandes fleuries, qui vont permettre d’attirer certaines espèces végétales à proximité des cultures sans s’interdire d’en réintroduire d’autres, bénéfiques à la biodiversité. L’agro-écologie inclut également des pratiques qui ont trait à la conduite cultures, par exemple des de semis qui permettent de limiter le labours comme, par exemple, les semis sous couvert, consistant à semer directement une culture ou un couvert végétal l’un après l’autre de façon à ce que les sols ne restent jamais à nu et éviter ainsi le développement d’adventices.
- Merci pour cette riche « définition » qui fait bien comprendre combien cette agro-écologique, au-delà de ses visées productives, est une manière de faire de l’écologie à travers des pratiques agricoles préservant la biodiversité. Comment y êtes-vous venue ?
A.B.: Au risque de vous surprendre, je ne suis pas agronome. J’ai fait l’école urbaine de Sciences Po, il y a cinq ans, suite à quoi je suis partie dans la Vienne, où j’ai travaillé sur les questions de transition écologique en milieu rural. À force de m’investir dans les territoires ruraux, je me suis intéressée à l’agriculture, au point de reprendre des études en faisant un bac pro agricole en grandes cultures. C’est en prospectant sur le marché du travail que j’ai découvert Terre et Cité, une association qui m’a d’emblée intéressée, à ceci près que je n’étais pas très désireuse de revenir en Île-de-France. Finalement, j’ai été séduite par les enjeux du plateau de Saclay et ce que cette association y faisait. Il est vrai aussi que ce qui m’intéresse de plus en plus, c’est de travailler à faire collaborer des espaces ruraux et urbains. Or, beaucoup des projets portés par Terre et Cité, que ce soit dans le cadre du programme d’action ou d’autres dispositifs, vont dans ce sens-là. Je n’en ai pas vu d’équivalent au cours de mes prospections. L’intérêt de ce qu’il m’est permis d’y faire à l’emporté sur le reste – revenir en Île-de-France !
- En quoi cette agro-écologie vous paraît-elle adaptée au plateau de Saclay ?
A.B.: Elle est une réponse au contexte du plateau de Saclay, en voie d’urbanisation sous l’effet de l’Opération d’intérêt national (OIN) Paris-Saclay. Urbanisation qui se traduit par de nouvelles constructions (de bâtiments, d’équipements, d’infrastructures…). La biodiversité s’en trouve directement impactée, du fait de la disparition d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. Ce à quoi nous nous employons, avec les acteurs du territoire, est, donc, de recréer des continuités écologiques fonctionnelles, principalement entre les vallées de la Bièvre et de l’Yvette, lesquelles sont par définition des réservoirs de biodiversité : des lieux de vie et de reproduction propices à de nombreuses espèces d’animaux, d’insectes, de végétaux. Concrètement, nous aménageons des espaces de circulation.
- Dans quelle mesure la création de la ZPNAF a-t-elle été un levier de facilitation des actions menées par Terre et Cité en matière agro-écologique et de préservation de la biodiversité ?
A.B.: Le simple fait d’avoir protégé des terres agricoles contre les risques de grignotage a permis aux acteurs du territoire, à commencer par les agricoles, de se projeter dans l’avenir et d’investir dans leur exploitation ou des projets de diversification. Sans garantie de préservation de ces terres, Terre et Cité ne se serait pas même posé la question de l’intérêt de restaurer des haies dans les champs ! Le fait que la ZPNAF soit adossée à un texte législatif offre des gages quant à sa pérennité – si une loi peut toujours être détricotée, elle ne peut l’être du jour au lendemain.
- Ajoutons que la ZPNAF ne se borne pas à protéger des terres agricoles ; elle consiste aussi à animer les zones protégées à travers des programmes d’action…
A.B.: Le deuxième programme d’action, en cours, comporte plusieurs fiches qui concernent directement l’agro-écologie. Par exemple : la fiche B9, celle dont je m’occupe tout particulièrement, relative aux continuités écologiques du plateau que j’évoquais, et dans laquelle s’intègrent les projets de restauration de haies et de bandes fleuries. À quoi s’ajoutent, d’une part, la fiche B11 relative à la trame noire sur laquelle nous avons beaucoup avancé ces derniers mois – pour mémoire, elle vise à atténuer la pollution lumineuse -, d’autre part, la fiche A7 relative, elle, à la diversité des cultures et à la création de filières, à travers le PAT – Plan alimentaire territorial – en vue de créer de nouveaux débouchés pour les producteurs locaux et de les inciter à mettre place de cultures présentant un intérêt au regard de la biodiversité et de l’enrichissement des sols.
- On voit, à travers ces fiches, que la ZPNAF est bien plus qu’une zone sanctuarisée : un territoire de projet.
A.B.: En effet. Ajoutons que le programme d’action apporte la démonstration qu’à travers sa ZPNAF, le plateau de Saclay concourt aussi à nourrir la population locale, à travers le développement de circuits courts, comme d’ailleurs au plan national et même mondial, à travers le maintien d’une production dédiée à l’export. Au-delà de cela, il contribue à faire de la ZPNAF un cadre de vie de qualité. On n’insistera donc jamais assez sur l’importance de préserver la foncier d’autant que son sol est réputé pour être un des plus riches d’Europe. Il faudrait en revanche que l’EPA Paris-Saclay et l’État s’impliquent à une juste mesure dans la gouvernance et le financement du programme. Des moyens très importants ont été mis à disposition pour le cluster alors que le programme d’action ne dispose d’aucun financement propre. Pour financer nos projets liés à l’agro-écologie, nous devons répondre chaque année à des appels à prjets nationaux ou régionaux.
- À un titre plus personnel, en quoi le fait de promouvoir cette agro-écologie dans le cadre de cette ZPNAF, sans équivalent en France – vous motive ?
A.B.: Il est clair qu’évoluer dans ce contexte me conforte dans mon intérêt pour cette agro-écologie. J’ajouterai aussi l’intérêt du poids de l’histoire qu’on ressent ici. Rappelons que Terre et Cité a été créé en 2001, plus de dix ans avant la ZPNAF, de l’initiative d’agriculteurs, soucieux de maintenir des activités agricoles sur le plateau de Saclay. Depuis, l’association s’est développée en s’élargissant à d’autres acteurs du territoire, à travers une organisation en collèges. Tant et si bien que nous avons de bonnes relations de travail aussi bien avec les agriculteurs qu’avec les chercheurs, les associations, les élus. Nous pouvons aussi bien intervenir en appui d’initiatives qui émanent d’eux qu’être force de propositions comme cela a été le cas notamment sur les infrastructures agro-écologiques. Quant à la ZNPAF et à son animation, Terre et Cité s’est naturellement imposée comme une partie prenante, à travers les fiches que j’évoquais, mais aussi le travail de concertation effectué en amont des programmes d’action, au moment où il a fallu délimiter le périmètre de cette zone de protection, les parcelles concernées.
- Nous avons jusqu’ici parlé de ZNPAF. Désormais, il convient de parler de « Terres protégées du plateau de Saclay ». Que vous inspire ce nouveau nom ?
A.B.: Comme beaucoup, je m’étais habituée à la ZPNAF [rire], mais j’estime important d’avoir un nom plus accessible, plus évocateur qu’un acronyme, pas forcément simple à prononcer. On a a priori plus envie de se rendre à un événement organisé sur des terres protégées du plateau Saclay qu’à une ZPNAF ! Cela donne le sentiment de quelque chose de moins administratif ! Et puis ce changement de nom est allé de pair avec un nouveau logo. Grâce au soutien du programme LEADER, Terre et Cité a pu mettre en place un concours de graphistes et, personnellement, je trouve le résultat réussi et joli [rire].
- Un mot, pour finir, sur le cadre professionnel exceptionnel dans lequel vous travaillez ?
A.B.: [Rire]. C’est vrai ! Nos locaux sont dans un bâtiment de l’ensemble scolaire La Salle Igny : un établissement privé qui accueille des élèves de la maternelle jusqu’au BTS. Un ensemble de bâtiments en meulière, lambrissés à l’intérieur d’un bois sombre du plus bel effet. Le nôtre jouxte une chapelle magnifique. Le tout dans un écrin de verdure arborée.
- Vous travaillez ainsi au milieu d’enfants, de collégiens et de lycéens, dont Terre et Cité œuvre à l’avenir en contribuant notamment au futur des Terres protégées…
A.B.: Oui. Plusieurs d’entre eux participent aux chantiers de plantations et d’entretien des haies que nous organisons.
Journaliste
En savoir plus