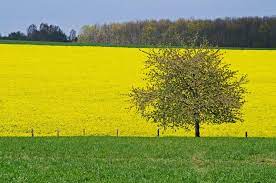Retour sur l’édition 2025 du VivAgriLab
Créé le 03/02/2025
Modifié le 03/02/2025
Entretien avec Sophie Pradié et Dorian Spaak, coordinateurs de Terre & Cité
Favoriser l’émergence et la mise en place des projets de recherche appliquée à des thématiques relatives à la transition agroécologique, avec l’ensemble des acteurs de territoires du sud ouest francilien. Telle est la vocation du VivAgriLab lancé en 2013. Le 16 décembre dernier, il tenait sa réunion annuelle, sur le Campus Agro Paris-Saclay. En voici un écho à travers cet entretien à deux voix avec Sophie Pradié et Dorian Spaak, coordinateurs de Terre & Cité, en charge de son animation.
- Si vous deviez pour commencer pitcher le VivAgriLab…
Sophie Pradié : Lancé en 2013, le VivAgriLab est un espace de dialogue destiné à rapprocher les laboratoires de recherche des acteurs du territoire du sud ouest francilien, publics aussi bien que privés – les collectivités, les services déconcentrés de l’État, les habitants, les entreprises, les agriculteurs,… -, pour favoriser l’émergence et la mise en place de projets de recherche appliquée à des thématiques relatives à la transition agroécologique. Terre & Cité en assure l’animation depuis 2016, en lien étroit avec C-Basc, le programme interdisciplinaire de l’Université Paris-Saclay sur la biodiversité, l’agroécologie, la société et le climat. À ce jour, pas moins d’une trentaine de projets ont vu le jour. La journée organisée le 16 janvier sur le Campus Agro Paris-Saclay correspond au rendez-vous que nous donnons chaque année, à la même période, mais dans un endroit différent, à nos partenaires pour faire un point autour d’une thématique – l’eau, cette année – à travers des conférences et tables rondes, le matin, des ateliers participatifs, l’après-midi.
Dorian Spaak : Le VivAgriLab se révèle être plus que jamais un outil pertinent au regard des grands enjeux écologiques auxquels nous faisons face. Nous savons qu’il nous faut trouver des cycles d’innovation beaucoup plus courts. Au vu de l’urgence de la situation, nous ne pouvons pas attendre seulement les résultats de programmes de recherche au long cours. Il nous faut parvenir à des boucles d’innovation plus courtes que celles que nous avons pu avoir par le passé. Et, donc, pouvoir essayer, tester de nouvelles choses et en évaluer aussi vite que possible les résultats. Dès que nous sentons qu’une piste mérite d’être explorée, nous mobilisons l’expertise des chercheurs pour nous assurer qu’elle n’est pas sans issue. Notre chance est la concentration des moyens de recherche sur le territoire.
- Comment les chercheurs appréhendent-ils cette approche appliquée/innovation de la recherche ?
Dorian Spaak : Les chercheurs ont eux-mêmes des attentes nouvelles : ils ont besoin de ressentir l’utilité de leurs travaux de recherche, qu’ils contribuent à changer nos modes de production et de consommation. Et justement, ces boucles d’innovation territoriale comme celles que nous encourageons permettent de procurer un sentiment d’utilité : les chercheurs agissent en direct avec des acteurs locaux ; ils voient les projets se mettre en place et les transformations qu’ils entraînent. Ils peuvent aussi voir les limites de certaines innovations et ajuster en conséquence les orientations de la recherche. En sens inverse, ces boucles d’innovation territoriale permettent aux chercheurs comme aux acteurs locaux de tester et d’avoir plus rapidement des retours d’expérience.
Un autre de leur intérêt est de faciliter la diffusion des innovations : les tests étant réalisés par les acteurs eux-mêmes, dès lors que les résultats se révèlent probants, leurs pairs s’en saisissent plus rapidement. C’est une chose d’avoir testé quelque chose en laboratoire, en recherche confinée, c’en est une autre de le faire en conditions réelles, de surcroît avec le concours d’acteurs du territoire. La réplication à plus grande échelle se fait plus rapidement. Nous avons pu le voir avec les expériences menées sur le recyclage des urines : une fois que les tests réalisés sur les parcelles agriculteurs se sont révélés positifs, le recyclage des urines a été perçu favorablement par d’autres agriculteurs.
Sophie Pradié : Cet effet boule de neige se vérifie sur bien d’autres sujets. Pour m’en tenir à l’exemple du recyclage des urines, ce qui frappe est la rapidité avec laquelle le projet s’est lancé. Rappelons que le sujet avait été abordé la première fois officiellement en 2016. La même année, des projets de recherche sur leur utilisation en agriculture étaient menés. Les résultats se sont révélés concluants. Aujourd’hui, nous en sommes à réfléchir à la création d’une filière dédiée et aux aménagements et investissements qu’elle impliquerait.
Autre illustration : les drainages dont il a été question lors d’une table ronde de la matinée. Les résultats de recherche produits par Julien Tournebize, chercheur à l’INRAe, ont permis en l’espace de quelques années de mettre en place un système de détection des réseaux de drainage, avec le concours de l’EPA Paris-Saclay.
Sur bien d’autres sujets, nous sommes ainsi entrés en phase d’applications concrètes, qui contribuent à soutenir le maintien et le développement de l’agriculture sur le plateau de Saclay.
- Un mot sur le périmètre de ce territoire que recouvre VivAgriLab…
Sophie Pradié : VivAgriLab, ce sont 70 communes, réparties entre la Plaine de Versailles, le plateau de Saclay, le Triangle Vert et les trois agglomérations de l’OIN Paris-Saclay – Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris-Saclay. C’est pour donner à voir la diversité de ce territoire, faire découvrir les moyens de recherche qui s’y trouvent que le VivAgriLab se retrouve chaque année dans un lieu différent. L’an dernier, nous étions à l’INRAe de Versailles. Cette année, nous avions donc donné rendez-vous sur le Campus Agro Paris-Saclay, dans le quartier de Moulon.
- Vu de l’extérieur, j’ai l’impression que le VivAgriLab, c’est aussi la possibilité pour les différentes parties prenantes de s’acculturer aux langues disciplinaires ou professionnelles des autres : pour un chercheur, les langues de l’agriculteur, de l’habitant, de l’élu, etc. Et vice versa, et de se découvrir ainsi les uns les autres des formes d’expertises qui, sans être du même niveau, n’en sont pas moins dignes d’intérêt, entre les expertises savantes et les expertises profanes, professionnelles, d’usage… Vous retrouvez-vous dans cette perception des choses ? Est-ce ainsi que vous vivez le VivAgriLab ?
Dorian Spaak : Je signe ce que vous venez de dire ! [Rire]
Sophie Pradié : C’est effectivement une attention que tous les acteurs du territoire ont les uns vis-à-vis des autres. On l’a vu ce matin à travers les tables rondes auxquelles les chercheurs participent au milieu d’autres intervenants, en s’exprimant de façon à être compris de tous, conscients qu’ils sont de la nécessité d’une appropriation des résultats de la recherche par le plus grand nombre. En sens inverse, vous avez pu constater la maîtrise des sujets aussi bien par les agriculteurs que par les élus dont certains ont eu tout à découvrir lors de leur prise de fonction. Par exemple, les problématiques de la pluviométrie et sa variabilité croissante, dans le cas du maire de Vauhallan, Vice-Président Assainissement de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay. La possibilité même de ces échanges incite d’autant plus facilement les acteurs du territoire à solliciter la recherche pour traiter de problématiques concrètes auxquels ils sont confrontés.
Dorian Spaak : Il n’en reste pas moins qu’un travail de « traduction » reste encore parfois nécessaire. Et, justement, j’ai le sentiment que notre rôle à nous, l’équipe de Terre & Cité, est d’y contribuer. Les chercheurs vont parfois s’exprimer d’une manière que les agriculteurs ou d’autres acteurs du territoire ne peuvent pas entendre. Non pas que les seconds ne soient pas à même de comprendre. Mais ils ne sont pas dans le même rapport au temps. Ils attendent moins des résultats de recherche valorisables dans une revue scientifique que des réponses concrètes aux problématiques qui se posent sur leur territoire, leur exploitation. Davantage encore que des traducteurs, au sens strict du terme, nous nous faisons les « interprètes » des uns et des autres pour qu’ils puissent se comprendre, avancer ensemble sur des projets communs. Et ce que je trouve passionnant dans tout cela, c’est qu’il en va comme dans l’apprentissage d’une langue étrangère : à force d’écouter des interlocuteurs et de parler avec eux, on finit par en comprendre la langue disciplinaire ou professionnelle. Tant et si bien que notre présence en devient même de moins en moins nécessaire. Et c’est très bien comme ça !
- Est-ce à dire que les échanges sont dépourvus de la moindre conflictualité ? Lors d’une table-ronde, il a été question de « conflits d’usage » à propos de l’eau et de ses modalités de stockage. Je vois que ma question vous fait réagir…
Sophie Pradié : Si conflictualité, voire tensions, il peut y avoir, c’est moins autour des projets qui sont portés que lorsque sont abordés les sujets relatifs à l’aménagement du territoire, son emprise sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers. L’expression de désaccords ne remet pas en cause la force du dialogue à laquelle nous croyons beaucoup.
Dorian Spaak : C’est tout l’intérêt d’un dispositif d’échange territorialisé comme le VivAgriLab que de permettre de construire dans le temps les conditions du dialogue et de la confiance. En dehors de l’aménagement du territoire, il y a bien d’autres sujets sur lesquels les échanges peuvent être tendus – je pense à ceux autour de démarches plus agroécologiques, des rapports entre l’agriculture et la ville, etc. Ce qui permet somme toute d’avancer, de maintenir le dialogue, c’est la confiance des différentes parties prenantes dans la volonté de chacun de trouver les solutions qui soient dans l’intérêt de tous. La confiance ne se décrète pas : elle se construit à travers des actes, se capitalise dans le temps. Quand la confiance mutuelle est là, les parties prenantes sont disposées à faire des pas bien plus grands que ceux qu’ils consentiraient à faire avec des interlocuteurs qu’ils ne connaîtraient pas encore. Cette efficacité du dialogue dans le temps est quelque chose dont les acteurs du territoire n’ont pas forcément conscience. Elle fait pourtant tout l’intérêt du VivAgriLab.
- Pour ce nouveau rendez-vous VivAgriLab, vous avez fait le choix de traiter de la thématique de l’eau. Comment y êtes-vous venu ? Je pose la question même si on devine l’acuité du sujet sur le territoire confronté depuis quelques années à une pluviométrique inhabituelle…
Sophie Pradié : Cela fait en réalité plusieurs années que ce sujet s’impose dans les esprits. Il est remonté très vite des échanges que nous avons avec nos partenaires. L’année 2024 a été particulièrement marquée par des épisodes pluviométriques exceptionnels – un doublement par rapport à la moyenne saisonnière, comme le rappelait un des intervenants. Tous les acteurs du territoires sont désormais confrontés à cette problématique et ses effets – les ruissellements, les inondations, etc. – : les agriculteurs, les élus, les habitants, les services de l’État.
- Une illustration du fait que le VivAgriLab colle au plus près des problématiques telles qu’elles se posent sur le territoire…
Dorian Spaak : Telles qu’elles se posent sur le territoire, mais aussi ailleurs, au plan régional, national et même mondial : nous avons la chance de compter de nombreux climatologues reconnus qui nous permettent de comprendre ce qui se joue aujourd’hui au plan planétaire : d’une part, ce qui nous apparaît comme des épisodes exceptionnels sont appelés à devenir en réalité la norme ; il nous faudra donc nous y habituer. D’autre part, ce n’est que le début de changements qui vont être autrement plus intenses. Ces experts nous indiquent en conséquence les directions qu’il nous faudra prendre y compris à l’échelle de notre territoire qui pouvait paraître préservé. Une chance exceptionnelle quand ont sait que peu de territoires disposent d’un tel concentré d’expertises. La recherche la plus à la pointe sur ces enjeux de changement climatique se trouve ici, sur le plateau de Saclay. Ce serait dommage de ne pas la convoquer pour savoir comment adapter en conséquence nos manières de produire, de consommer, etc. Pour en revenir maintenant au choix de consacrer cette édition à l’eau, il se justifie par les épisodes que nous avons connus, et par la nécessité d’anticiper les autres conséquences à prévoir en termes de besoins et de risques.
Sophie Pradié : Étant entendu que l’eau offre l’intérêt d’être un sujet chapeau au sens où elle permet d’en traiter bien d’autres : par exemple, l’enjeu du déploiement d’un projet de plantation de haies ou encore l’évaluation de la durabilité des fermes urbaines. Autant de sujets variés qui seront abordés lors des ateliers de l’après-midi, au prisme de l’eau tout en ouvrant sur d’autres problématiques.
- Avant de vous laisser lancer ces ateliers, un mot encore sur leur objectif ?
Sophie Pradié : Il est d’abord de digérer ce qui a été dit le matin en se concentrant sur un projet précis !
Dorian Spaak : D’une formule, on pourrait dire aussi qu’il s’agit de transformer l’essai. Après avoir entendu débattre le matin autour de diagnostics de la situation du territoire au plan climatique et des ressources en eau, le moment est venu de passer à l’action à travers la présentation de projets en cours que les participants auront tout loisir d’enrichir de leurs remarques et questionnements.
Journaliste
En savoir plus