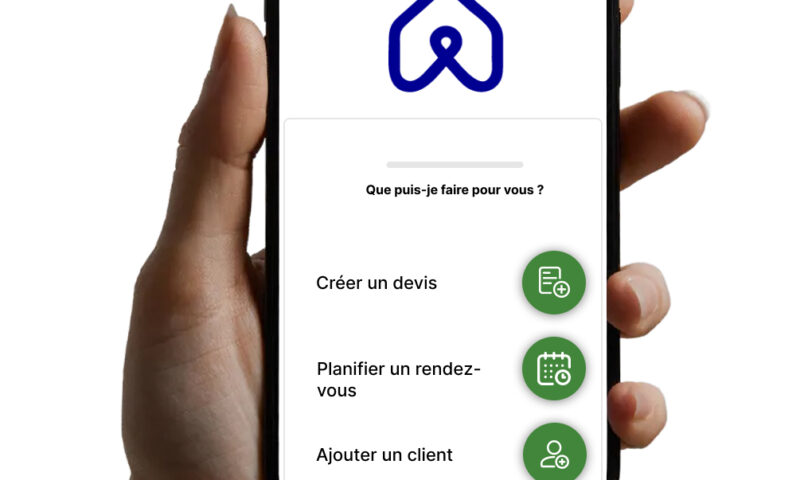Qu’est-ce qu’un entrepreneur innovant ?
Créé le 19/09/2013
Modifié le 10/01/2022
Suite de notre rencontre avec Bruno Martinaud à travers un entretien réalisé en septembre 2013 dans lequel il revient sur les différentes initiatives prises pour renforcer l’esprit entrepreneurial chez les Polytechniciens, dont la dernière en date : le partenariat conclu avec la prestigieuse Stanford Business School autour de Stanford Ignite Polytechnique, un programme européen de formation à l’entrepreneuriat innovant.
Pour accéder à la première partie de la rencontre avec Bruno Martinaud, cliquer ici.
– Même si l’Ecole polytechnique a produit de grands chefs d’entreprises, on ne l’associe pas spontanément à l’entrepreneuriat. Comment s’est opérée la greffe ? Vos enseignements ont-ils suscité ou révélé des vocations d’entrepreneurs chez des Polytechniciens ?
Deux forces ont joué en sens contraire : une première, qui n’incite pas à la prise de risque – à savoir l’histoire de l’Ecole polytechnique et le prestige du diplôme. Une seconde, qui tient, elle, au monde en pleine évolution en jouant dans un sens plus favorable : même à l’X, ll est admis que les carrières ne sont plus des trajectoires rectilignes. Un actif aussi important que peut l’être un diplôme de cette Ecole n’est plus suffisant pour garantir son bonheur personnel durant toute sa vie professionnelle. En parallèle, trente ans d’observation de la Silicon Valley ont permis d’établir que ceux qui maîtrisent les technologies sont parmi les mieux placés pour innover et créer des entreprises. A priori, des Polytechniciens sont donc bien prédisposés pour se lancer dans des projets de start-up. L’environnement est de surcroît favorable à l’innovation technologique, avec la proximité des laboratoires de recherche et des centres de R&D.
– Vous connaissez bien la Silicon Valley. Quelle est la part de mythe et de réalité ?
C’est à la fois un mythe ET une réalité, un lieu plus que favorable à l’entrepreneuriat. A tel point que, dans le cadre du Master d’Entrepreneuriat que nous avons mis en place, je pousse les étudiants à faire un de leur stage dans l’une des start-up de la vallée. On y trouve une source d’inspiration et de motivation sans nul autre pareil. On en revient avec plus de volonté encore d’entreprendre et de changer le monde !
Le lieu a émergé sous l’effet d’une conjecture unique que de nombreux ouvrages ont essayé de décortiquer et de comprendre. Ce qu’il en ressort est que son processus de création est tout sauf déterministe. Et cela vaut pour tous les clusters : on peut aider à leur émergence, les accompagner, mais certainement pas les décréter. Voyez a contrario Sophia Antipolis. Cette technopôle illustre les limites des clusters conçus dans une logique top down. Il ne suffit pas de réunir des laboratoires, des centres R&D et des établissements d’enseignement supérieur pour enclencher une dynamique d’innovation.
Non pas qu’il ne faille rien faire. On peut créer les conditions de cette alchimie, mais tout en ayant conscience du fait que le processus peut être seulement aidé, accompagné, certainement pas provoqué ex-nihilo. L’étude « Cluster Meta-Study », de Claas Van der Linde l’a clairement établi : sur les quelque 700 tentatives de création de cluster, relevées dans le monde, il n’y a eu qu’un succès probant (Hsinchu à Taïwan). On ne mesure pas toujours à quel point la Silicon Valley s’est elle-même développée à partir d’émergences chaotiques, difficilement prévisibles. Avant toute chose, ce qui frappe, c’est que le monde discute avec tout le monde. Quand les ingénieurs de Facebook, par exemple, ont un problème à résoudre avec leur système informatique, ils ne se tourneront pas vers Oracle ou Intel, mais leurs homologues de chez LinkedIN.
A la Silicon Valley, les entreprises ont beau être sur les mêmes niches, et donc potentiellement concurrentes, elles n’en arrivent pas moins à coopérer. Soit ce que des théoriciens appellent la « coopétition ». Mais dans la Silicon Valley, c’est un fait. Les gens de sociétés différentes se parlent, se rencontrent. Mieux, ils n’hésitent pas à aller d’une boîte à l’autre. Comment pourrait-il en être autrement ? A force de se rencontrer et d’échanger autour de leurs projets, ils finissent naturellement par éprouver des envies de collaboration.
Cette fluidité des compétences et des talents est difficilement imaginable ailleurs. Et pour cause, les salariés qui quittent leur boîte sont normalement astreints à une clause de non concurrence. Pas dans la Silicon Valley où un employeur ne peut interdire à ses employés de passer à la concurrence. On touche sans doute-là l’un des facteurs explicatifs de son dynamisme, comparé à d’autres clusters, y compris aux Etats-Unis. Celui de la Nouvelle d’Angleterre, par exemple, où s’applique la clause de non concurrence. Est-ce une explication ? Toujours est-il que la Nouvelle Angleterre qui dominait dans les années 60-70 a perdu son leadership au profit de la Silicon Valley. Une régulation de celle-ci existe bel et bien, mais elle se fait de manière informelle : si une société estime qu’une autre débauche trop de ses employés, son PDG pourra toujours décrocher son téléphone (son I-phone ?) pour faire respecter un gentlemen agreement.
– Et le cluster de Paris-Saclay sinon le Plateau de Saclay, préfigure-t-il à vos yeux un cluster aussi dynamique ?
Globalement, le cadre qui se met en place me semble cohérent. Mais il y manque encore cette couche qui fera que le système pourra… échapper à ceux qui l’ont pensé et institué ! C’est indispensable. L’innovation est par définition un processus qui ne se maîtrise pas : ce qu’on trouve est rarement ce qu’on cherchait. Il faut admettre que les projets innovants qui émergent n’ont rien à avoir avec ce qu’on avait prévu. Si le cluster est trop institué, contrôlé, il ne peut qu’aller à l’échec.
– Y a-t-il cependant des indices qui vous rendent optimiste quant à la viabilité du cluster en cours de constitution sur le Plateau de Saclay ?
La réponse est bien évidemment positive, même si on peut s’interroger sur le décalage entre le monde, qui change de plus en plus vite, et ce cluster qui se met en place sûrement, mais lentement, en tout cas trop à mon goût. Abstraction faite de cette considération sur la vitesse, il y a un vrai motif d’optimisme : les étudiants eux-mêmes. Ils sont demandeurs de changement, justement pour pouvoir innover, entreprendre. Sous leur pression, on ne pourra pas faire autrement que d’avancer ! C’est notamment en réaction à la demande exprimée par les étudiants, autour du succès des 1ers cours lancés sur le sujet, que l’Ecole polytechnique s’est engagée, avec des ambitions affirmées, dans cette voie ».
Il faut juste faire en sorte que ces étincelles provoquées par les étudiants, en se rencontrant de manière plus ou moins fortuite dans le cadre improbable d’un bar près de la gare de Lozère ou d’ailleurs, puissent se traduire par un projet. Après, que celui-ci n’aboutisse pas, n’est pas en soi un problème. Au contraire. Il pourra peut-être déboucher sur d’autres opportunités. L’effort doit donc porter sur l’accompagnement, certainement pas sur le travail de conviction des étudiants de l’intérêt d’innover et d’entreprendre. Ils en sont déjà convaincus tant ils ont envie de changer le monde !
– Venons-en au Master d’Entrepreneuriat que vous avez mis en place…
Il l’a été il y a deux ans, en 2011 pour le MI, l’année suivante pour le M2. A l’X, les étudiants ont déjà de fortes aptitudes dans les sciences et les technologies. Le Master met donc, en parallèle de la poursuite d’un cursus scientifique, l’accent sur les méthodes et la culture entrepreneuriales.
– Combien d’élèves visez-vous ?
Nous sommes partis avec l’objectif de commencer modestement, avec une vingtaine d’élèves, afin de garder le contact avec chacun d’eux. Le corps du Master est constitué d’enseignements montés ex-nihilo. Il nous a donc fallu accompagner aussi les enseignants. A terme, nous comptons accueillir une trentaine d’élèves, en ajustant les cours en fonction des enseignements que nous tirerons des premières promotions.
– En quoi consistent les enseignements ?
Au-delà des techniques et outils classiques de création d’une entreprise, à commencer par le Business Plan, l’enjeu est de leur inculquer un esprit entrepreneurial. Si je devais utiliser une métaphore pour illustrer cet esprit, j’utiliserais celle du musicien de jazz qui, pour improviser, se doit d’écouter ses pairs. Il ne crée pas ex-nihilo mais compose d’une manière personnelle à partir de ce qu’il entend. Entreprendre, cela suppose aussi un sens minimum de curiosité, une capacité à s’ouvrir à d’autres domaines de spécialité que les siens. Personnellement, je me suis engagé dans un projet de création d’entreprise, suite à la lecture d’un livre d’histoire sur la France du Second Empire qui a coïncidé avec l’invention de la forme moderne de la presse. Il m’a donné des idées d’applications pour Smartphone… De par leur parcours qui les a amenés à l’X ou d’autres grandes écoles, les étudiants tendent à perdre cette curiosité et leur sens de l’observation. Pourtant, c’est en observant autour d’eux, en se frottant à d’autres champs de compétences que leur viendront leurs idées pour leur projet entrepreneurial.
– Nous sommes à l’X. Dans quelle mesure l’esprit entrepreneurial peut-il être entretenu dans ses bâtiments dont la configuration semble a priori peu propice à cet écosystème relationnel que vous décriviez. Dans quelle mesure est-il par ailleurs soluble dans une culture polytechnicienne, fondée sur une organisation hiérarchique ?
Il n’y a pas de doute possible quant à la volonté de l’Ecole polytechnique d’avancer dans la valorisation de l’entrepreneuriat Cette volonté se structure au fil du temps à travers des décisions et des initiatives, notamment sur le plan pédagogique avec, par exemple, des cours ouverts, qui mélangent les étudiants ; des cours en extérieur, organisés avec d’autres établissements : l’Essec et son Centre de l’entrepreneuriat social ; HEC, toute proche ; une école de design… En multipliant ces partenariats, nous faisons le pari qu’en résulteront des envies de collaborations entre les élèves de ces différents établissements, en dehors de leurs cours. Dès l’année prochaine rentrée Ils auront accès dans le cadre d’un cours en construction, à un FabLab, où prototyper leurs idées.
A travers ces initiatives, nous sortons progressivement du cadre pédagogique classique, où les élèves écoutent poliment le professeur, jusqu’à la sonnerie qui marque la fin du cours. Il y aura certes toujours des cours magistraux, car il y a besoin de dispenser des connaissances générales, mais la formation ne se réduira plus à eux.
Comme vous pouvez le constater, nous procédons avec modestie, en n’hésitant pas à nous inspirer des bonnes pratiques. Nous avons pris le temps d’identifier les compétences de base de l’innovateur et de l’entrepreneur pour organiser en conséquence un corpus d’enseignements. Puis, à partir de ce corpus, nous sommes partis dans l’exploration des approches pédagogiques innovantes. Concrètement, cela est passé et passe encore par des interactions avec, d’une part, des institutions extérieures et à l’international ; d’autre part, les étudiants. La dynamique d’apprentissage est la boucle de rétroaction la plus importante pour faire évoluer les programmes, changer ce qui ne marche pas, inventer ce qui n’existe pas encore…
– L’échec est riche d’enseignement dites-vous : comment fait-on admettre cela à des Polytechniciens à qui on n’a eu de cesse de rappeler qu’ils participaient de l’élite de la Nation ?
Le moyen de leur faire admettre est simple : il consiste à leur faire rencontrer des gens tout aussi brillants qu’eux et qui ont rencontré l’échec au cours de leur parcours d’entrepreneur, et qui n’ont aucun scrupule à expliquer comment avant de réussir, ils ont échoué… Il n’y a rien de plus motivant pour un étudiant que de rencontrer des entrepreneurs. A cette fin, nous avons pris plusieurs autres initiatives, à commencer par la mise en place d’un Start-up café : tous les mois, entre midi et 14 h, de jeunes entrepreneurs viennent témoigner. Ce programme, ouvert aux premières et deuxièmes années, est désormais piloté par de jeunes anciens. Dès l’année prochaine, nous comptons faire venir des entrepreneurs expérimentés pour que les étudiants prennent la mesure du caractère à la fois chaotique et imprévisible du chemin qui mène à la réussite entrepreneuriale. Non seulement, il ne faut pas avoir peur de l’échec, mais il faut l’accélérer. Ce que la directrice du Stanford Technology Ventures Programme, Tina L. Seelig résume bien par ces mots : «Fail fast and frequently, cheap and gracefully ». Ils devraient constituer le motto de tout bon entrepreneur.
– Des facteurs culturels ne pèsent-ils pas dans le rapport à l’échec ?
Si. C’est ce que montre d’ailleurs Sven de Klen, en comparant le rapport à l’échec aux Etats-Unis et en Europe. Au-delà du rapport à l’échec, il met en évidence l’importance du rapport à la vitesse : l’entrepreneur américain procèdera à de nombreuses itérations – non parce que le projet risque de ne pas survivre, mais parce qu’il peut ne pas se développer suffisamment vite au regard de son ambition, alors que pour l’entrepreneur européen le fait de maintenir en vie son entreprise est en soit un critère de succès quitte à la contraindre à végéter plus longtemps. Or, un entrepreneur aura d’autant plus de probabilité de se retrouver sur un projet à fort potentiel qu’il procédera à plus d’itérations. Ce dont les élèves inscrits au Master d’entrepreneuriat peuvent se rendre compte par eux-mêmes quand ils vont à la Silicon Valley : ils y rencontrent des étudiants de leur âge qui ont déjà plusieurs créations d’entreprises à leur actif. Et manifestement, cela ne leur a pas trop mal réussi.
– Venons-en au programme Stanford Ignite Polytechnique : dans quelle mesure s’inscrit-il dans vos efforts de promotion de la formation à l’entrepreneuriat ?
Il s’y inscrit pleinement. Dès l’abord, j’insisterai sur le fait que c’est une opportunité exceptionnelle pour l’Ecole polytechnique que de travailler dans une relation de partenariat très intime avec cette Mecque de la Silicon Valley, et d’apprendre à travers ce partenariat. Je précise encore qu’il est noué avec la Business School et non la School of Ingineering. Ainsi, le programme est parfaitement complémentaire avec notre propre formation. En plus de son format court – il est organisé en 5 modules de 2 jours et demi chacun – il cible des ingénieurs et des scientifiques, mais à partir du savoir-faire d’une Business School. Bref, le programme Stanford Ignite Polytechnique est l’occasion pour l’X d’apprendre à concevoir d’autres formes d’enseignement de l’entrepreneuriat innovant au contact d’enseignants expérimentés dans ce domaine.
– Disposez-vous de la possibilité d’amender le programme suivant vos propres besoins ?
D’ores et déjà, les enseignements ont été adaptés au contexte européen. Car, et c’est important de le préciser, le programme s’inscrit à cette échelle. Il vise à mettre les élèves au contact d’autres cultures. Ainsi, les X côtoyeront des élèves d’autres pays pour travailler autour de projets communs. En cela, le programme répond bien à l’objectif d’internationalisation de l’Ecole polytechnique.
– Au-delà du partenariat institutionnel, ce programme est le fruit d’une rencontre fortuite…
En effet. J’ai découvert son existence par hasard lors d’un voyage à San Francisco. Le premier à m’en avoir parlé n’est autre que le Consul de France auquel je souhaite rendre hommage pour son dynamisme. A l’origine, les équipes de Stanford pensaient installer leur programme à Berlin. Nous les avons convaincues de travailler avec nous, aidés en cela par la direction de l’X qui a bien pris la mesure de l’enjeu en se montrant proactive. La prise de contact a été tout de suite excellente. Une délégation de Stanford nous a ensuite rendu visite en février. C’est dire si les choses sont allées vite et que l’innovation, qu’elle soit pédagogique ou autre, est aussi une histoire de rencontres.
Journaliste
En savoir plus