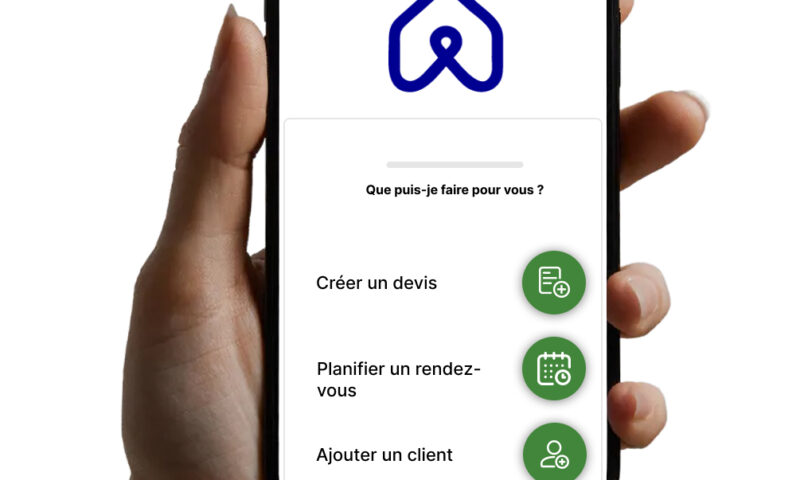Nous avions déjà eu l’occasion d’interviewer Michel Morvan, le président de l’IRT SystemX. C’était sur le vif, à l’occasion de la première édition de DigiHall Day. Mais nous souhaitions en savoir davantage sur sa vision de la transformation digitale de l’industrie et des services ainsi que sur son parcours l’ayant conduit à créer une start-up – Cosmo Tech, tournée vers l’intelligence «augmentée» -, après un début de carrière d’enseignant-chercheur et une expérience au sein d’un grand groupe industriel.
– Comment appréhendez-vous la transformation digitale ?
La transformation digitale est un enjeu majeur, ni plus ni moins, pour l’avenir de l’industrie et des services. Pour autant, elle ne justifie pas cette focalisation à laquelle on insiste sur le big data, les données massives. Si celles-ci constituent le carburant de cette transformation digitale, elles ne sauraient suffire. On a aussi besoin de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes complexes, pour mieux les piloter, aider à la prise de décision. Le traitement de données, aussi fin soit-il, ne nous exonère pas de ce besoin de compréhension. Dès lors, deux autres mots clés doivent être associés à la transformation digitale, à savoir : la modélisation et la simulation. Ils sont précisément au cœur du métier de l’IRT SystemX.
– Qu’est-ce à dire concernant l’intelligence artificielle, qui semble également focaliser toute l’attention ?
En effet, qui dit transformation digitale pense spontanément à cette forme d’intelligence. Mais je crains que cette notion ne soit déjà galvaudée, qu’il y ait un malentendu quant à ce qu’elle recouvre exactement. En l’état actuel des choses, l’intelligence artificielle ne fait pour l’essentiel que mimer l’une des deux grandes fonctions du cerveau, en l’occurrence la reconnaissance. L’autre faculté de l’intelligence humaine, à savoir la compréhension, lui est encore étrangère. Tandis que je vous parle, votre cerveau mobilise ces deux facultés. Non seulement, il reconnaît les mots que j’utilise – je ne pense pas abuser du « jargon » – et les phrases que j’énonce, sans avoir besoin de les analyser dans le détail, mais encore il en comprend le sens, le raisonnement qui les sous-tend. Pour l’heure, l’intelligence artificielle ne permet de faire que de la reconnaissance. Toutes les applications dont on parle aujourd’hui consistent en rien d’autre que cela. Si l’intelligence artificielle présente un avantage par rapport au cerveau humain, c’est qu’elle permet de reconnaître non seulement plus rapidement, mais encore à une plus grande échelle. Elle détecte bien mieux toute sortes de phénomènes : des risques de panne, des tumeurs,… Encore que… Ainsi que l’illustrent les erreurs commises en 2015 par Google [qui avait classé deux personnes noires dans la catégorie « gorille » dans son application de reconnaissance d’image] ou par Flickr [qui en avait étiqueté une dans les catégories « Animal » et « Singe »], elle n’est pas dépourvue de biais, qui tiennent à la manière dont les algorithmes de reconnaissance sont conçus. Plus généralement, aucune application basée sur l’intelligence artificielle n’est en mesure de « comprendre » ce qu’elle reconnaît. Et personne n’a le début du commencement d’une réponse à la question de savoir comment faire pour qu’une machine soit à même d’apprendre, de comprendre et de raisonner par elle-même. Peut-être sera-ce possible un jour, mais pas avant plusieurs décennies. Les seules « machines » à même d’apprendre par elles-mêmes à raisonner sont les êtres vivants, les humains aussi bien que les animaux, dont l’intelligence est loin de se réduire à la faculté de reconnaître. Eux aussi apprennent au fil de leur évolution. Certains ne sont pas loin d’avoir développé un type particulier de langage.
– Quelles conclusions en tirez-vous dans votre valorisation de l’IA auprès des industriels ?
Nous leur proposons d’aller chercher l’intelligence non pas seulement dans les données, mais dans la tête d’experts en chair et en os, en encapsulant leurs expertises dans des logiciels, qui permettent ensuite d’apprécier l’impact d’une décision ou d’un changement de paramètre sur un système complexe. Car tel est l’enjeu pour les industriels, confrontés à la complexité croissante de leurs systèmes de production de biens comme de services. Cette complexité est telle qu’aucun expert ne peut prétendre avoir une compréhension exhaustive et globale d’un seul de ces systèmes complexes. Le cœur de métier de Cosmo Tech ne consiste donc pas en autre chose que cela : encapsuler une diversité d’expertises, traduites sous forme de modèles que l’on relie ensuite de façon à anticiper, encore une fois les effets d’une décision ou d’un changement de paramètre sur l’ensemble de ces modèles interreliés. Ainsi, à défaut de comprendre, nos logiciels sont capables de produire une expertise supérieure à celle contenue dans la tête d’un seul expert et même à la somme des expertises encapsulées. C’est pourquoi nous préférons parler d’ « intelligence augmentée », plutôt qu’artificielle. Dans certains cas, cependant, nous ne pouvons nous en tenir à cela. Il nous faut aller plus loin et envisager un second niveau d’intelligence augmentée…
– Expliquez-vous…
De manière générale, tout système complexe, même composé d’élément très hétérogènes – physiques, chimiques, vivants… – est a priori modélisable. On peut donc en anticiper les interactions et les dynamiques évolutives. Seulement, il est des phénomènes pour lesquels on ne dispose pas d’expertise humaine à même de les modéliser.
– Par exemple ?
En voici un très simple mais ô combien crucial pour l’industrie. C’est le phénomène de la corrosion. Aujourd’hui, aucun expert, même parmi les physiciens, n’est capable de modéliser ce phénomène et, donc, d’anticiper les effets de différentes variables comme, par exemple, l’augmentation de la pression, la fréquence d’utilisation, etc. C’est là que réside à notre sens l’intérêt des données accumulées au fil du temps. Prenez une cuve dont vous aurez suivi l’évolution sur plusieurs années, grâce à un relevé systématique de données sur les conditions de température, les pressions auxquelles elle aura été soumise, la nature de son contenu, etc. Un outil d’intelligence artificielle fondé sur la reconnaissance pourra, par l’identification des données les plus pertinentes, produire un modèle simplifié du phénomène de corrosion et suppléer ainsi l’absence d’expertise humaine. De la même façon, vous pourrez optimiser les paramètres mieux que ne pourra le faire une expertise humaine. En ce sens-là, on peut bien parler d’un deuxième niveau d’intelligence augmentée : on injecte de l’intelligence artificielle, quand il y en a besoin. Mais ce n’est pas tout. On peut encore envisager un 3e niveau d’intelligence augmentée. On en vient à notre véritable cœur de métier, qui est de simuler les systèmes, autrement dit projeter les évolutions dans le temps. Soit une autre capacité de notre cerveau humain, que nous ne cessons de mobiliser au quotidien. Je ne sais pas ce que vous ferez à l’issue de cet entretien. Vous, vous le savez grâce à cette capacité à vous projeter dans un futur plus ou moins proche et ainsi le simuler. Les logiciels que nous concevons ont aussi cette capacité avec, pour le coup, un niveau de puissance autrement plus élevé que le cerveau humain. Mais quel que soit le niveau d’augmentation de l’intelligence, nos logiciels n’en restent pas moins conçus à destination d’autres experts humains. Dit autrement, ils n’ont pas vocation à prendre eux-mêmes des décisions, mais à éclairer la prise de décision par des résultats de simulation, qui devront ensuite être analysés par des experts humains, connaissant suffisamment bien le système et leur métier pour en faire une interprétation pertinente.
– A vous entendre, on comprend bien votre positionnement, à savoir : à l’interface de l’apport du numérique et d’expertises humaines…
C’est exactement cela. Et vous aurez compris pourquoi, dans cette perspective, nous préférons parler d’intelligence augmentée, car c’est bien d’une intelligence à la fois humaine et artificielle qu’il s’agit.
– Tout béotien qu’on soit, on mesure aussi l’étendue des champs d’application qui s’ouvrent à vous…
Ils sont effectivement immenses.
– Pourriez-vous citer quelques exemples parmi les plus emblématiques que vous investissez ?
Cosmo Tech est encore une « petite » entreprise – elle compte quelque 75 employés. Nous avons donc fait le choix de concentrer nos forces sur l’optimisation des actifs industriels. On travaille, par exemple, sur les réacteurs nucléaires pour optimiser les arrêts de tranches (pour mémoire, la maintenance de ces réacteurs exigent de les arrêter tous les 12-18 mois). Il s’agit là d’opérations complexes, impliquant de l’ordre de 15 000 tâches à exécuter, assurées par des experts, dont il faut planifier les interventions, en anticipant le moindre aléas, jusqu’à, et y compris, l’indisponibilité d’un ou plusieurs de ces experts, pour cause d’arrêt maladie. Au risque sinon de prendre du retard et d’allonger la période d’inactivité d’une tranche. Or, une journée d’arrêt coûte de l’ordre de 1 à 2 million(s) d’euros. C’est dire l’enjeu d’un effort d’optimisation. Nous avons donc conçu un logiciel de simulation permettant d’anticiper les problèmes susceptibles de survenir et de prendre les décisions le plus en amont possible. Voilà un premier exemple de notre offre vis-à-vis d’un actif industriel, et qui est loin de se limiter à l’industrie nucléaire. Tous les grands groupes industriels sont confrontés à des problématiques comparables, en l’occurrence des surcoûts de maintenance, engendrés par des aléas non anticipés ou une programmation non optimale des équipes d’intervention. Au-delà des actifs industriels, nous pouvons aussi répondre aux problématiques propres aux grands systèmes de réseau, en l’occurrence de transport d’électricité. Il faut savoir que les différents équipements qui constituent celui qui irrigue notre pays pour assurer l’approvisionnement en électricité à haute tension (réseau RTE) ont été construits pratiquement au même moment, il y a une cinquantaine d’années, et sont donc en passe d’atteindre tous à peu près au même moment leur âge limite d’exploitation… (soit en moyenne, une « espérance de vie » d’une cinquantaine d’années). Si, donc, on appliquait aujourd’hui à leur maintenance le même niveau d’exigence que par le passé, on devrait faire face à un niveau d’investissement prohibitif. Faute de pouvoir les remplacer tous au même moment, il va falloir faire des choix en priorisant le remplacement des équipements. Non sans difficulté car le moindre de ces remplacements a des effets en cascade sur l’ensemble du réseau – les équipements, faut-il le préciser, ne sont pas indépendants, mais reliés les uns aux autres. A quoi s’ajoutent deux autres défis. D’une part, adapter dans le même temps le réseau existant pour qu’il puisse prendre en charge l’injection de l’électricité produite par les énergies non renouvelables (photovoltaïque et éolien, principalement). D’autre part, le renouvellement des salariés qui seront très nombreux à pouvoir faire valoir leur droit à la retraite dans les prochaines années. Ce qui suppose un effort de recrutement et de formation, mais aussi d’allocation optimale des ressources humaines et des compétences aux bons endroits…
– On mesure les enjeux qui se présentent au point de s’étonner qu’on en fasse si peu écho dans les débats publics…
Je ne saurais vous dire pourquoi il en est ainsi. En revanche, je peux vous assurer du fait que RTE s’en est saisi et ce, à bras le corps. Nous travaillons depuis longtemps avec cet opérateur. Nous avons modélisé la moindre composante de son système : les réseaux, les équipes, les finances, les risques, etc., en nous appuyant sur les différents niveaux d’intelligence augmentée que j’ai évoqués. Concrètement, notre logiciel permet à RTE d’anticiper l’impact de la moindre décision comme, par exemple, le report du remplacement sur plusieurs années ou même de décennies, de tel ou tel équipement. Ce type de logiciel est utilisable pour d’autres réseaux. Nous sommes d’ailleurs en train de le commercialiser auprès d’autres gestionnaires de réseau de transport électrique, à travers le monde, en concentrant pour le moment nos efforts sur l’Europe.
– Je saisis l’occasion de cet exemple pour vous demander le degré de prédictibilité des logiciels que vous concevez ?
Dissipons tout malentendu : il ne s’agit pas tant de prédire l’avenir – nous sommes toujours à la merci d’aléas, mais d’apprécier l’impact de décisions et, donc, de permettre aux décideurs d’en prendre en connaissance de cause et de les justifier.
– N’est-ce pas pourtant le propre du traitement des données que de prédire, au sens de la maintenance prédictive ?
C’est justement une autre illusion attachée à l’analyse des données. Au prétexte qu’on disposerait d’une quantité massive de données, on pourrait anticiper des évolutions de phénomènes. Autour de moi, j’entends beaucoup de managers convaincus que leur métier va changer, et ils espèrent anticiper ces changements grâce à l’utilisation massive des données. Or, les données qu’on analyse décrivent des situations passées… Si, donc, on se contente de ces données, il est peu probable qu’on puisse se projeter dans un avenir radicalement nouveau, disruptif, comme on dit. On ne peut anticiper quelque chose qui ne s’est pas déjà produit car c’est la condition pour qu’il soit dans les données… En réalité, tout se passe comme si vous étiez au volant d’une voiture richement dotée de capteurs, mais dépourvue de phares. Tout va bien jusqu’à la nuit tombée. A ce moment, là, il vous faudra bien pouvoir éclairer pour savoir quelle direction prendre, vous ne pourrez pas vous contenter de regarder dans les rétroviseurs pour voir comment est la route derrière vous, en espérant que la route qui arrive sera identique.
– Où en êtes-vous dans le développement de Cosmo Tech ?
La dernière levée de fonds que nous avons réalisée en septembre dernier a été une réussite – nous avons recueilli 18 millions d’euros. Nous y voyons une marque de confiance des investisseurs quant à notre vision de la transformation numérique.
– Un mot sur le parti que vous avez pris de revenir de la Silicon Valley, alors qu’on s’attend au trajet en sens inverse de la part d’une start-up aussi technologique que la vôtre…
Notre départ aux Etats-Unis avait été motivé par la conviction que nous ne pouvions pas nous engager dans la conception de logiciels de gestion de systèmes complexes, sans être présents dans la Silicon Valley. Je m’y suis donc installé pour explorer le marché américain, avec une équipe constituée sur place – la société s’appelait alors The CoSMo Company. Nous nous sommes rendu compte que dans le domaine que nous avions investi – l’optimisation de la gestion d’actifs industriels – nous ne pouvions, dans le contexte américain, nous développer sans nous associer à des partenaires déjà suffisamment installés pour avoir la confiance des industriels. Surtout, force a été de constater que sur les problématiques de la transformation digitale de l’industrie, l’écosystème américain était finalement moins mature que l’écosystème français. Je ne le répéterai donc jamais assez car c’est désormais mon crédo : nous autres Français avons vocation à devenir les meilleurs du monde sur le sujet ! Vous m’avez bien entendu : nous sommes à même de devenir les leaders. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de notre écosystème un creuset : nous comptons des entreprises industrielles mondialisées, de nombreuses start-up dans le domaine du numérique et une recherche académique à la pointe.
– Qu’est-ce qui vous a motivé à prendre la présidence de l’IRT SystemX ?
Si nous voulons mener à bien cette transformation digitale de l’industrie, il nous faut des lieux qui facilitent les indispensables interactions entre les industriels et les académiques sans oublier les PME et les start-up. Et j’ai acquis cette autre conviction que l’IRT SystemX était non seulement un de ces lieux, mais l’un des meilleurs. En témoigne d’ailleurs la dynamique qu’il connaît : son cercle de partenaires ne cesse de s’élargir. De plus en plus de start-up, mais aussi de PME frappent à notre porte. En plus de résoudre de vraies problématiques industrielles, l’IRT offre l’opportunité à des start-up/PME, des grands groupes et des chercheurs académiques de travailler ensemble, sur des problématiques de recherche nouvelles, issues directement du marché. Cela apporte de la valeur à chacun d’entre eux : les grands groupes peuvent résoudre des problèmes cruciaux en utilisant les dernières avancées scientifiques et technologiques apportées par les académiques et les start-up ou les PME tandis que celles-ci peuvent non seulement prouver la valeur de leurs technologies et de leurs savoir-faire mais encore s’ouvrir ainsi de nouveaux marchés. Quant aux chercheurs académiques, ils peuvent identifier de nouveaux sujets clés, y compris en recherche fondamentale. Ce n’est pas tout, la réunion de plusieurs entreprises (grands groupes, start-up/PME) au sein d’un même IRT, leur permettra d’apprendre à travailler ensemble au jour le jour et ensuite, pourquoi pas, à chasser en meute au plan international. Je perçois une volonté largement partagée de vouloir travailler sur ce qui me semble être le sujet le plus important des décennies à venir : la transformation de notre industrie et de nos services au moyen du numérique et, j’ajoute, parce que cela me semble tout aussi important : à la française, c’est-à-dire avec notre approche, notre expérience et pour tout dire notre excellence, dans un certain nombre de domaines. Car j’ai aussi la conviction qu’il existe une voie française sinon européenne, qui doit se faire entendre. Une voie différente de la voie américaine ou de la voie chinoise. Non que celles-ci soient moins pertinentes. Mais parce qu’elles s’appuient sur d’autres histoires, d’autres contextes culturels et politiques. Nous, Français et Européens, avons des choses à dire et à faire à notre manière. Et à mon sens, l’IRT SystemX peut être le fer de lance de cette volonté, le meilleur creuset possible de cette transformation digitale de l’industrie et des services, en France et sur le reste du vieux continent.
![]() – A vous entendre, il y aurait presque une dimension culturelle dans cette transformation digitale qu’on définit spontanément comme un enjeu technologique… [en illustration : une démo IRT SystemX lors du DigiHall Day 2018].
– A vous entendre, il y aurait presque une dimension culturelle dans cette transformation digitale qu’on définit spontanément comme un enjeu technologique… [en illustration : une démo IRT SystemX lors du DigiHall Day 2018].
Oui, et l’erreur serait précisément de sous-estimer cette dimension proprement culturelle. La reconnaître est une autre manière de souligner la dimension humaine, inhérente à la prise de décision dans la gestion de systèmes complexes. Pour les raisons que j’ai données, celle-ci ne peut reposer sur une intelligence strictement artificielle. Il est illusoire de s’en remettre à des outils aussi sophistiqués soient-ils. La prise de décision doit rester l’apanage d’hommes et de femmes. Faut-il le regretter ? Je ne le pense pas. En l’état actuel des choses et comme je le soulignais au début de cet entretien, l’intelligence artificielle n’est pas dépourvue de biais, y compris dans ses capacités de reconnaissance, qui, rappelons-le, sont tributaires des données qu’on aura fait mémoriser à la machine. Les « affaires » Google et Flickr que j’évoquais tout à l’heure montrent jusqu’où la dimension humaine peut se nicher, y compris dans ce qu’on présente de plus artificiel, au prétexte que c’est fondé sur des données numériques et des algorithmes. Il y a encore une autre façon d’envisager la digitalisation et c’est justement la voie que nous explorons au sein de l’IRT SystemX comme de Cosmo Tech.
– Il reste que les interactions entre le monde industriel et le monde académique ne vont pas de soi. Qu’est-ce qui, selon vous, les rendrait plus faciles dans le domaine de l’ingénierie numérique ?
Sur les différents sujets dont nous parlons depuis le début de cet entretien – l’intelligence artificielle, l’intelligence augmentée, la transformation digitale – les problématiques qui se posent aux industriels, que ce soit la sécurité du véhicule autonome, l’industrie du futur, etc., sont, à la différence d’autres domaines, proches de celles des académiques. Aussi le chemin entre le travail de recherche et l’application industrielle est-il particulièrement court.
![]() – Mais comment surmonter les risques de défiance entre ces différentes parties prenantes qui ne se connaissent pas a priori ?
– Mais comment surmonter les risques de défiance entre ces différentes parties prenantes qui ne se connaissent pas a priori ?
C’est tout l’intérêt d’un IRT que de créer les conditions d’une confiance mutuelle entre académiques, industriels et startuppers, en commençant par leur donner la possibilité de se rencontrer. Au risque de vous surprendre, le défi est culturel avant d’être technique ou financier. Il s’agit tout de même de faire travailler ensemble des personnes qui évoluent dans des univers différents. Il faut donc qu’elles prennent le temps de se connaître. Très vite, elles comprennent que leur partenariat est un jeu gagnant-gagnant. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, des questions industrielles nourrissent la recherche académique. L’inverse est vrai. En voici un exemple : l’ « explicabilité » de l’IA, un enjeu de recherche majeur qui se trouve en être aussi un pour l’industrie – un dirigeant ne peut prendre une décision à partir d’un algorithme dont on ne peut expliquer les choix. C’est dire l’intérêt qu’il peut y avoir pour les scientifiques à l’aborder par le prisme des questions telles qu’elles se posent du point de vue de l’industriel. Il n’y a pas d’un côté la recherche fondamentale et de l’autre la recherche appliquée, mais des allers retours permanents entre les deux. Dès lors que vous leur donnez les moyens de le faire, rien ne devrait empêcher les uns et les autres d’opérer un transfert rapide entre recherche et marché.
– Qu’est-ce qui singularise l’IRT SystemX par rapport à d’autres lieux de transfert ?
Si l’IRT SystemX se singularise, c’est par la place qu’il fait aux start-up et aux PME. La collaboration se fait d’autant plus facilement que les startuppers qui investissent le domaine de l’ingénierie numérique sont souvent eux-mêmes issus du monde académique et/ou industriel, ou encore valorisent les résultats de recherche académique. En témoigne à sa façon Cosmo Tech dont la plateforme a été conçue à l’ENS de Lyon, du temps où j’y étais professeur et où je dirigeais un institut de recherche sur les systèmes complexes, l’IXXI, avant d’être appliquée à des problématiques industrielles. C’est au fond ce même travail de transfert qu’entend faciliter l’IRT SystemX, mais à une plus grande échelle et sur des cas plus diversifiés comme ceux que j’ai évoqués (véhicule autonome, industrie du futur…).
– Dans quelle mesure votre propre parcours vous a-t-il prédisposé à présider l’IRT SystemX ?
Dans le fait qu’il m’a amené à évoluer successivement dans le monde académique et ceux de l’industrie et des start-up. Pour avoir été tour à tour chercheur, cadre dirigeant au sein d’un grand groupe et, aujourd’hui, startupper, je suis en mesure d’anticiper le questionnement des uns et des autres, et de savoir ce qu’il importe de faire pour surmonter les risques d’incompréhension voire de défiance.
– Pourquoi ne pas avoir poursuivi comme chercheur ?
J’ai débuté très tôt une carrière académique – après mon habilitation à diriger des recherches, je suis devenu professeur des universités dès l’âge de 28 ans. Ce qui a été à la fois une chance et un problème. Car une fois que vous êtes professeur des universités, il n’y a plus guère d’évolution possible. Mes recherches, à la frontière des mathématiques et de l’informatique portaient sur l’algorithmique et les mathématiques discrètes ; elles étaient certes stimulantes, mais je ne me voyais pas les poursuivre quarante ans durant. Curieux de nature, j’avais fait en parallèle à ma thèse, des études en histoire, ce qui m’avait convaincu du fait qu’en dehors des sciences dures, il y avait d’autres manières d’appréhender le monde, qui n’étaient pas moins dignes d’intérêt. A défaut de pouvoir être spécialiste de tout, je dévorais les ouvrages de vulgarisation, sur lesquels je tombais, fût-ce parfois par le plus grand des hasards…
– Expliquez-vous…
Un jour – nous sommes au milieu des années 90, j’étais tout jeune professeur – un ami me recommande la lecture de La Théorie des catastrophes, un ouvrage du mathématicien René Thom, publié dans la fameuse collection Champs Flammarion. Je me rendis aussitôt dans une librairie (à l’époque, Amazon n’existait pas…). Elle disposait de tout un rayon de cette collection. Manque de chance, celui que je cherchais n’y figurait pas. Qu’à cela ne tienne, je me résous à en prendre un autre, celui qui était placé jusqu’à côté et qui se trouvait être La Théorie du Chaos, de James Gleick. Sous couvert de parler de cette théorie, il y traitait beaucoup de la complexité. Je me souviens de l’avoir lu d’une traite. Sa lecture m’avait passionné au point de me décider à me consacrer à cet enjeu durant les quarante prochaines années de ma carrière ! De fait, j’ai réorienté les axes de ma recherche pour m’« attaquer » aux problématiques de la complexité. Comment la gérer et ce, dans quelque domaine que ce soit ? J’avais la conviction que tel était le véritable défi auquel l’humanité allait être confrontée. J’ai commencé à appliquer cette théorie de la complexité aux domaines que je connaissais le mieux : les mathématiques et l’informatique. Pour cela, j’ai été huit ans durant, comme professeur extérieur (External Professor) au Santa Fe Institute, la Mecque de la recherche interdisciplinaire sur les systèmes complexes (située au Nouveau Mexique). De retour en France, à l’ENS de Lyon, où j’enseignais l’informatique, j’ai entrepris, avec mon collègue Paul Bourgine, de promouvoir la recherche sur les systèmes complexes au sein du monde académique, à travers la création de deux entités – l’une à Lyon, l’Institut rhônalpin des systèmes complexes (IXXI), l’autre à Paris, l’ISC Paris-Île de France – à chaque fois dans l’idée de mobiliser sciences dures et sciences humaines et sociales. Dans les années 2000, j’ai participé au montage de projets européens, ainsi qu’au pilotage et à l’évaluation des recherches sur la complexité en Europe. Petit à petit, j’ai acquis la conviction que, non seulement, nous avions besoin d’outils conceptuels et logiciels, mais encore que tous les systèmes complexes – que ce soit un organisme vivant, une ville, un grand système industriel,… – pouvaient être appréhendés, à partir de mêmes briques de modélisation et de simulation. J’ai donc commencé, avec mes équipes, à créer un langage informatique qui permettait de décrire n’importe quel système complexe. Ce qui devait déboucher plus tard sur la création d’une plateforme de modélisation et de simulation dédiée. Cela a été la base de la technologie de création de solutions d’intelligence augmentée que nous développons dans Cosmo Tech, une start-up cofondée avec Hugues de Bantel. Dès lors que les avancées scientifiques avaient été réalisées, j’ai éprouvé le besoin de passer au stade de la valorisation industrielle. Soit l’enjeu du transfert, on y revient. C’est ainsi qu’après un passage au sein d’un grand groupe industriel (Veolia, dont j’ai assuré la direction scientifique de 2009 à 2013), j’ai intégré la start-up que nous avions créée entretemps. Et ce qui me motive dans ce choix de vie, c’est la conviction – encore une ! – que cette aventure entrepreneuriale est la meilleure façon pour moi de faire passer des idées qui me sont chères, car à même, selon moi, d’aider à relever des défis de notre monde. Ni plus ni moins.
– On n’ose imaginer ce qu’il serait advenu de votre carrière si vous n’étiez pas entré dans cette librairie… Ou si déjà à l’époque, il avait été possible de faire votre achat sur l’équivalent d’un Amazon…
Encore que… Pour avoir échangé avec les ingénieurs d’Amazon, du temps où j’étais à la Silicon Valley, j’ai fini par comprendre que les algorithmes de recommandation s’appuient en réalité sur les achats que d’autres humains ont fait en étant placés dans la même situation. Sous couvert d’intelligence artificielle, cette plateforme numérique exploite donc le fruit de choix d’intelligences humaines…
– Cela étant dit, reconnaissons que la probabilité de faire l’expérience de la sérendipité – puisque c’est de cela qu’il s’agit en un certain sens – est plus forte en fréquentant une librairie qu’en passant par une plateforme numérique de type Amazon…
J’en conviens volontiers.
– Au terme de ce entretien, je ne peux m’empêcher de voir en vous la réincarnation de ces entrepreneurs du XIXe siècle qui étaient à l’interface du monde de la connaissance et celui de l’industrie…
J’accepte volontiers cette comparaison, dans laquelle je retrouve cette idée que, pour investir des champs variés, vivre des expériences professionnelles différentes, en tant qu’académique, cadre dirigeant, startupper et président d’un structure de recherche technologique – je n’en suis pas moins la même personne. Seules des frontières culturelles sinon sociales empêchent de voir la continuité du parcours. Et pourtant, elle existe et je peux en témoigner. Ce qu’incarne aussi à sa façon l’IRT SystemX, en associant justement académiques, industriels et startuppers.
– Dans quelle mesure l’inscription de l’IRT SystemX dans l’écosystème Paris-Saclay l’aide-t-elle dans ses missions ?
Paris-Saclay constitue un environnement plus que favorable : toutes les parties prenantes de l’IRT SystemX y sont présentes, que ce soit les chercheurs et les startuppers, mais aussi les industriels. Et pourquoi ne pas ne pas le dire, Paris-Saclay est l’un des meilleurs clusters au monde !
– Et c’est un startupper ayant longtemps séjourné dans la Silicon Valley qui le dit ?
Oui, bien sûr ! Nous n’avons pas à rougir de la comparaison ! Tous les ingrédients dont nous avons besoin y sont : une recherche d’excellence mondiale, des start-up innovantes, des industriels de dimension mondiale. Les autres IRT peuvent tout autant se prévaloir d’un réel dynamisme. C’est ce qui ressortait d’ailleurs bien du forum qui s’est tenu le 11 octobre dernier à Toulouse. Les résultats obtenus en termes de transferts sont proprement remarquables. En un an, le nombre de transferts a en effet doublé, passant de 201, en 2017, à 411, à la fin septembre 2018. SystemX contribue activement à ce bilan positif : l’institut compte en effet 52 transferts technologiques, 16 brevets et 304 publications. Ces résultats ont été rendus possibles grâce à l’écosystème que nous avons su construire. Aujourd’hui, l’institut compte en effet 83 partenaires industriels, dont les deux tiers sont des PME, et 24 laboratoires académiques partenaires.
Crédit photo : Gil Le Fauconnier/IRTSystemX et Cosmo Tech (portrait de Michel Morvan) ; Master Films.
Journaliste
En savoir plus