Plus qu’une pierre à l’édifice de Paris-Saclay
Créé le 08/09/2025
Modifié le 14/09/2025
Entretien avec Claire Lenz, secrétaire générale de l'IHES
C’est en mathématiques et en physique théorique une référence mondiale. Sa nouvelle secrétaire générale, Claire Lenz, que nous avions eu l’occasion d’interviewer en d’autres circonstances, nous en dit plus sur l’IHES, les chercheurs qui y sont accueillis, les bénéfices que cet institut tire de son inscription dans l’Université Paris-Saclay et son écosystème.
- Si vous deviez pour commencer rappeler la vocation de l’IHES ?
Claire Lenz : L’IHES est un institut de recherche internationale en mathématiques et physique théorique. Quoique créé sur le modèle de l’Institute for Advanced Study (IAS), il se limite à ces deux champs disciplinaires – là où l’IAS couvre aussi les sciences humaines et sociales –, avec la conviction qu’ils ont beaucoup à s’apporter mutuellement. Si je devais mettre en avant une caractéristique de l’IHES, ce serait celle-ci : il entend favoriser le dialogue à tous les niveaux, entre ces deux disciplines, mais aussi entre des chercheurs de différents pays, de différentes cultures, de différentes générations. Les chercheurs que nous accueillons ici sont à différents stades de leur cursus : ce sont des doctorants, pour les plus jeunes, des chercheurs émérites de tout premier plan, pour les plus âgés.
- « De différentes cultures » avez-vous dit. Est-ce à dire qu’il y aurait des approches différentes de ces deux disciplines ? En quoi consistent ces différences culturelles dès lors qu’on traite de mathématiques ou de physique théorique, des sciences qui réfèrent a priori, en tout cas pour le béotien que je suis, à des connaissances d’ordre universel ?
C.L.: C’est bien de « différences culturelles » dont j’ai parlé, car si les mathématiques sont un langage qu’on peut qualifier d’universel, l’approche qu’on en a peut varier selon les pays, la manière dont les sciences s’y sont constituées, le parcours du chercheur, etc. Et c’est précisément cela qui est intéressant, propice à des échanges féconds et, bien plus, à des découvertes : c’est en effet parce qu’il parvient à faire un pas de côté par rapport à ses habitudes, à faire un rapprochement auquel il n’avait pas songé jusqu’alors, par rapport à sa vision de sa discipline, à creuser d’autres pistes qu’un chercheur peut parvenir à de nouveaux résultats.
De là l’importance que l’IHES accorde au dialogue et à l’échange. Loin de l’image courante du chercheur isolé dans sa tour d’ivoire, les chercheurs en mathématiques et en physique théorique ont une appétence pour ce dialogue entre collègues. Eux-mêmes le disent : un article publié dans une revue académique, c’est plusieurs pages, indéchiffrables et pour tout dire indigestes de prime abord, y compris pour des spécialistes ; en réalité, il n’a pas d’autre fonction que de servir de support à une discussion entre chercheurs. Car c’est en échangeant directement, de manière plus ou moins formelle, qu’on peut en saisir toute la portée, plus vite que si on en entreprend seul la lecture, la « traduction ». Ce qui suppose de disposer de temps en commun avec des collègues.
- Mais aussi d’un cadre adapté. C’est l’occasion de décrire celui dans lequel s’inscrit l’IHES : un cadre arboré à l’abri du tumulte de la vie urbaine, quoiqu’à proximité d’une station du RER B (Bures-sur-Yvette)…
C.L.: Nous sommes effectivement dans un écrin de verdure qui procure un sentiment immédiat de sérénité et de quiétude, et participe en cela à la magie du lieu et au plaisir d’y travailler. Et ce d’autant plus que les chercheurs et chercheuses que nous accueillons ici sont libéré.e.s de toutes contraintes : d’enseignement et, autant que faire ce peut, administratives…
- Permettez-moi de vous reprendre sur le mot de contraintes : qu’on puisse parler de contraintes administratives, je le conçois, mais de « contraintes d’enseignement »… Je m’interroge en considérant que l’enseignement est une tâche noble, même si, bien évidemment, je conçois l’intérêt pour un chercheur de voir sa charge de cours allégée…
C.L.: Vous avez raison ! D’ailleurs, certains de nos professeurs permanents apprécient de pouvoir enseigner, et y consacrent de leur temps alors qu’ils n’y sont pas obligés. Je n’en tiens pas moins à souligner que dans un poste universitaire standard, en France comme ailleurs, la charge d’enseignement réduit le temps disponible à la recherche, d’autant que celles et ceux qui enseignent sont soucieux de bien faire leur travail et y consacrent donc beaucoup de leur temps et de leur énergie. Réduire cette charge permet à l’enseignant-chercheur de disposer de temps pour laisser son esprit explorer de nouvelles pistes. L’IHES pousse plus loin le raisonnement en considérant que le fait de permettre au chercheur de disposer à différentes étapes de son parcours de la possibilité de se consacrer totalement à la recherche, en toute liberté, dans un dialogue informel avec des collègues, peut produire des effets bénéfiques. L’un de nos derniers professeurs permanents en physique théorique à avoir rejoint l’Institut, Julio Parra-Martinez, a cette belle image que j’aime reprendre : à l’IHES, on peut se permettre d’être des « explorateurs ».
Bien évidemment, nos chercheurs peuvent postuler à des bourses de type ERC [European Research Council, Conseil Européen de la Recherche], à des financements de l’ANR [Agence nationale de la recherche] – dont l’obtention est aussi un marqueur de succès scientifique, de sorte que beaucoup candidatent. Ils peuvent également enseigner – une manière pour eux de rester au contact des étudiants et potentiellement d’identifier de futurs talents. Mais ils peuvent aussi ne pas le faire, poursuivre leur recherche en toute liberté, sans avoir à rendre de compte. Et nous ne les en dissuadons pas, car nous savons combien il peut être important pour eux de laisser leur esprit entièrement consacré à l’exploration de nouveaux domaines.

- Combien de chercheurs avez-vous accueillis et selon quelles modalités de sélection ?
C.L.: Depuis la création de l’Institut, en 1958, l’IHES a accueilli vingt-trois professeurs permanents, ainsi dénommés, car une fois en poste, ils restent à l’Institut aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Ils se répartissent entre neuf physiciens et quatorze mathématiciens ; l’arrivée du 14e vient d’être annoncée, il s’agit de Hong Wang, jeune mathématicienne de 34 ans. Parmi les professeurs permanents en mathématiques, nous comptons huit médaillés Fields et trois lauréats du prix Abel, soit les plus prestigieuses distinctions mondiales dans cette discipline – rappelons qu’il n’y a pas de prix Nobel de mathématiques. Rappelons encore que la médaille Fields n’est remise que tous les quatre ans, à quatre lauréats individuels à la fois, des mathématicien.ne.s de moins de quarante ans. De création plus récente, en 2001, le prix Abel est, lui, remis chaque année pour récompenser l’ensemble de la carrière d’un.e. mathématicien.ne.
Certains cumulent les deux, à l’image de Pierre Deligne, ancien professeur permanent [de 1970 à 1984], recruté à l’âge précoce de 23 ans à l’IHES où il est resté plusieurs années, avant de recevoir la médaille Fields. Suite à quoi il a rejoint l’Institute for Advanced Studies où il a été professeur durant plusieurs années. En 2013, il recevait le prix Abel.
Actuellement, nous comptons six professeurs permanents, quatre en mathématiques, deux en physique. À qui s’ajoutent quatre à cinq professeurs du CNRS, affectés à une unité mixte de recherche située ici, à l’IHES ; des doctorants, présents pour trois ans – la durée de leur thèse – et des post-doctorants – pour trois ans également -, beaucoup d’entre eux étant associés à l’école doctorale Jacques Hadamard de l’Université Paris-Saclay.
En 2022, nous avons commencé à accueillir des « professeurs juniors » – des chercheurs encore trop jeunes pour être recrutés au titre de professeur permanent. Des postes de cinq ans, particulièrement attractifs. Les deux premiers recrutés sont Yilin Wang et Clément Delcamp, respectivement en mathématique et en physique théorique.
Permettez-moi de retracer leurs parcours tant ils sont impressionnants : Chinoise, Yilin Wang est venue en France pour des études en prépa ; elle a intégré l’ENS Ulm, puis un master à l’Université Paris-Saclay, avant de poursuivre en thèse sous la direction de Wendelin Werner, médaillé Fields qui, à l’époque, était au LMO (Laboratoire de Mathématiques d’Orsay), situé à quelques pas de l’IHES. Suite à quoi elle a rejointe le MIT puis Berkeley. C’est à ce stade de son parcours que nous avons pu la recruter. Très vite, elle a obtenu une bourse ERC Starting Grant et d’autres prix prestigieux, et reçu des offres de recrutement. Finalement, elle a été recrutée par l’École Polytechnique de Zurich (ETH), qu’elle a rejointe ce mois-ci.
Quant à Clément Delcamp, arrivé quelque mois après Yilin, il a été sélectionné au CNRS où il est aujourd’hui chargé de recherche, affecté – c’est une chance pour nous – à l’unité mixte que nous hébergeons et que j’évoquais.
- Deux professeurs juniors à qui vous donnez la possibilité de côtoyer au quotidien des médailles Fields et autres lauréats du prix Abel…
C.L.: Effectivement, et c’est une possibilité dont jouissent aussi nos doctorants et postdoctorants. Si les premiers sont le plus souvent du territoire, les seconds sont pour la plupart des internationaux. Tous ont été soumis à des procédures de recrutement sélectives. Chaque année, nous recevons de très nombreux dossiers de candidature pour seulement six/sept places bon an mal an. Soit, à raison d’une présence de trois ans pour chaque doctorant et postdoctorant, un total d’une vingtaine d’étudiants présents chaque année. Leur passage par l’IHES se révèle pour eux un formidable tremplin.
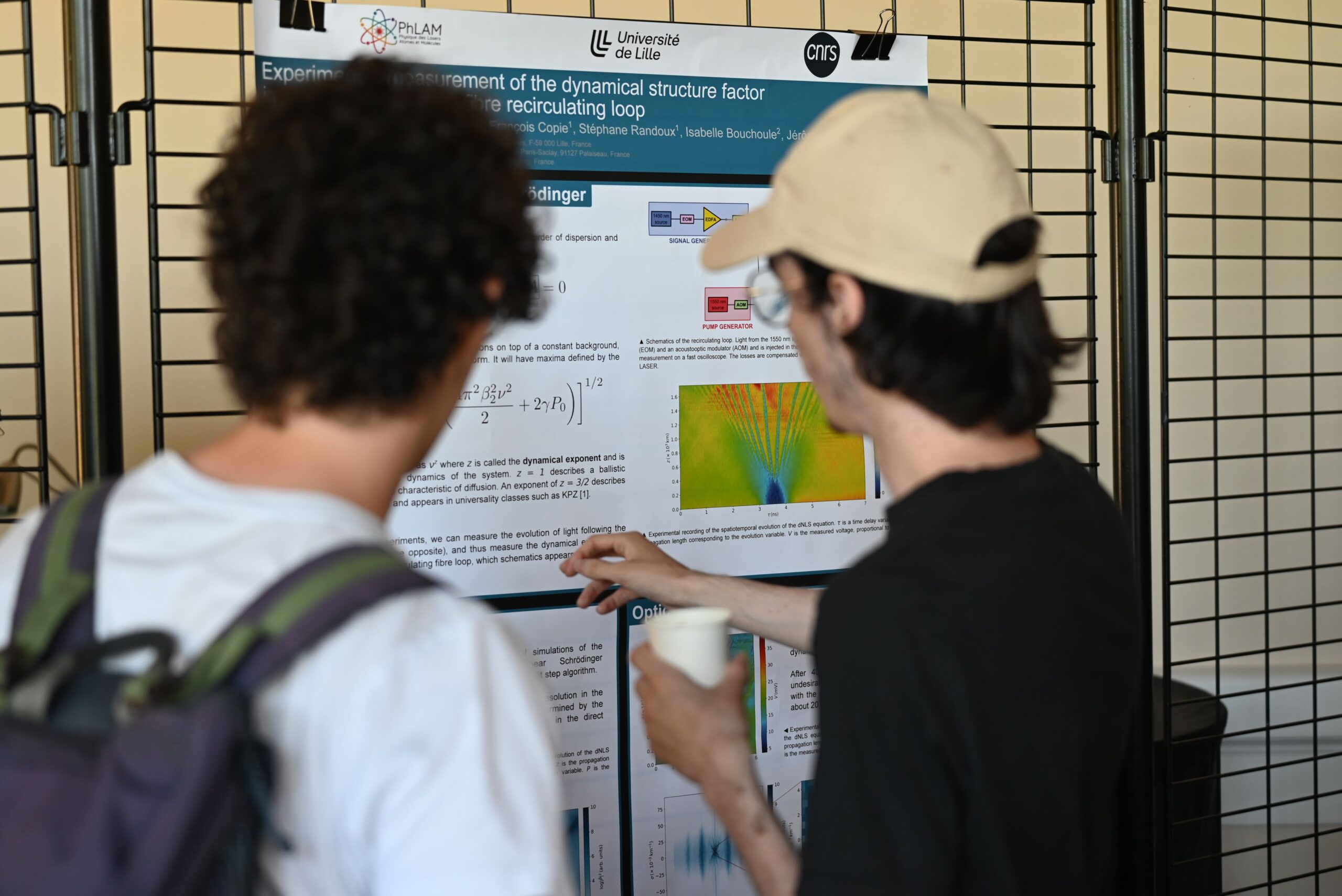
- Un mot sur les lycéens auxquels vous ouvrez aussi vos portes…
C.L.: Nous les avons accueillis le samedi 24 mai. Il nous apparaît important de pouvoir offrir, dans la mesure de nos possibilités, l’opportunité à des scolaires de rencontrer d’éminents physiciens et mathématiciens. Nous avons à cette fin, il y a maintenant quelques années, noué un partenariat avec l’Académie de Versailles et des inspecteurs en mathématiques pour faire venir des élèves de plusieurs lycées – jusqu’à trois par établissement avec pour principe que, dans ce cas, il doit s’agir d’au moins deux filles. Car nous sommes attachés à contribuer à encourager ces dernières à s’orienter vers les mathématiques, la physique et les sciences en général. Concrètement, ils viennent passer une matinée, visitent le site et assistent à deux exposés scientifiques d’une heure chacun – ce samedi, l’un d’eux était assuré par Clément Delcamp ! Bien sûr, nous veillons à ce que ces exposés soient accessibles mais sans renoncer pour autant à une certaine exigence.
- Je ne résiste pas à l’envie de réagir à ce principe d’exigence, auquel on tend à renoncer dans les démarches de vulgarisation alors même, c’est mon sentiment, que des jeunes, comme d’ailleurs de moins jeunes, peuvent éprouver du plaisir à entendre une langue scientifique comme ils en auraient à entendre une langue étrangère qu’ils ne pratiquent pas. A fortiori quand c’est de la bouche d’un chercheur passionné.
C.L.: Absolument ! Je partage cette idée. Je crois aussi à la fascination qu’un chercheur peut exercer sur son auditoire quand bien même celui-ci n’en comprendrait-il pas tous les propos. L’enjeu est bien la transmission de connaissances, mais aussi et peut-être d’abord d’une passion. Il faut juste bien choisir nos intervenants. Tout brillant qu’il puisse être, un chercheur n’a pas forcément d’appétence pour intervenir auprès d’un grand public tout simplement parce qu’il n’est pas à l’aise à prendre la parole devant une salle comble.
Nous accueillons par ailleurs des visiteurs et visiteuses scientifiques sur des séjours plus courts, d’une semaine ou de plusieurs mois – en moyenne deux mois. Chaque semaine, nous avons ainsi des visiteurs qui arrivent, d’autres qui repartent. Nous en recevons de l’ordre de 200 par an. Cela ajoute à la particularité de l’IHES.
Les motivations de leur visite sont variées entre la volonté de s’offrir une parenthèse scientifique ou de disposer d’un port d’attache lors de conférences internationales, de workshops et autres séminaires et/ou dans le cadre de collaborations avec des collègues de l’Université Paris-Saclay ou de toute autre institution de recherche francilienne.
En somme, l’IHES fait pour eux office de pied-à-terre de choix, car bien évidemment ils ont la possibilité d’échanger avec nos professeurs et étudiants. Leurs retours sont positifs : beaucoup nous disent être venus avec l’idée d’y rencontrer tel ou tel de nos chercheurs et d’avoir pu finalement en rencontrer bien d’autres, y compris parmi les visiteurs, et d’entamer avec eux des dialogues fructueux leur ayant permis d’explorer d’autres pistes de recherche.
- Une belle illustration de cette sérendipité qui préside à des découvertes et avancées dans le champ scientifique comme dans d’autres…
C.L.: Je n’ignore pas que c’est une notion qui vous est chère ; on peut attester de sa réalité, ici, à l’IHES !
Pour être exhaustive sur les profils des personnes qu’on est susceptible de croiser ici, j’aimerais évoquer des figures scientifiques qui, quoiqu’à la retraite, ont gardé un lien privilégié avec l’IHES. Je pense notamment à Thibault Damour, Médaillé d’or du CNRS en 2017, une légende vivante des ondes gravitationnelles et qui tout émérite qu’il soit, reste encore présent – il a son bureau et continue de travailler ici. Je pourrais en citer bien d’autres à commencer par Jean-Pierre Bourguignon, le prédécesseur de l’actuel directeur, Emmanuel Ullmo ; Misha Gromov, mathématicien exceptionnel, ou encore Yvonne Choquet-Bruhat, première femme à avoir rejoint l’Académie des Sciences ; disparue l’année dernière, elle a passé l’essentiel de sa retraite à l’Institut.
Leur présence concourt de manière informelle au nécessaire travail de transmission auprès des jeunes. Nous l’avons dit, c’est une chance pour nos doctorants et postdoctorants de pouvoir côtoyer leurs aînés, d’échanger avec eux, de manière informelle, comme au cours d’un déjeuner, ou au moment du thé, qui a lieu chaque jour, à 16 h – un rituel de l’IHES au cours duquel les chercheurs peuvent se retrouver, avec l’indispensable tableau pour interagir autour d’équations ou de formules. Des moments auxquels nous accordons beaucoup d’importance : ils permettent aux plus jeunes d’intégrer la communauté, de gagner confiance si besoin, en entretenant des rapports qui soient moins de maître à élève que de pair à pair.
- Vous avez passé en revue les différents profils de personnes séjournant ici ou qui s’y rendent pour un motif ou un autre. Mais il me semble que vous en avez omis un : ces fantômes qui doivent encore hanter le lieu… Je pense notamment à Alexandre Grothendieck ou Robert Oppenheimer dont vous me rappeliez en amont de cet entretien le rôle majeur joué au début de l’histoire de l’IHES…
C.L.: Alexander Grothendieck est, avec Jean Dieudonné, l’un des deux premiers professeurs permanents recrutés par l’IHES. Une légende s’il en est. On le surnomme d’ailleurs parfois le « Einstein des mathématiques » pour avoir notamment révolutionné la géométrie algébrique, devenue un axe fort de recherche de l’Institut. Un personnage si légendaire qu’il est même devenu une source d’inspiration au-delà des mathématiques, comme nous avons eu l’occasion de le montrer lors d’une soirée organisée ici même en février 2025 à l’occasion des dix ans de sa mort, avec Marie Durrieu, et les écrivains Hervé Le Tellier et Abel Quentin. Vous y étiez.
- En effet !
C.L.: Gardons-nous cependant de caricaturer la personne en en faisant plus qu’un mythe. C’est aussi et d’abord un mathématicien dont les travaux ont contribué à la réputation de l’IHES. Sans lui, ce dernier ne serait pas aussi connu, n’aurait pas pu attirer si vite parmi les plus grands mathématiciens.
Quant à Oppenheimer, il a eu un rôle actif dans la mise en place de l’IHES : il était membre de son conseil d’administration et a prodigué des conseils précieux, notamment sur les écueils à éviter quand on crée un institut comme celui-ci. Grâce à lui, des fonds ont aussi pu être levés aux États-Unis pour la création de l’IHES.
- Il reste que la notoriété de l’IHES paraît encore limitée à la communauté des mathématiciens et des physiciens théoriciens. Comment interprétez-vous d’ailleurs cette faible notoriété malgré son prestige dans des disciplines aussi importantes que les mathématiques et la physique théorique ?
C.L.: Le fait est, l’IHES n’est pas la première institution que l’on cite quand on évoque le monde de la recherche. Plusieurs motifs à cela. D’abord, sa petite taille. Ensuite, le fait qu’on n’y dispense pas d’enseignements ; les étudiants ne s’y projettent donc pas avant d’entreprendre une thèse ou un postdoc, ils s’orientent d’abord vers une université ou une grande école. Son histoire, enfin : l’IHES n’existe que depuis 1958.
L’IAS, dont s’est inspiré Léon Motchane pour créer l’IHES, est plus ancien : il démarre dans les années 1920, aux États-Unis avec le recrutement d’Albert Einstein déjà célèbre à l’époque et qui devait en faire très vite la réputation. Outre-Atlantique, l’IHES bénéficie d’ailleurs de cette notoriété : il a entretenu des liens privilégiés avec l’IAS au point d’apparaître comme son homologue européen, ainsi que je l’ai entendu dire lors de levées de fonds aux États-Unis.
- Comment expliquez-vous d’ailleurs ces liens privilégiés, en dehors de l’implication d’Oppenheimer ?
C.L.: Quand l’IHES est créé, en 1958, la France est encore en phase de reconstruction. Sa création est motivée par la volonté de préserver le niveau d’excellence de la recherche en mathématiques et physique théorique en Europe. Un élément de notre histoire qui explique notre sensibilité au sort de chercheurs confrontés à des contextes de guerre, comme c’est le cas actuellement des chercheurs ukrainiens. En janvier 2024, nous avons à notre tour accompagné le lancement du Centre International de Mathématiques en Ukraine, avec le concours de la médaillée Fields 2022 Maryna Viazoska – la 2e femme à avoir gagné le prix – toujours dans cette idée de préserver le vivier de mathématicien.ne.s d’un pays en guerre ou en reconstruction.
- À vous entendre, on mesure votre plein engagement dans la vie de l’IHES et son développement ; le lecteur fera donc naturellement l’hypothèse que vous devez être vous-même mathématicienne ou physicienne. Or, rien de tout cela..…
C.L.: En effet, je suis littéraire de formation ! Mais, je vis avec un chercheur physicien théoricien, directeur de recherche au Laboratoire de Physique Théorique et Modèles Statistiques (LPTMS) à Orsay, une unité mixte de recherche du CNRS et de l’Université Paris-Saclay. L’ayant connu très tôt, j’ai pu suivre son parcours : ses années de thèse, puis de postdoc, à l’Université de Chicago où j’ai pu exercer des fonctions. Ce faisant, je me suis intéressée aux problématiques de l’enseignement supérieur et de la recherche. Quelque chose m’a particulièrement frappée : notre pays avait beau compter des institutions de recherche de premier plan, elles n’étaient pas suffisamment reconnues à leur juste valeur à l’international. Tant et si bien que, de retour en France, j’ai eu envie de participer à leur rayonnement à l’international. J’ai postulé auprès de plusieurs institutions. Finalement, c’est l’Ecole polytechnique qui m’a recrutée.
- C’est à cette occasion que j’ai fait votre connaissance et réalisé de premiers entretiens avec vous…
C.L.: J’y ai été en charge de la communication à l’international. Convaincue qu’il nous fallait attirer plus d’étudiants internationaux en France, j’ai fondé et dirigé le Bachelor, un programme de formation destiné à recruter parmi les plus brillants.
Aujourd’hui, un autre sujet me préoccupe et explique le fait d’avoir rejoint l’IHES : les menaces qui pèsent sur la science. Ce qui semblait être un acquis – la primauté de la connaissance scientifique –, est remis en question. Qu’on soit de formation scientifique ou de formation littéraire, comme moi, il faut absolument se mobiliser, rappeler le rôle crucial de la science, son utilité pour les citoyens, pour faire la part entre des faits authentiques et des fake news, avoir une approche nuancée, qui autorise le doute ; l’importance des controverses et, donc des échanges, même contradictoires, entre chercheurs. C’est pourquoi je crois aussi beaucoup à la dimension internationale de ces échanges. Les résultats de la recherche appartiennent à tous. Ce n’est pas en dressant des frontières que nous parviendrons à relever les défis planétaires auxquels nous faisons face. Il faut que les talents potentiels, quel qu’en soit le genre, quelle qu’en soit nationalité, quel qu’en soit le milieu social d’origine, puissent éclore et être tirés vers le haut.
Ce sont, j’ose le dire, des valeurs qui me sont chères et qui m’animent au quotidien, aussi bien en tant que citoyenne que secrétaire générale d’un institut comme l’IHES.
- Sauf que le nerf de la guerre n’en reste pas moins l’argent, avec la question des capacités de financement de cette recherche. Une remarque qui est une invite à revenir à la première fonction que vous ayez exercée ici : l’organisation des levées de fonds, que vous avez introduites sinon amplifiées.
C.L.: Votre remarque est l’occasion d’évoquer un autre type d’échange auquel je crois beaucoup : les échanges entre les secteurs public et privé, entre partenaires académiques et industriels. Je trouve dommage de dresser des murs entre ces différents acteurs ; il y a au contraire nécessité à faire qu’ils se parlent et collaborent.
Pour en venir aux levées de fonds, elles ont été une réponse aux difficultés de trésorerie que connut l’IHES au début des années 2000. La subvention allouée par le ministère de la Recherche ne suffisait plus à couvrir ses charges et dépenses. Il y a une quinzaine d’années, cette subvention représentait encore 60% du budget de l’IHES. Aujourd’hui, c’est moins d’un tiers. Pour autant, on ne peut pas parler de désengagement de l’État au sens où cette subvention est restée constante – juste sans correction pour tenir compte de l’inflation. Nous savons cependant que nous pouvons continuer à compter sur le soutien du ministère. Il reste que si nous voulions non pas croître à tout prix, mais préserver notre niveau d’exigence et de qualité, il nous fallait trouver d’autres sources de financement, en allant les chercher du côté de mécènes, en plus des partenaires institutionnels qui nous soutiennent, tels que la Max Planck Gesellschaft en Allemagne ou l’Académie suisse des sciences naturelles.
Pour cela, l’IHES s’est inspiré de l’IAS – on y revient. Depuis sa création, celui-ci fait appel à des fonds privés. Pour notre part, nous nous en tenons à un strict mécénat au sens où nous n’avons aucune contrepartie à offrir en échange : les fonds ne servent pas à financer des recherches commanditées par des industriels. Nos mécènes privés, qui peuvent être des individus ou des fondations, donnent à l’IHES pour la « beauté de la science » ! Ils sont cependant convaincus qu’il existe un continuum entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée : les avancées réalisées dans la première pourront, peut-être, se traduire demain, à plus ou moins longue échéance, par des retombées au plan industriel, qu’on ne peut tout simplement pas anticiper. Mais l’histoire de la science fondamentale est riche d’exemples d’avancées qui ont pu se traduire par de telles retombées : le GPS pour ne prendre que cet exemple.
- Vos propos sont l’occasion de rappeler que contrairement à une vision courante des entreprises dans leur rapport à la science, certaines consentent à soutenir la recherche fondamentale (à travers des chaires, des fondations ou encore des thèses Cifre), car elles ont conscience que, face aux défis auxquels elles sont confrontées, c’est en empruntant des voies encore inexplorées qu’on trouvera peut-être des réponses à la mesure de ces défis…
C.L.: Absolument et c’est important de le rappeler. Parmi nos mécènes, qu’il me soit permis de citer le groupe BNP Paribas qui s’est engagé pour la 3e fois auprès de l’IHES à travers un don de 1 million d’euros, réparti sur plusieurs années, avec la conviction que la recherche fondamentale n’est pas découplée du reste de la recherche, au contraire, que ses résultats peuvent participer à un ruissellement au bénéfice de la recherche appliquée, fut-ce dans des pas de temps longs. Par conséquent, et c’est une autre de ses convictions, avoir un institut de premier plan comme l’IHES, en France, est une chance : au-delà des retombées en termes de résultats, un tel institut permet d’attirer des talents du monde entier. Je ne crois pas exagérer en considérant que l’IHES est à ce titre, avec le Collège de France, une des deux institutions en France capables non seulement d’attirer mais de maintenir durablement des scientifiques de premier plan.
- C’est au titre de responsable des levées de fonds, que je vous avais sollicitée pour une interview. Sauf qu’entretemps, vous vous êtes vu proposer le poste de secrétaire générale. Qu’est-ce que cela signifie-t-il ? Faut-il y voir une promotion ?
C.L.: C’est effectivement une promotion dont je m’estime honorée. Après avoir été en charge des échanges avec les mécènes privés et géré l’organisation d’événements et de galas de levées de fonds en France et à l’international, notamment à New York et Londres, mon rôle consiste désormais à mettre en musique les différents services et directions de l’IHES – la gestion des relations humaines ; l’informatique ; le service financier et comptable ; la gestion des relations avec les partenaires et les réseaux dont nous sommes membres ; la communication et le développement ; la logistique et l’entretien des bâtiments, la cafétéria. Les problématiques à traiter sont diverses : elles vont de la cybersécurité aux inondations comme celles dont nous avons pâti l’an passé, en passant par l’intrusion de sangliers dans notre parc…
- J’ai cru percevoir un regret de ne plus être tournée vers l’international ?
C.L.: Non pas du tout ! Je compte bien continuer à faire bénéficier à l’IHES de ma connaissance de réseaux tant en France qu’à l’international. Il y a encore beaucoup à faire sur ce plan, en dehors des levées de fonds. Il importe de ne pas se reposer sur nos lauriers et de continuer à benchmarker, à s’impliquer dans des réseaux de recherche en mathématiques ou en physique théorique, pour s’inspirer de ce qui se fait de mieux.
- Dans quelle mesure l’inscription de l’IHES dans l’Université Paris-Saclay et son écosystème Paris-Saclay sert-elle ses ambitions ?
C.L.: C’est évidemment un plus, et comme je l’espère, dans les deux sens. Comme nous l’avons vu, il y a clairement un enjeu de visibilité de l’Institut au plan international, que l’Université Paris-Saclay contribue à asseoir. Cette université est en lien avec de nombreuses autres universités de rang mondial. Ses excellentes positions dans des classements internationaux, à commencer par celui de Shanghai, en mathématiques et en physique – auxquels nous contribuons directement – nous bénéficient, non pas tant pour les besoins de nos recrutements – nous sommes de longue date identifiés par les mathématiciens et les physiciens théoriciens -, mais en ceci qu’elles facilitent nos approches de mécènes. L’inscription de notre Institut dans ce cadre plus général de l’Université Paris-Saclay leur permet de bien le positionner dans le système de l’enseignement supérieur et de recherche français.
Cette inscription confère bien d’autres avantages. J’en citerai deux. D’abord, l’accès aux bibliothèques de l’Université Paris-Saclay à commencer par la bibliothèque de mathématiques d’Orsay, une référence internationale, et le Lumen – des bibliothèques accessibles rapidement, par les transports en commun. Ils font plus que compléter la nôtre qui, aussi riche soit-elle, ne saurait répondre à toutes les attentes de nos résidents. Notre bibliothécaire fait d’ailleurs partie du réseau des bibliothécaires de l’Université Paris-Saclay et en tire parti.
Ensuite, avec la Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH), dont nous sommes membres, nous travaillons main dans la main pour notamment organiser l’accueil des masters-doctorants en mathématique, organisé ici à l’IHES. En sens inverse, nous accueillons aussi des journées comme « Maths en herbe » ou MathTech.
La première est destinée aux jeunes qui suivent la licence 3 de l’ENS Paris-Saclay, le cycle mathématique de l’Université Paris-Saclay ou le Bachelor de Polytechnique, pour leur faire découvrir le monde de la recherche. Des talents que l’on retrouvera potentiellement demain.
Quant à la journée MathTech, elle est dédiée au dialogue entre la recherche académique et celle qui se fait en entreprise – startups, TPE-PME, grands groupes, que ce soit dans le secteur de l’énergie, de la finance, etc. Elle s’adresse à des thésards invités à pitcher leur thèse tandis que des représentants d’entreprises témoignent de leur parcours, de la thèse à la R&D en entreprise. À quoi s’ajoutent des cycles de conférence pour lesquels nous mettons à dispositions des logements de notre résidence. Ainsi nous espérons bien apporter notre propre pierre à l’édifice de l’Université Paris-Saclay.
Crédit photo (portrait de Claire Lenz) : Christophe Peus
Journaliste
En savoir plus

