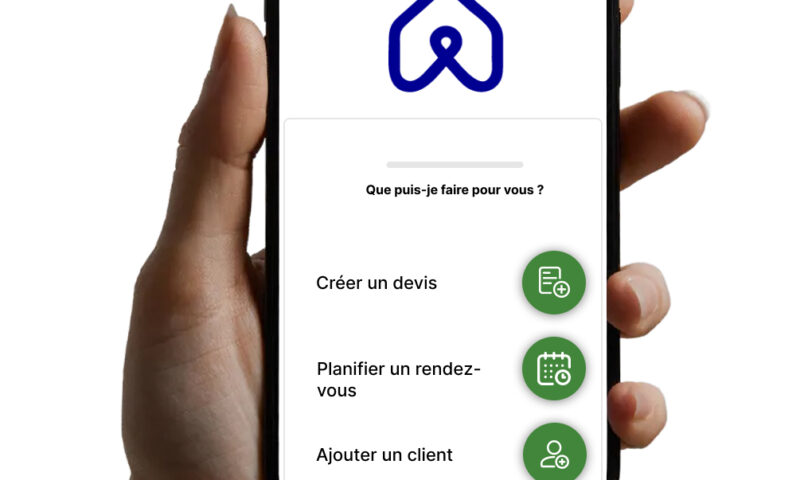Objectif lanceur économe pour smallsatts.
Créé le 30/11/2020
Modifié le 22/02/2022
Concevoir un lanceur adapté aux microsatellites dont le marché est en émergence. C’est l’ambition d’Opus Aerospace, actuellement hébergée au Paris-Saclay Hardware Accelerator. Son cofondateur nous en dit plus.
– Si vous deviez commencer par pitcher Opus Aerospace ?
Opus Aerospace est la société que nous avons créée à la fin de l’année 2019, avec pour projet de développer un lanceur de microsatellites. Il faut avoir à l’esprit que, depuis quelques années, la tendance est à la réduction de la taille de ces derniers : de plusieurs tonnes, on est passé à quelques dizaines de kilos pour les plus petits d’entre eux. Seulement, on ne dispose pas de lanceurs adaptés. Pourquoi ? Parce que les fusées ont été conçues pour lancer dans l’espace des satellites lourds. Les utiliser pour en lancer de plus petites tailles reviendrait à utiliser un train pour transporter une personne. Pour mémoire, mobiliser un lancer coûte environ 200 millions d’euros tandis que le coût d’un microsatellite à la conception est de l’ordre de quelques milliers d’euros…
Dans ce contexte, on assiste donc en France comme dans le reste du monde au développement d’un marché de lanceurs pour microsatellites. Pour ce qui nous concerne, nous investissons la niche des satellites de moins de 50 kg, lancés à l’unité ou en grappe (deux satellites de moins de 25 kg, par exemple), sachant que ces microsatellites peuvent aller jusqu’à 500 kg. Plusieurs concurrents ont d’ores et déjà développé une gamme de micro-lanceurs pour « smallsats »
– On imagine volontiers que c’est un marché très prometteur et, donc, très concurrentiel…
Effectivement, la concurrence est forte tant du côté des Etats-Unis que de l’Europe. Rien qu’en France, nous comptons trois concurrents. Il y en a aussi en Allemagne (au moins deux) et en Espagne (autant). Cela étant dit, le marché étant encore nouveau, il n’y a pas à proprement parler de concurrence active : les sociétés s’y lancent, mais un peu dans l’état d’esprit des pionniers d’Internet. Toute proportion gardée, la plupart seront vouées à disparaître ou à être rachetées, d’autant que le nombre de clients est beaucoup plus restreint.
 – Qu’est-ce qui vous détermine donc à l’investir avec autant d’assurance ? Quelles ressources et compétences mobilisez-vous pour espérer vous faire une place sur ce marché ?
– Qu’est-ce qui vous détermine donc à l’investir avec autant d’assurance ? Quelles ressources et compétences mobilisez-vous pour espérer vous faire une place sur ce marché ?
En somme, pourquoi nous sommes-nous dit que nous avions plus de chance de réussir que d’autres ? Cela tient à la voie que nous avons décidé d’emprunter. Nos concurrents ont pour la plupart fait le choix de fabriquer des fusées dans une logique de miniaturisation : selon le cas, ils se contentent de réduire la taille de fusées classiques, en recourant aux mêmes technologies, ou bien ils s’inspirent d’un modèle proposé par un de nos concurrents, Rocket Lab – une fusée à deux étages, dotée à sa base de 7 ou 9 moteurs, et d’un autre pour le 2e étage. Cette option nous interroge : comment ces concurrents peuvent-ils prétendre être concurrentiels si, au final, ils ne font que reproduire le même modèle, sans réelle valeur ajoutée ?
Toujours est-il que, nous, nous avons imaginé un produit très différent des autres. Il s’agit d’un lanceur mono-étage, ce qui a l’avantage d’être plus facile à concevoir, et pour cause : il n’a besoin que d’un seul moteur et d’un seul système de contrôle. Notre lanceur ne fera que six mètres de haut et, à vide, il pourra être transporté à la main (il fait à peine 30 kg). Aussi ne nécessitera-t-il pas d’infrastructures lourdes que ce soit pour son assemblage (pas besoin d’un bâtiment dédié) ou le pas de tir.
Ce n’est pas tout : pour les besoins de la motorisation, nous comptons recourir à des moteurs d’avion, ce qui offrira le grand avantage de nécessiter moins de carburant pour le vol. Enfin, l’ajout d’une aile permettra à notre lanceur de ré-atterrir comme la navette spatiale le faisait. Nous pourrons ainsi le réutiliser moyennant une chaîne de maintenance, elle-même simplifiée au maximum. Autant d’options qui, comme vous l’imaginez, permettront de réduira d’autant plus les coûts et, donc, la facture pour nos clients.
– Parleriez-vous d’innovation disruptive ?
Non, nous ne prétendons pas être disruptifs, dans la mesure où le concept que nous avons imaginé, même si nous sommes les seuls à le mettre en œuvre, avait déjà été imaginé dans plusieurs de ses principes et ce, dès les années 1960. Comme, par exemple, l’utilisation de l’oxygène de l’air pour le démarrage du lanceur ou le recours à des ailes. Mais, à ce jour, ces principes n’ont été envisagés pour de gros lanceurs, auxquels ils n’étaient pas les mieux adaptés. Aussi ont-ils été abandonnés. Nous, nous proposons de les reprendre, mais pour de micro-lanceurs.
– Vous parlez de votre projet à la première personne du pluriel. Qui se cache derrière ce « nous » ?
Effectivement, Opus Aerospace est un projet que je porte depuis le début avec François Félisiak, qui a fait comme moi l’Institut polytechnique des sciences avancées (IPSA), une école d’ingénieur dans le domaine aéronautique et spatial, implantée à Paris et à Toulouse. Depuis un certain temps, nous collaborons régulièrement avec des stagiaires, issus de notre ancienne école.
– On comprend mieux ce qui vous a prédisposés à vous lancer dans cette aventure. Mais quelles sont les autres explications que vous mettriez en avant ?
Ce qui nous a poussés, François et moi à nous lancer dans ce projet, ce n’est pas tant la formation suivie dans le cadre de l’IPSA, que l’activité à laquelle nous nous adonnions dans le cadre d’une association d’étudiants, qui a vocation à construire de petites fusées, lesquelles pouvaient faire jusqu’à deux mètres de haut et atteindre jusqu’à 3km d’altitude. Nos engins se rapprochaient donc plus du missile que de la fusée, mais ils n’en avaient pas moins un caractère expérimental – l’association a le CNES pour partenaire. Nous les lancions depuis la base militaire de Tarbes. L’un d’eux est parvenu d’ailleurs à franchir le mur du son.
– Qu’est-ce qui vous a décidés à poursuivre au-delà ?
François et moi nous entendions bien et avions pu constater que, par rapport à d’autres associations, nous parvenions à faire des engins de qualité et performants. Nous étions tout particulièrement intéressés par le fait d’optimiser la masse de la fusée, qui est justement notre sujet de préoccupation actuelle. C’est comme cela que l’idée nous est venue de poursuivre ce que nous faisions, mais en nous lançant cette fois dans la conception d’un micro-lanceur, et dans une démarche professionnelle. Pourquoi ce choix du micro-lanceur ? Parce que c’était finalement assez proche de ce que nous faisions déjà. Certes, nous passions à une échelle plus grande, mais sans basculer pour autant dans un univers qui nous aurait été totalement étranger.
– Ce faisant, vous vous engagiez dans une démarche entrepreneuriale, laquelle n’est pas anodine. Qu’est-ce qui vous a incités à franchir ce pas ?
Pour François et moi, la conception de fusées était devenue une passion dont nous souhaitions pouvoir vivre. Jusqu’alors, nous nous y adonnions gratuitement – nous payions même pour participer aux activités de l’association de notre école. Et puis, un jour, nous nous sommes dit que nous pourrions essayer d’en vivre puisque, après tout, un marché était en train de décoller. Forts de nos années d’expériences, nous estimions avoir les connaissances requises et disposer d’un réseau suffisant pour nous lancer à notre tour. De là notre décision de nous inscrire dans une démarche entrepreneuriale. Naturellement, il nous restait encore tout à apprendre en matière de création et de gestion d’une entreprise innovante. Pour nous, cela n’avait jamais été un but en soi, mais ça nous est apparu comme le moyen de vivre pleinement de notre passion : faire de l’ingénierie dans le domaine de l’aérospatial.
– Y a-t-il des prédispositions familiales ?
(Sourire) Ma mère travaille à son compte et connaît donc les aléas que peut rencontrer un entrepreneur. Quant à mon père, ingénieur chez Nokia, il s’était lancé dans un projet de start-up et comprend donc ce que je vis actuellement. Il reste que pour l’heure, je ne vis toujours pas de ma passion. Je me mets à leur place et imaginent combien ils peuvent appréhender cette situation : leur enfant n’a encore que 23 ans et il se lance dans un projet forcément un peu risqué – même si, en l’occurrence, j’ai un diplôme que je pourrais valoriser sur le marché du travail. Cela étant dit, ils ne me dissuadent pas et m’aident au contraire comme ils peuvent.
– Où en êtes vous dans le développement d’Opus Aerospace ?
Nous travaillons à la réalisation d’un prototype volant, lequel, forcément, est beaucoup plus complexe que ce que nous faisions jusqu’ici et nous prend donc plus de temps. Pour les projets précédents, nous étions dans une temporalité d’un voire deux ans. Nous visons aujourd’hui la conception et la maîtrise de ce dont nous ne nous occupions pas auparavant, à savoir la propulsion du moteur à base de carburants liquides, ce qui, forcément, prendra plus de temps. Actuellement, nous sommes en phase de tests de notre premier moteur en ayant pour cela réalisé notre banc de tests. Nous tâchons d’avancer en apprenant de nos erreurs, car naturellement nous en commettons, de façon à maîtriser cette technologie de propulsion. Une fois que nous y parviendrons, nous pourrons passer à la suite, en l’occurrence, la réalisation d’une première fusée de type suborbital (elle ira dans l’espace et reviendra sans aller en orbite, en procédant à un vol en cloche). Elle nous permettra de tester tous nos systèmes en vol, qui seront utilisés dans le vrai lanceur, pour un vol orbital, donc. Mais pour l’heure, nous concentrons nos efforts sur la propulsion.
– Quels sont vos rapports avec le secteur aérospatial ?
Nous sommes en relation avec le CNES. Il ne s’agit pas d’un partenariat officiel (le CNES étant une institution publique, il ne peut privilégier une entreprise en particulier), mais c’en n’est pas moins un allié de poids, qui nous fait bénéficier de conseils techniques. Il nous aide aussi dans le repérage d’une base de lancement pour notre première fusée.
– Comment financez-vous votre projet ?
Au début, nous le financions sur fonds propres, en essayant d’obtenir des réductions auprès de nos fournisseurs ou des prestations gratuites moyennant des contreparties. Par exemple, Erpro Group a réalisé l’impression 3D de nos premières pièces, en échange de la possibilité d’en utiliser les photos comme supports de communication – ces pièces se trouvent présenter aussi un intérêt au plan visuel.
Il est clair cependant que nous devons désormais disposer de financements plus importants pour développer notre fusée – notre business plan prévoit un budget de 10 millions d’euros. En octobre, nous avons été lauréats du Réseau Entreprendre. Ce qui nous a valu un prêt d’honneur de 50 000 euros, qui a débloqué la situation où nous étions : n’ayant pas de fonds propres suffisants, les banques nous refusaient le moindre prêt. Au-delà de ce financement, être lauréat du Réseau Entreprendre, c’est une belle opportunité d’élargir notre réseau de partenaires.
– Dont Paris-Saclay Hardware Accelerator…
En effet. En plus de nous héberger, Paris-Saclay Hardware Accelerator nous permet d’accéder à des machines de pointe dans l’impression 3D et d’obtenir des pièces usinées en un temps record : une fois commandées, elles nous sont livrées le lendemain – un gain de temps qui constitue un avantage par rapport à la concurrence. PSHA nous aide également dans nos recherches de financements. C’est lui qui nous a mis en contact avec le Réseau Entreprendre.
– Comment avez vous découvert Paris-Saclay Hardware Accelerator ?
François et moi étions à la recherche d’un incubateur. Lors d’un stage sur le campus Nokia de Nozay, j’ai eu l’occasion de découvrir le Garage, créé à l’initiative de Bertrand Marquet. Naturellement, je suis revenu vers lui pour savoir si Opus Aerospace pouvait y être incubé. Malheureusement, ce n’était pas possible : à l’époque le Garage était dédié aux projets associant des salariés de Nokia. Bertrand m’a cependant fait part d’un autre projet auquel il participait – il s’agissait de Paris-Saclay Hardware Accelerator. François et moi sommes allés le visiter en présence d’Alain Moinat, son associé. Le lieu nous a plu. Nous y sommes installés depuis mai 2020.
– Entre le campus Nokia et le PSHA, vous fréquentez des lieux de l’écosystème de Paris-Saclay. Celui-ci fait-il sens pour vous ?
Oui, bien sûr. Je lui trouve des atouts indéniables, mais aussi des faiblesses. Du côtés des atouts : en concentrant sur un même territoire, l’ensemble des acteurs de l’innovation technologique, jusqu’aux TPE-MPE, il permet de disposer de toutes les compétences nécessaires, à portée de main. En voici une illustration récente : François et moi cherchions un moyen de fabriquer des pièces en céramique en impression 3D. Alain nous a aussitôt mis en contact avec un spécialiste, qui était situé à dix minutes d’ici. Nous sommes allés le voir et avons fait aussitôt affaire – PSHA vient d’acquérir une imprimante céramique que nous sommes en train de tester. Tout aussi facilement, nous avons trouvé une entreprise qui a pu faire nos soudures – elle aussi est située pas loin d’ici. Une proximité qui permet d’instaurer des relations directes et de confiance.
Du côtés des faiblesses, maintenant : nous sommes loin de Paris ! Les moyens de transport ne sont pas à la hauteur. De sorte qu’on en est réduit à prendre sa voiture, mais au prix d’embouteillages. Je peux en témoigner pour résider à Paris. Actuellement, confinement oblige, la circulation est plus fluide – on peut se rendre au PSHA en une trentaine de minutes en voiture, contre plus d’une heure en temps normal. Je crains que cette difficile accessibilité dissuade encore des entreprises de s’y installer – elles rencontreraient des difficultés à recruter le personnel dont elles ont besoin.
– Cela étant dit, l’environnement n’est-il pas propice au développement d’un projet d’innovation hardware, comme le vôtre, qui exige a priori de travailler en toute tranquillité ?
C’est vrai. D’abord, nous avons d’ici une très belle vue sur un paysage agricole. Et puis l’espace est assez dégagé, sans trop d’habitants aux alentours, pour pouvoir nous livrer à nos essais moteurs, lesquels peuvent faire du bruit en cas de défaillance. Pas de danger pour autant. Tout au plus risque-t-on d’endommager un peu de maïs, cultivé juste à côté.
Journaliste
En savoir plus