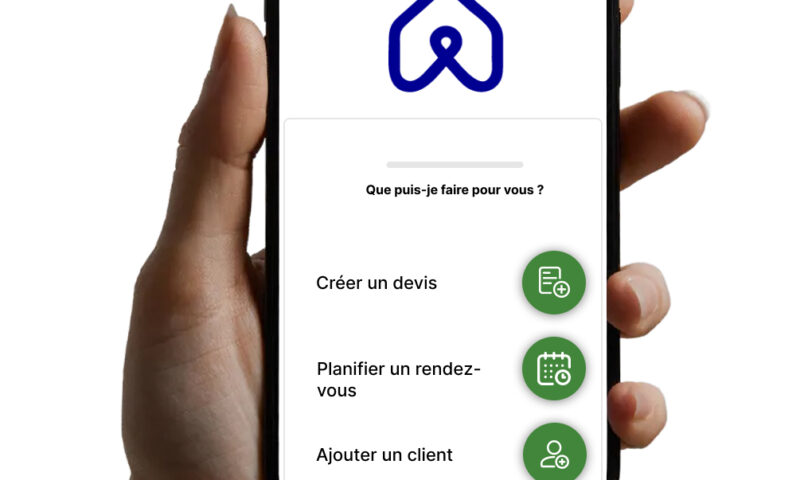Ne sacrifions pas le temps d’un repas d’affaires
Créé le 25/08/2025
Modifié le 26/08/2025
Rencontre avec Léa Ben Zimra
Et si pour négocier avec un client, on prenait le temps de partager un repas ? La proposition pourra paraître saugrenue en cette période où l’on court après le temps, où le moindre frais professionnel est scruté à la loupe. C’est pourtant ce que Léa Ben Zimra préconise en ayant même conçu Populence Academy, une formation pour optimiser au mieux ce temps d’échange informel qu’on a tendance à sacrifier.
- Pouvez-vous, pour commencer, pitcher Populence Academy ?
Léa Ben Zimra : Populence Academy propose une formation au repas d’affaires, certifiée Qualiopi – une certification qui assure que la prestation correspond au niveau attendu par le référentiel national. Populence Academy s’adresse spécifiquement aux équipes commerciales en partant d’un constat : l’impact positif des repas d’affaires sur les négociations commerciales, leurs retombées. Malheureusement, cet impact est encore le plus souvent sous-estimé. À tort, on considère qu’un repas d’affaires est une perte de temps et d’argent. Pourtant de nombreuses recherches en sciences humaines et sociales l’attestent : partager un repas concourt à créer une relation de confiance, à accélérer la négociation, à la conclure par la signature d’un contrat, quand cela ne permet pas tout simplement de lever des tensions. De fait, rien de tel que de partager un repas quand on a le sentiment de ne pas/plus se comprendre. On est alors plus enclin à l’empathie et, donc, à comprendre le point de vue de l’autre.
- À qui s’adresse votre formation ?
L.B.Z.: Aux juniors des équipes commerciales. Pourquoi ? Parce que sous la pression de leur entreprise, ils ont tendance à rechercher la performance, à aller vite, trop vite, en oubliant à mon sens l’essentiel : prendre le temps d’écouter le client, de construire une relation de confiance. Or, quoi de mieux que le partage autour d’un repas pour le faire ? Nul besoin d’y consacrer un gros budget : à défaut d’un repas, ce peut-être un café ou un afterwork. Ce qui compte, c’est ce temps de partage.
- En quoi consiste concrètement votre formation ? En un cours in situ, autour d’une table, le temps d’un repas ?
L.B.Z.: [Sourire]. Pas exactement. Populence Academy se décline en trois temps. Le premier est une introduction à l’histoire du repas gastronomique : jusqu’au 18e siècle, celui-ci est réservé aux sphères diplomatiques et aristocratiques, avant de tomber dans le domaine public à la faveur de la révolution industrielle et de la création des restaurants modernes.
- Dissipons un malentendu : aujourd’hui, par « repas gastronomique », il ne faut pas entendre nécessairement unrepas fastueux et coûteux, entouré d’un cérémonial, mais un repas autour d’une table…
L.B.Z.: Non, en effet. Comme le rappelle bien l’ancien chef cuisinier de l’Élysée Guillaume Gomez, la gastronomie, c’est du quotidien : elle peut se définir comme l’art de partager un repas en portant un soin à la qualité des produits, à la manière de les cuisiner, d’accorder les mets, de les savourer. Contrairement à une idée reçue, le repas gastronomique n’est donc pas réservé aux restaurants étoilés !
- Je ne résiste pas à l’envie de souligner une autre dimension, qu’on escamote, à savoir, la table, le fait de se retrouver autour de ce mobilier. C’est précisément, au plan symbolique, quand la table des négociations est brisée, renversée, qu’il y a crise comme le dit bien l’étymologie du mot « banqueroute » (de l’italien « bancarotta » littéralement « banc rompu »). De sorte qu’on peut considérer que la première chose à faire, pour surmonter une crise, c’est de restaurer cette table -avant de « se restaurer » soi-même… - et de se réunir autour pour amorcer des négociations.
L.B.Z. : C’est d’autant plus vrai s’il s’agit d’une table de repas et non d’une simple table de réunion. Car alors on converse plus librement, en ne s’interdisant pas de se remémorer des souvenirs personnels, de partager des émotions gustatives…
- Revenons-en à votre formation. En quoi consistent ses deux autres temps ?
L.B.Z.: Le deuxième est consacré au protocole du repas appliqué au monde des affaires et ses alternatives, entre le petit déjeuner, la pause-café, le cocktail, etc. J’insiste sur l’importance de la communication non verbale : au cours d’un repas, on dit bien plus de soi et de son entreprise à travers ne serait-ce que le choix du lieu, de la cuisine, etc. Cela peut paraître anodin, c’est en réalité autant de leviers d’influence. Le cadre commercial doit se garder de monopoliser la parole ; ainsi que je l’ai dit, il doit être davantage dans l’écoute.
Naturellement, beaucoup de cadres commerciaux ont l’habitude des déjeuners d’affaires. Mais le plus souvent, ils le conduisent de manière approximative sinon intuitive. La formation que je propose vise à leur faire prendre conscience de tout ce qui se joue, consciemment ou pas, de façon à en optimiser l’impact sur le cours de la négociation.
Le 3e temps de la formation porte sur la culture générale, car, bien évidemment, au cours d’un repas d’affaires, on ne parle pas exclusivement business ! Pour combler un moment de flottement, le premier réflexe est d’aborder la météo, l’actualité sportive… Rien qui soit susceptible de vous distinguer. Dès lors qu’on a un minimum de connaissance en gastronomie, qu’on connaît un producteur ou un produit à recommander, autant le valoriser. Cela sera cohérent avec le contexte du repas.
- Reste un problème pratico-pratique sur lequel j’aimerais avoir votre avis : le fait que des personnes attablées parlent plus que d’autres et prennent donc du retard dans la progression du repas… Comme gérer cette différence de rythme ?
L.B.Z. : Comment progresser dans le repas, passer d’un plat à l’autre ? Comment gérer aussi les personnes qui auront tendance à s’étendre en faisant perdre de vue l’objectif du repas ? Ce sont autant de cas pratiques que nous abordons. Certes, il importe de créer un climat de confiance, donc de convivialité, mais il s’agit aussi et surtout d’avancer dans une négociation et, donc, de savoir recentrer la discussion.
- Comment en est-on arrivé dans un pays comme la France qui peut s’enorgueillir d’avoir obtenu l’inscription du « repas gastronomique » sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, à devoir former des professionnels au repas d’affaires ? Comment l’expliquez-vous ? Quels sont donc les freins, obstacles à sa valorisation par les entreprises ?
L.B.M. : Pour enseigner depuis 2017 auprès de publics francophones, et pas seulement français, je constate que les internationaux sont plus intéressés par la gastronomie et son histoire que les Français eux-mêmes. Au prétexte que cela fait partie de notre culture, de notre savoir-vivre, nous n’y prêtons pas plus autant d’attention. Un peu comme ces Parisiens qui n’ont pas encore visité le patrimoine de la capitale au prétexte qu’ils auront toujours l’occasion de le faire un jour, à la différence d’un touriste. De même, pour la gastronomie, on se dit que c’est à portée de main, du moins en termes de déplacement. À quoi s’ajoute manifestement un conflit générationnel. Pas plus tard que ce matin, des Coréens me demandaient si les jeunes Français mangeaient eux-aussi devant leur ordinateur ? Naturellement, je ne pointerai pas nos jeunes, plutôt un environnement familial qui ne valorise plus aussi souvent le repas pris en commun. Chacun mange en décalé, les enfants comme les parents, dès lors que les deux travaillent à différents horaires. Du fait de l’allongement des distances domiciles-travail, on se lève tôt le matin, on rentre tard le soir ; on n’a plus le temps ou l’énergie pour faire la cuisine. C’est pourquoi je m’en remets à l’entreprise pour qu’elle contribue à faire prendre conscience de l’importance du repas, fût-ce pour les besoins de ses négociations commerciales. Ce qui me rend optimiste, c’est l’accueil réservé à la formation que je propose, à différents postes de responsabilité d’ entreprises de tout secteur.
- Sauf que ces mêmes entreprises - c’est ce que vous me disiez en amont de cet entretien - tendent à remettre en cause le repas professionnel…
L.B.Z.: C’est vrai et il y a plusieurs raisons à cela. Pour beaucoup, je l’ai dit, ce serait une perte de temps et d’argent. J’espère vous avoir démontré le contraire. D’autres, parfois les mêmes, invoquent des raisons de compliance pour décliner une invitation. Qu’à cela ne tienne, on peut toujours organiser des moments différents comme, par exemple, une matinale avec du contenu : les chiffres clés d’un secteur d’activité, la présentation d’un nouveau produit, d’une nouvelle technologie, un speaker inspirant, etc. Autant d’ingrédients qui n’empêchent pas de donner lieu à des échanges plus informels lors de la pause-café ou du cocktail.
- Les entreprises n’ont-elles pas été échaudées par des abus – la demande de remboursement de repas injustifiés ou coûteux ?
L.B.Z.: Le fait est, il y a eu des abus. Mais ils ne sauraient justifier une remise en cause du repas d’affaires ou de multiplier les procédures de contrôle. Sachons faire aussi confiance aux équipes commerciales.
Quelque chose permettrait à mon sens de lever les réticences des entreprises : des performance du repas au regard de la productivité. À ma connaissance, aucune entreprise n’a communiqué à ce jour sur le chiffre d’affaires généré par des repas d’affaires, le taux de transformation d’une proposition commerciale en une vente, un contrat ; l’impact sur le recrutement et la fidélisation de clients… Autant de données qui seraient sans doute instructives.
- N’y aurait-il pas cependant une contradiction à valoriser ce qui se joue de manière informelle au cours d’un repas d’affaires en le quantifiant, l’objectivant au moyen de ces indicateurs de performance ? Ne devrait-on pas assumer le risque de ne pas savoir ce qui résultera d’un temps de repas partagé ? S’en tenir à la conviction qu’il en ressortira toujours quelque chose, à plus ou moins long terme…
L.B.Z.: La confiance n’exclut pas le contrôle, encore moins l’évaluation. Si on veut convaincre des entreprises de changer leur attitude, il faut pouvoir fournir à leur dirigeant des preuves, des arguments objectifs. C’est pourquoi, pour ma part, je m’emploie, à appuyer ma formation sur les acquis des recherches en SHS.
- Au-delà des repas d’affaires, ne s’agirait-il pas de valoriser plus généralement, au sein des entreprises, le temps du repas des salariés ?
L.B.Z. : Si, bien sûr ! Une entreprise a tout intérêt à laisser ses salariés profiter de leur pause-déjeuner. Il en va de leur bien-être et, donc, de leur santé. De même pour la pause-café : on le sait, elle est propice à des échanges informels entre collaborateurs, qui peuvent être fructueux.
- Soit le fameux « effet cafétaria »…
L.B.Z.: En effet. Dans un cas (la pause-déjeuner) comme dans l’autre (la pause-café), on partage des informations qu’on mettrait plus de temps à collecter par emails. La productivité ne s’en trouve qu’améliorée !
Et vous, qu'est-ce qui vous a prédisposée à promouvoir ainsi le repas en général et le repas d'affaires en particuier ?
L.B.Z. : Les souvenirs d’enfance les plus heureux que je garde, ce sont les moments passés à partager un repas en famille ou au restaurant. Mon cursus professionnel m’a d’abord amenée à travailler pour de grandes maisons de luxe, sans me préoccuper alors plus que de cela de l’importance du repas. C’est en effectuant un stage de deux semaines dans les cuisines de Cyril Lignac, que le déclic – un choc émotionnel ! – s’est produit. Je me suis rendue compte que la vie professionnelle que je menais me faisait passer à côté de l’essentiel, qu’il me fallait partager l’importance de ces moments de joie, de bonheur que procurent un repas, avec la conviction qu’ils n’étaient pas réservés à une élite mais accessible à tous, de quelque milieu social qu’on soit. Nous pouvons tous nous remémorer des repas préparés par un parent ou grand-parent, ou partagés dans un restaurant. Nous courrons aujourd’hui en quête de bonheurs illusoires alors que nous avons à portée de main quelque-chose de précieux : la possibilité de partager du temps avec des personnes qui nous sont chères, autour d’un bon repas.
L’idée de créer une formation a germé en 2020 durant la crise sanitaire liée au Covid-19. Durant cette période, toute mon activité de conseil en communication s’est stoppée net. Je me suis alors formée en ingénierie pédagogique, en travaillant avec des écoles de commerce – l’ESSEC, NEOMA – qui m’ont amenée à pousser plus loin encore mes travaux et recherche. C’est ainsi que j’ai découvert les ouvrages de Jacques Attali sur l’histoire de l’alimentation, de Lionel Bobot sur les stratégies de négociation, de Claude Fischler sur la sociologie alimentaire et de tant d’autres. Tous à leur façon m’ont fait prendre conscience que la gastronomie participait d’une compétence relationnelle.
Journaliste
En savoir plus