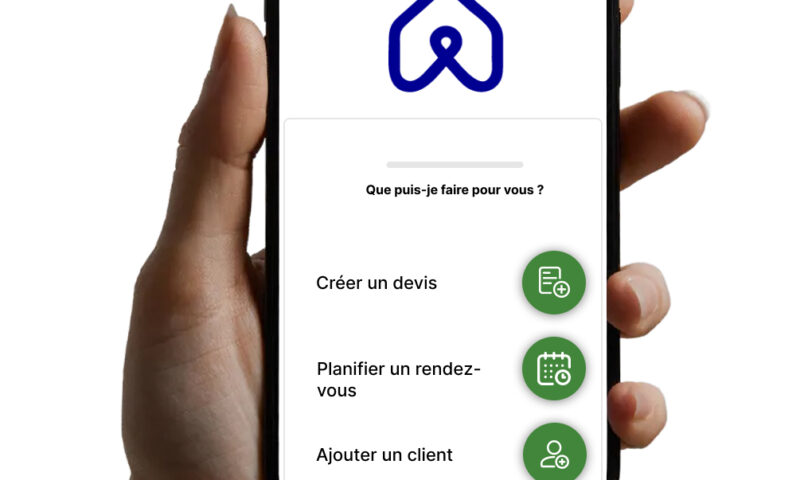« L’innovation fait-elle progresser l’idée de progrès ? »
Créé le 26/03/2018
Modifié le 07/03/2022
Telle était la question abordée par le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein, dans le cadre de sa conférence de clôture aux deuxièmes Rencontres Innovation & Sciences des Étudiants de l’ENSTA ParisTech (RISE²).
Qu’est-ce qui vous a déterminé à proposer cette réflexion en guise de conférence de clôture ?
La notion d’innovation est utilisée désormais en toutes circonstances – elle figure d’ailleurs dans le déroulé de RISE² (Rencontres Innovation et Sciences des Etudiants de l’ENSTA ParisTech) -, mais sans qu’on s’interroge toujours sur le pourquoi de son succès. J’ai donc voulu questionner cette situation, non pas tant de manière provocante que critique, au sens kantien sinon platonicien du terme : en m’interrogeant sur ce qu’on met exactement derrière cette notion. Pour ce faire, je suis parti de deux constats. Le premier concerne les projets qui ont été présentés au cours de la journée dans le cadre du salon des innovations : la plupart – c’est le cas de celui qui a été distingué par le prix Coup de cœur – reposent sur le recours au big data, présenté comme la grande révolution en cours, y compris pour les activités proprement scientifiques.
Pourtant, la physique moderne, pour ne prendre que cet exemple, est née avec Galilée et s’est développée avec Newton quasiment en l’absence de données, comparativement à aujourd’hui. Quand, en 1604, Galilée énonce la loi de la chute des corps (loi suivant laquelle tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide), il ne dispose d’aucun moyen de reconstituer le vide – il y a même des controverses autour de l’existence de celui-ci. Quant aux rares données empiriques, elles semblent contredire Galilée : les corps tombent dans l’atmosphère à des vitesses qui dépendent de leur masse. La loi qu’il énonce ne s’en révélera pas moins juste.
Imaginons maintenant – c’est l’hypothèse que j’ai soumise à mon auditoire des RISE² – que nous enregistrerions le comportement de tous les corps, lourds ou légers, qui tombent dans l’atmosphère, avec ou sans parachute. Un logiciel serait-il capable d’en déduire cette fameuse loi de Galilée ? La réponse est sans doute non. Preuve que l’intelligence humaine, à même de produire un savoir scientifique, ne consiste pas seulement à amasser et analyser des données pour en dégager des lois. L’effort de théorisation peut s’affranchir d’un recueil préalable de data, par exemple en ayant recours à des « expériences de pensée ». Et aujourd’hui encore, il est illusoire d’imaginer, quoi qu’en disent certains, que le geste théorique d’un Galilée et de tous ces autres illustres savants qui lui ont succédé, n’ait plus de raison d’être, que le réel pourrait se livrer à nous, non plus par des lois qui le décriraient, mais au travers des nombres et des données numériques qu’on exploiterait en masse.
– Quel était votre second constat ?
D’après le sociologue Gérald Bronner, qui s’est employé à retracer la diffusion du mot innovation, celui-ci se sera imposé en un laps de temps rapide, en pénétrant de très nombreux secteurs de la société, au point de devenir un mot totem. Un phénomène auquel les écoles d’ingénieurs n’ont pas échappé : du temps de mes études à Centrale, dans les années 80, jamais un professeur n’avait parlé d’innovation. Il était plutôt question d’ « invention », de « découverte », d’ « application », de « brevet », etc. Non que le mot d’innovation n’existât pas. Il est en réalité réapparu dans les années 90, pour connaître le succès que l’on sait.
Dans le même temps, le mot de Progrès a connu un destin inverse : il a commencé par perdre sa majuscule, dans les années 70, avant que la fréquence de son usage ne décline. Le croisement des courbes relatives à la diffusion des deux termes intervient au début du XXIe siècle. Il est significatif de constater que c’est au cours des années 2007-12 que le mot progrès disparaît des discours publics.
La question se pose : comment se fait-il qu’un mot qui a été aussi structurant dans notre vision de la modernité a pu s’effacer aussi rapidement ? Une réponse possible consiste à considérer que le changement n’est qu’apparent, que les deux termes – innovation et progrès – se valent. En réalité, une telle rhétorique ne rend pas vraiment justice aux différences de vision du temps que l’un et l’autre sous-tendent.
Pour préciser mon propos, je renvoie au rapport de suivi du programme-cadre de recherche et d’innovation, dont s’est dotée l’Union européenne à l’horizon 2020, pour répondre aux défis auxquels elle doit faire face (le réchauffement climatique, l’épuisement des ressources, le vieillissement de la population,…). Exposé en une cinquante de pages et traduit en différentes langues, ce rapport présente la particularité de mentionner le mot innovation pas moins de 307 fois, mais sans jamais prendre la peine de le définir. Comme s’il était l’évidence même.
Si l’on veut éviter que le monde ne se défasse, nous dit en substance ce rapport, il faut innover ! En d’autres termes, c’est l’état critique du présent qui sert à justifier l’innovation. Une vision qui repose sur l’idée d’un temps corrupteur, au sens où il dégraderait notre environnement.
Or l’idée de progrès s’appuyait sur une tout autre vision du temps, celle d’un temps constructeur, permettant d’imaginer un futur désirable, attractif, crédible – et pas seulement utopique – et d’œuvrer à son avènement. Le progrès avait donc quelque chose de « consolant », au sens kantien du terme : il nous consolait des malheurs du présent en donnant un sens aux sacrifices qu’il oblige à consentir. Au nom du progrès, on pouvait en effet concevoir de se sacrifier dès lors que cela permettait à nos enfants et petits enfants de profiter de conditions de vie meilleures.
Mais si l’idée de progrès est aussi séduisante, comment en expliquer la disparition dans nos discours ? C’est l’autre question qu’il convient de se poser. Est-ce parce que nous avons renoncé à une philosophie de l’histoire, autrement dit une lecture qui lui donne un sens ? Ou est-ce parce que les nouvelles qu’on nous annonce sont trop sombres pour qu’on puisse se projeter dans le futur, forger sur la base de la situation présente un projet suffisamment crédible et attractif pour l’avenir ? Autant de questions dont la conférence de clôture a permis de discuter.
Je m’en tiendrai ici à rappeler la morale de l’histoire, à savoir : si on veut continuer à croire à l’idée de progrès – et je pense qu’il faut le faire – plutôt que de la remplacer par un autre mot, il conviendrait de la reconsidérer en la faisant… progresser. Autrement-dit, en la soumettant à elle-même.
– Je ne résiste pas à l’envie de vous demander si les mots d’innovation et de progrès vous ont inspiré d’instructives anagrammes….
Désolé, mais une anagramme ne surgit pas sous le coup d’une inspiration ! Comme j’ai eu l’occasion de vous le dire dans un précédent entretien [pour y accéder, cliquer ici], elle apparaît sous le regard moyennant une attention particulière. Sans doute que l’innovation en décèle une, fût-elle associée à d’autres mots, mais je n’y ai pas encore réfléchi. En revanche, « l’idée de progrès » en comporte une, qui devrait nous inciter à ne pas y renoncer trop vite. Cela donne en effet le degré d’espoir !
A lire aussi l’entretien avec Raphaël Neymann, élève-ingénieur de première année et présidant l’association qui assure l’organisation des RISE² (pour y accéder, cliquer ici).
Journaliste
En savoir plus