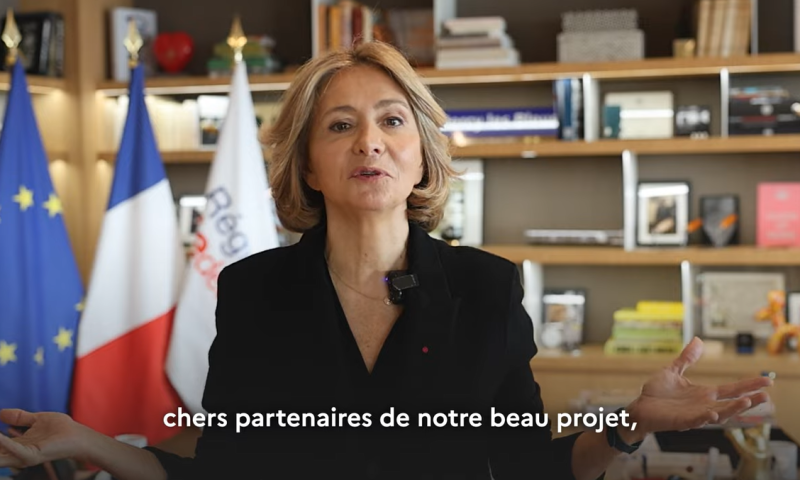Entretien avec Martin Guespereau, DG de l'EPA Paris-Saclay
La Zone de protection naturelle, agricole et forestière (ZPNAF) fête cette année ses quinze ans et met à profit cette anniversaire pour changer de nom : « Terres protégées du plateau de Saclay ». Directeur général de l’EPA Paris-Saclay, Martin Guespereau revient sur le chemin parcouru et la forte mobilisation des acteurs du territoire dans la mise en valeur de ces terres. Il y voit le gage de la pérennité de ce dispositif de protection unique en France.
- Si vous deviez pour commencer caractériser ce que représente l’ex-ZPNAF ?
Martin Guespereau : La première chose qu’il faut rappeler est que la ZPNAF est unique en France : aucun autre dispositif ne protège autant des terres agricoles – en plus de zones naturelles et forestières. La loi qui l’a instituée – la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, – n’est pas sans évoquer la loi du littoral [1986], une loi majeure s’il en est et qui a aussi posé un interdit fondateur d’urbanisation sur le rivage, autre espace précieux et convoité par l’urbanisation.
Rappelons-le, la ZPNAF a été créée au bout d’un long conflit en rapport avec l’urbanisation que le territoire connaissait. De fait, les terres agricoles du plateau de Saclay, réputées pour être parmi les plus fertiles de France et même d’Europe, étaient en train de se faire grignoter par une urbanisation non maîtrisée. Chaque année, de nouveaux mitages s’observaient ici et là. Tant et si bien que la lancement de l’OIN Paris-Saclay à compter de 2010 a eu paradoxalement un effet salutaire en plaçant tout le monde devant son miroir et ses responsabilités, l’obligation de faire un choix en faveur de la protection de ces terres agricoles.
Une évidence quand on aborde le plateau en y venant depuis Paris : si, dès le pont de Boulogne, on traverse des espaces forestiers, en revanche, les premières surfaces agricoles ne sont visibles qu’à partir du plateau de Saclay. C’est dire si elles sont un atout majeur ; on comprend mieux la nécessité de les protéger.
Bien plus, sous l’impulsion de l’OIN, nous – l’EPA Paris-Saclay – en concertation avec les agriculteurs, les élus, le tissu associatif, avons entrepris d’organiser l’espace pour concilier cette protection de terres agricoles – mais aussi naturelles et forestières – avec l’ambition de créer par ailleurs un pôle scientifique et technologique, connecté à Paris via une des lignes du Grand Paris-Saclay, la ligne 18 en l’occurrence. Certes, cela s’est traduit par la consommation de terres agricoles mais aussi par le terme mis au mitage rampant du plateau. La ZPNAF est une composante du même niveau que le cluster et la ligne 18.
Il faut saluer le travail du législateur qui a su élaborer une loi d’une force et d’une clarté dont peu de textes législatifs peuvent se prévaloir. Quinze ans après son adoption, la ZNPAF est toujours là.
- Au-delà des garanties apportées à la protection de terres agricoles, elle est allée de pair avec l’élaboration de programmes d’action, destinés à y mobiliser les acteurs dans la promotion de nouvelles pratiques agricoles, maraîchères, de circuits courts, en plus d’y préserver la biodiversité…
M.G.: Ces programmes d’action visent à s’appuyer sur les forces existantes, mais aussi latentes du territoire. La ZPNAF, ce sont des ha, mais aussi des hommes et de femmes qui l’a font vivre au quotidien. Si elle est aussi innovante, si elle parvient à satisfaire autant les besoins de la population locale, sans renoncer aux marchés de l’export, c’est bien évidemment grâce à ces personnes imaginatives, visionnaires, à l’image finalement des chercheurs et entrepreneurs qui œuvrent sur le plateau de Saclay. C’est encore un cadre de vie, des communes où il fait bon vivre. Seulement, tout cela ne fait pas de bruit, n’est pas sous les feux des projecteurs. Mais peut-être est-ce précisément ce qui fait la force de la ZPNAF.
- Que dites-vous cependant à ceux qui considèrent que ce qu’une loi fait, une autre loi peut le défaire…
M.G.: C’est effectivement un discours qu’on a entendu et qu’on entend encore. D’un strict point de vue technique et formel, il est exact. Seulement, ce n’est plus le sujet. Qui prendrait le risque de remettre en cause tout ce que les acteurs de la ZPNAF ont réalisé en l’espace de quinze ans ? Ce qui me frappe, moi qui ai pris en marche le train de cette histoire, c’est qu’il n’y a pas de leader, de chef clairement identifié ; rien de plus normal en réalité : tout le monde peut revendiquer la paternité de la ZNPAF, en tout cas œuvrer à son dynamisme. C’est le gage d’un projet réussi et pérenne, car beaucoup de monde veille à ce qu’il ne soit pas remis en cause. Et puis cette ZPNAF n’est pas coupée du reste du territoire : déjà, des agriculteurs sont en lien avec le monde de la recherche, les grands centres de recherche, ou avec l’EPA Paris-Saclay dans la conduite des projets urbains. Les flux d’échanges entre ville et campagne sont tout sauf négligeables, que ce soit à travers les circuits courts ou les « cueillettes à la ferme » etc. Je doute que les liens qui se sont tissés puissent être remis en cause. Il n’y a pas plus solide qu’un tissu fait de fils enchevêtrés, entremêlés. C’est plus solide que tout système autocratique qu’on pourrait imaginer par-dessus. Aucun acteur ne peut prétendre le dominer : pas plus l’EPA Paris-Saclay qu’une autre institution ou collectivité.
Bien sûr, cela ne signifie pas l’absence d’un minimum d’organisation. Sans doute faudra-t-il un jour se poser la question du changement de gouvernance de Terre et Cité, association historique du plateau de Saclay – la transformer en syndicat mixte de type PNR, par exemple. Bien d’autres questions vont se poser et devront être traitées : sur les conditions de préservation de la biodiversité, de développement économique du territoire, etc.
Mais le plus important, selon moi, est ce tissu de liens forts. Créé bien avant la ZPNAF, il avait été mis en grande difficulté par le mitage que j’évoquais. Il renait aujourd’hui de plus belle, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
- La ZPNAF s’appelle désormais « Terres protégées ». À quel besoin a répondu ce changement de nom ?
M.G.: Tout ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Et puis, quand un enfant naît, la première chose que l’on fait, est de lui donner le plus beau nom possible – aux yeux de ses parents à tout le moins. La zone protégée est une innovation majeure dont on peut s’étonner qu’elle ait été affublée d’un nom de code si longtemps, commençant de surcroît par un Z. Pour ma part, la première fois que j’en ai entendu parlé, j’ai eu l’impression d’avoir affaire à un programme qu’on gardait secret au seul bénéfice des gens autorisés à en connaître l’existence et l’ambition.
Il est encore plus étonnant qu’il ait fallu quinze ans pour trouver un nom digne à ce dispositif législatif sans équivalent en France, répétons-le. L’appeler Terres protégées, c’est donner une chance à ses ambitions d’être comprises du grand public.
Un signe qui ne trompe pas quant à la volonté de changement : plusieurs noms possibles avaient été proposés, les uns insistant sur la grande échelle, une perception en vue aérienne (« Grands paysages », « Grands espaces », etc. en écho probablement au Grand Paris), les autres privilégiant un tout autre point de vue : celui de la terre. Un mot magique en français puisqu’il sert à désigner aussi bien le sol – avec, ici, sa double base de sable, de limon et d’argile qui en fait la richesse et que l’on retrouve dans la toponymie locale, et sa double pierre de meulière et de grès qu’on retrouve dans les fermes – et la terre travaillée depuis des lustres par les paysans, au point de faire territoire.
Quant au mot de « Protégées », il répond bien au souci de ne pas mettre ces terres sous cloche, mais d’œuvrer à leur préservation, avec la garantie de pouvoir se projeter dans l’avenir. La protection, c’est ce que l’on doit à tout ce qui aspire à grandir, à se développer : un enfant ou, comme ici, des terres agricoles. Ce qui suppose de fixer un cadre dans lequel elles pourront se développer sans trop de risques.
Au final, tout le monde s’est reconnu dans ce nouveau nom de « Terres protégées ». Certes, on a aussi parlé de « Terres précieuses », le titre d’ouvrages et d’un film de Martine Debiesse, qui s’apprête à publier un autre ouvrage sur l’ex-ZPNAF. Mais malgré toute la beauté que contient ce mot – précieuses -, il me semble qu’il ne prenait pas aussi bien l’enjeu d’une protection qui contribue au futur de ces terres. Juridiquement parlant, « protégées » est le terme adéquat. Et c’est effectivement le reflet de ce qu’on entreprend ici à l’égard de ces terres.
Personnellement, je me réjouis que nous ayons deux mots, juste deux, qui disent bien de quoi il retourne. On n’utilisera plus d’acronyme avec le risque de rester dans un entre-soi. Désormais, on appellera ces terres par un nom digne de leur vocation.
- Que dites-vous à ceux qui craignent qu’à force de les protéger on ne jette pas plus de passerelles entre elles et d’autres univers, à commencer par celui des start-up, un monde qui étonnamment a fait sien plusieurs termes du lexique agricole – « jeune pousse », « incubateur », « pépinière »… - attestant d’affinités possibles… ?
M.G.: Des agriculteurs le disent eux-mêmes : ils veulent appartenir à cet univers. Paris-Saclay, ce sont 150 start-up créées par an, des start-up technologiques principalement – c’est ce qui en fait d’ailleurs la valeur, car ce sont les plus difficiles à créer et pérenniser -, dans différents domaines, dont celui des life sciences. On commence à mesurer à quel point l’arrivée d’AgroParisTech et de l’Inrae et, à l’autre bout de la chaine, de Servier, en même temps que de la fac de biologie-pharma-chimie, la même année 2023, a fait faire un virage de Paris-Saclay. Tant et si bien qu’on peut dire que les life sciences y ont pris leur envol. Ce qui est très encourageant pour un aménageur comme l’EPA qui a pour mission d’affecter le foncier dont il dispose, à différentes fonctions. En cette entrée 2025, nous venons d’allouer 1,5 ha à AgroParisTech pour que ses étudiants puissent mettre les mains dans la terre, mais aussi faire de la médiation scientifique auprès des scolaires.
En bref, les mondes qui composent Paris-Saclay interagissent déjà plus qu’on ne le croit. Il est d’ailleurs frappant de voir comment les laboratoires sont eux-mêmes en train de se parler, sans le dire ouvertement, pour créer, qui des partenariats, qui des unités mixtes, qui des chaires scientifiques. Il ne se passe pas un jour sans que des liens nouveaux se créent, sans qu’on ait eu besoin de les planifier. En un certain sens, Paris-Saclay nous échappe et c’est très bien ainsi. Il n’en va pas autrement des Terres protégées, qui, après tout, appartiennent à tout le monde, chacun ajoutant un fil de plus dans ce tissu déjà riche qui, j’en suis sûr, garantit la force et, donc, la pérennité de ces terres.
Journaliste
En savoir plus