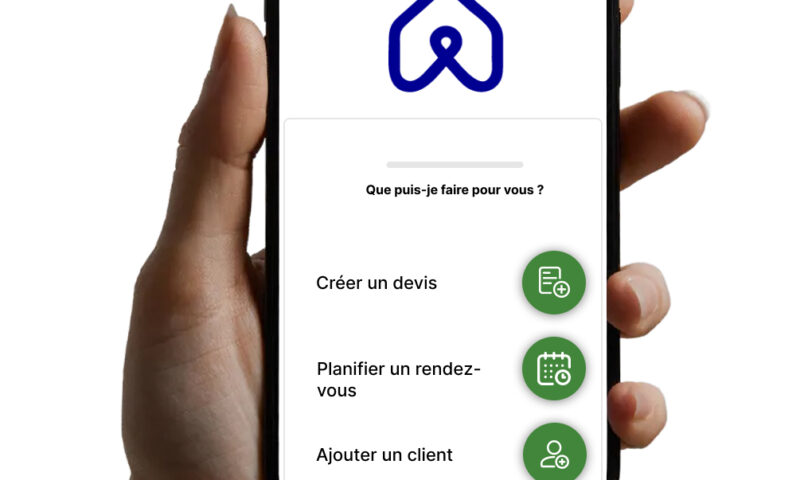Le startupper, cet explorateur des temps modernes.
Créé le 13/01/2018
Modifié le 08/03/2022
Directeur du Master Innovation technologique & entrepreneuriat de Polytechnique, que nous avons déjà eu l’occasion d’interviewer, Bruno Martinaud vient de rééditer son ouvrage publié il y a cinq ans, Start-up. Précis à l’usage de ceux qui veulent changer le monde… et parfois réunissent ! (éditions Pearson). Une version entièrement remaniée en réalité, pour tenir compte de la nouvelle donne introduite par la digitalisation, mais aussi convaincre davantage le startupper des vertus de l’exploration…
– Vous venez de rééditer un ouvrage paru il y a cinq ans. Il s’agit en réalité de bien plus que d’une réactualisation…
En effet, la première édition remontait à 2012. Lorsque les éditions Pearson m’ont recontacté pour m’en proposer une réédition, j’avais dans un premier temps suggéré de reprendre plusieurs chapitres pour traiter de l’entrepreneuriat comme on en parle aujourd’hui. Mais en entrant dans la phase d’écriture, force m’a été de constater qu’il me fallait en réalité réécrire l’ensemble de l’ouvrage. De là d’ailleurs le parti pris d’en changer jusqu’au titre [le précédent s’intitulait Start-up : anti-bible à l’usage des fous et des futurs entrepreneurs].
J’ai été aidé en cela par la série de Moocs que j’ai entretemps réalisés pour les besoins d’un parcours de formation à l’entrepreneuriat. Une demi douzaine de Moocs totalisant une dizaine d’heures, disponibles en anglais et en français. Un exercice particulier qui s’est révélé très intéressant, mais qui a aussi exigé un important travail de préparation. La vidéo a tendance à mettre en exergue les moindres défauts et failles, toutes ces petites compromissions intellectuelles qu’on s’autorise quand on enseigne. Face à un auditoire, il y a en effet toujours moyen de faire passer des approximations ! Au contraire, le fait de découper le cours en segments synthétiques, en étant de surcroît seul devant la caméra, n’autorise plus aucun de ces faux-fuyants auxquels on a recours en situation normale d’enseignement. L’expérience a donc été un peu douloureuse : la caméra n’est décidément pas l’ami de l’enseignant et tolère difficilement l’improvisation ou l’expression d’hésitations – elle impose de s’appuyer sur des textes aussi bien écrits que possible, et de les répéter avant.
Mais, au final, cette expérience aura aussi été féconde : en ne laissant aucun échappatoire, cette même caméra oblige à travailler davantage le contenu, jusqu’au moindre détail. Les modules étant relativement courts, il fallait en venir à l’essentiel.
Au total, cette expérience m’aura mobilisé deux ans et demi – elle s’est terminée à la fin de l’année 2016. Au-delà de l’apprentissage des contraintes de l’enregistrement devant une caméra, elle aura nourri ma réflexion sur ce que pourrait être un modèle pédagogique pour la formation à l’entrepreneuriat technologique dans l’espace-temps d’un cours. J’en suis déjà venu à en substituer un certain nombre parmi les plus magistraux par des parcours en ligne, complétés par des séquences en ateliers.
– Est-ce à dire que votre ouvrage doit beaucoup à cette expérience…
Non, ce n’est pas ce que je voulais dire. Ecrire un livre et réaliser un Mooc sont deux exercices différents et néanmoins complémentaires. Cette seconde édition, je l’ai conçue tout à la fois comme un moyen d’actualiser ce que j’avais envie de partager sur l’entrepreneuriat, lequel a beaucoup changé depuis 2012, et d’explorer de nouveaux sujets. Ce que permet précisément de faire l’exercice de l’écriture : quand on écrit, on réfléchit, on cherche… C’est en cela que c’est un exercice complémentaire avec la réalisation d’un Mooc, lequel s’inscrit d’abord dans une démarche de formation.
– C’est une bonne nouvelle que vous nous apportez-là : dans un monde saturé de numérique, de réseaux sociaux, de big data, il y aurait donc encore place pour le temps de l’écriture de livres et, donc, de la lecture…
J’en suis convaincu : le livre a encore toute sa place aussi bien dans l’intérêt de l’auteur que dans celui du lecteur, auquel il offre un espace de réflexion qui n’est pas celui des contenus en ligne ni des autres espaces sur lesquels on peut partager des idées, mais en allant rapidement à l’essentiel. Avec un livre, on s’autorise à prendre le temps, à suivre le cours sinueux d’une réflexion… Encore une fois, cela est vrai aussi bien pour l’auteur que pour le lecteur. J’en ai acquis la conviction durant mes années de classes préparatoires, les années durant lesquelles j’ai vraiment commencé à me passionner de lecture…
– Dans votre livre, vous démontrez d’ailleurs l’intérêt de l’expérience de l’écriture d’un ouvrage, en montrant l’analogie qu’on peut y voir avec l’expérience même de l’entrepreneuriat innovant… Je pense à ce brouillon d’un passage de Madame Bovary que vous reproduisez au tout début du livre…
 (Sourire). Quand vous lisez ce roman pour la première fois, vous êtes à mille lieues d’imaginer toute la souffrance que l’auteur a dû éprouver pour parvenir à la phrase parfaite, tous les efforts qu’il a dû consentir, les hésitations qui ont pu être les siennes. La style de Madame Bovary paraît si assuré, l’expression si fluide, les descriptions des scènes si justes, sans compter cette lucidité du narrateur et la trame dramatique qui se déploie imperturbablement, en filigrane. Le brouillon de l’extrait que je reproduis montre qu’il n’en est rien ! Madame Bovary a été une « épreuve » pour son auteur, tout comme peut l’être la création d’une start-up, avec ses hauts et ses bas, ses doutes et l’éventuel pivot à opérer. Comme le romancier, le startupper est aussi dans un acte de création : il doit opérer l’alchimie entre des éléments de différentes natures [ci-contre, la reproduction d’un extrait du brouillon, avec l’autorisation de la Bibliothèque de Rouen].
(Sourire). Quand vous lisez ce roman pour la première fois, vous êtes à mille lieues d’imaginer toute la souffrance que l’auteur a dû éprouver pour parvenir à la phrase parfaite, tous les efforts qu’il a dû consentir, les hésitations qui ont pu être les siennes. La style de Madame Bovary paraît si assuré, l’expression si fluide, les descriptions des scènes si justes, sans compter cette lucidité du narrateur et la trame dramatique qui se déploie imperturbablement, en filigrane. Le brouillon de l’extrait que je reproduis montre qu’il n’en est rien ! Madame Bovary a été une « épreuve » pour son auteur, tout comme peut l’être la création d’une start-up, avec ses hauts et ses bas, ses doutes et l’éventuel pivot à opérer. Comme le romancier, le startupper est aussi dans un acte de création : il doit opérer l’alchimie entre des éléments de différentes natures [ci-contre, la reproduction d’un extrait du brouillon, avec l’autorisation de la Bibliothèque de Rouen].
Je tiens à préciser que ce rapprochement n’est pas un simple artifice de pédagogue. Madame Bovary est un de mes romans préférés. Je l’ai lu et relu près d’une demi douzaine de fois, toujours avec le même bonheur. Chaque lecture révèle des détails qui m’avaient échappé jusqu’alors. Bref, ce roman est d’une richesse aussi grande que peut l’être la success story d’une start-up, qui, elle aussi, repose sur des ressorts très variés.
Commencer la réédition de mon propre ouvrage par un parallèle avec ce qu’un écrivain peut endurer, même quand il s’appelle Flaubert, était, au-delà de l’hommage au travail d’écriture et à la lecture, une manière aussi de montrer combien le rapprochement entre des univers aussi différents a priori (celui de la littérature et celui de la création d’entreprises innovantes) peut être fécond.
– Cette référence à une œuvre littéraire est aussi une manière de donner le ton à l’ensemble de l’ouvrage, qui se veut autre chose qu’un manuel ou ce que peut proposer la littérature consacrée aux start-up et à l’innovation entrepreneuriale…
 En effet. Il ne s’agit ni d’un manuel, ni d’un ouvrage prodiguant des conseils pour réussir sa start-up, ni d’un guide des bonnes pratiques. Comme dans l’édition précédente, je prends d’ailleurs le temps d’examiner des contre-exemples. Ce qui m’importe avant tout, c’est d’apprendre à prendre du recul par rapport à son propre projet et à bien appréhender son environnement. Naturellement, un startupper se doit d’écouter les conseils qu’on lui prodigue et de prendre connaissance de bonnes pratiques, mais sans s’interdire ensuite d’opter pour une tout autre voie, étant entendu que faire l’inverse de ce qu’on vous dit, cela s’apprend. Si, donc, mon ouvrage prétend apprendre quelque chose, c’est cette aptitude à envisager l’entrepreneuriat innovant comme une exploration, dont l’issue (en l’occurrence, l’échec ou la réussite du projet, sans compter la possibilité d’en changer complètement la nature) n’est pas, par définition, connue à l’avance. Aussi, je ne propose ni recette ni mode d’emploi à proprement parler. J’expose l’état de ma réflexion et de mon expérience de l’entrepreneuriat comme démarche exploratoire. Charge au lecteur de s’approprier ce que j’écris pour mieux étayer son propre point de vue. Un romancier n’en attend pas moins du sien : l’histoire et les personnages qu’il imagine n’ont pas d’autre vocation à nourrir l’imaginaire du lecteur, selon ses propres sensibilité et attentes [en illustration : Bruno Martinaud aux côtés de Steve Ahn, entrepreneur sud-coréen, lors d’une Masterclass, en février 2017].
En effet. Il ne s’agit ni d’un manuel, ni d’un ouvrage prodiguant des conseils pour réussir sa start-up, ni d’un guide des bonnes pratiques. Comme dans l’édition précédente, je prends d’ailleurs le temps d’examiner des contre-exemples. Ce qui m’importe avant tout, c’est d’apprendre à prendre du recul par rapport à son propre projet et à bien appréhender son environnement. Naturellement, un startupper se doit d’écouter les conseils qu’on lui prodigue et de prendre connaissance de bonnes pratiques, mais sans s’interdire ensuite d’opter pour une tout autre voie, étant entendu que faire l’inverse de ce qu’on vous dit, cela s’apprend. Si, donc, mon ouvrage prétend apprendre quelque chose, c’est cette aptitude à envisager l’entrepreneuriat innovant comme une exploration, dont l’issue (en l’occurrence, l’échec ou la réussite du projet, sans compter la possibilité d’en changer complètement la nature) n’est pas, par définition, connue à l’avance. Aussi, je ne propose ni recette ni mode d’emploi à proprement parler. J’expose l’état de ma réflexion et de mon expérience de l’entrepreneuriat comme démarche exploratoire. Charge au lecteur de s’approprier ce que j’écris pour mieux étayer son propre point de vue. Un romancier n’en attend pas moins du sien : l’histoire et les personnages qu’il imagine n’ont pas d’autre vocation à nourrir l’imaginaire du lecteur, selon ses propres sensibilité et attentes [en illustration : Bruno Martinaud aux côtés de Steve Ahn, entrepreneur sud-coréen, lors d’une Masterclass, en février 2017].
– Votre livre se lit avec plaisir. Pour autant, ce n’est pas un roman au sens où il comporte des illustrations, des schémas et même quelques équations…
Dès lors que j’envisage la démarche de l’entrepreneur comme une exploration, le risque aurait été grand de digresser en s’attardant sur telle ou telle piste, au détriment du moindre raisonnement. Or, autant comprendre est un luxe, autant ce dernier est utile. Le livre est donc structuré autour d’une idée : entreprendre, c’est apprendre à se poser les bonnes questions, en acceptant de ne pas avoir toutes les réponses dans l’immédiat – ce sera justement l’enjeu du travail d’exploration. Car si je doute qu’il y ait des solutions toutes faites, je suis intimement persuadé qu’il y a des invariants, une trame de questionnements dont on ne peut faire l’économie car, précisément, elle nourrit ce travail d’exploration.Chaque chapitre reprend donc un questionnement, avec méthode, l’enjeu étant de construire une stratégie, de façon à réduire les risques.
– En creux, vous dessinez les traits d’un entrepreneur innovant, différent de l’image qu’on peut s’en faire spontanément, à savoir : quelqu’un sachant dès le départ ce qu’il veut et qui déploie une stratégie en s’inspirant de méthodes d’innovation et de management… Vous allez jusqu’à inviter à « Se rappeler que créer une entreprise innovante n’est pas un acte rationnel »…
L’entrepreneur doit avoir un raisonnement aussi structuré et logique que possible, mais en sachant dépasser une rationalité première. Et ce, pour le motif que j’ai déjà exposé dans la précédente édition : un projet innovant est toujours une proposition indécidable, dont on ne peut savoir a priori si elle marchera ou pas. La probabilité d’échouer sera toujours supérieure à celle de réussir ; la réflexion en termes de modélisation est donc une perte de temps.
En ce sens, comprendre est bien un luxe. L’entrepreneur – mais cela vaut pour aussi pour un chercheur – est tel un explorateur : il avance en regardant dans toutes les directions, prêt à saisir les opportunités qui se présentent à lui pour, ensuite, progressivement implémenter ce qui marche, sans forcément chercher à comprendre pourquoi il en va ainsi – ce serait une perte de temps. Bref, il agit et modélise après. Ce n’est qu’au fil du temps et, donc, a posteriori qu’il pourra dégager des modèles de compréhension.
Cette posture est contre naturelle pour l’esprit humain, a fortiori pour des élèves évoluant dans un système d’éducation comme le nôtre, qui érige l’aptitude à comprendre comme un critère de sélection. En disant cela, je ne prône pas un dés-apprentissage – ce qu’on a appris dans son parcours scolaire peut être utile – mais une mise en perspective de notre mode classique de raisonnement, en admettant que, face à l’incertitude et à la complexité, il y a des stratégies différentes que la démarche purement rationnelle.
– Etant entendu que l’expérience de l’échec fait partie intégrante de cette démarche d’exploration…
En effet, et quitte à aller encore à rebours de ce qu’on nous a enseigné jusqu’alors. L’échec ne marque pas la fin d’un parcours exploratoire. Au contraire, il en fait partie intégrante, en contribuant à l’enrichir par les enseignements qu’on en tire, mais aussi parce qu’il découle d’une tentative parmi d’autres. Un entrepreneur qui réussit est donc un entrepreneur qui saura intégrer la possibilité de l’échec…
– Dès lors que vous insistez sur cette dimension exploratoire de la démarche de l’entrepreneur, pourquoi ne pas convoquer la notion de sérendipité, une notion qui, comme vous le savez nous est chère… ? [pour en savoir plus, voir la chronique de l’ouvrage que Sylvie Catellin lui a consacré – pour y accéder, cliquer ici].
En fait, je l’évoque car, selon moi, elle est consubstantielle à la démarche d’exploration. L’explorateur ne sait pas s’il va trouver ce qu’il cherche et doit donc être prêt à trouver ce qu’il ne cherche pas. Il doit aussi être capable de capter les signaux faibles. Autant de caractéristiques de la sérendipité. Elle est donc présente dans ma vision des choses. Pour autant, je préfère mettre davantage en avant la dimension exploratoire de la démarche de l’entrepreneur et la rationalité particulière qu’elle implique.
– Soit. Mais alors pourquoi ne pas davantage insister sur les ressources du territoire qu’il est censé explorer ? Au contraire, vous semblez les minorer en écrivant : « Il faut savoir s’associer des compétences, mais pas dans une logique territoriale »… Pourtant, on sait l’importance d’un écosystème pour toute démarche d’innovation entrepreneuriale…
Loin de moi de minorer les ressources du territoire dans lequel évolue l’entrepreneur. Mes longues années passées dans la Silicon Valley m’ont définitivement convaincu de l’importance de l’écosystème dans lequel l’entrepreneur évolue et de la connaissance que celui-ci peut en avoir. En bon explorateur, il fait face à des problématiques complexes, s’aventure dans des territoires qu’il ne connaît pas, dont il ne perçoit pas les frontières ni ne comprend les codes. C’est dire s’il lui faut pouvoir identifier des personnes qui sauront l’aider, le conseiller.
Si je n’ai pas parlé des ressources territoriales, autant que vous l’auriez souhaité, c’est que mon propos était d’abord de m’adresser à des entrepreneurs en tant que personne et moins aux responsables et décideurs de politiques publiques en faveur de l’entrepreneuriat innovant, au sein d’écosystèmes. Et quand même bien suis-je convaincu qu’il s’agit là d’un vrai enjeu, je n’avais pas le sentiment d’avoir des idées novatrices à exposer sur le sujet. D’autant moins que mon ouvrage devait aussi respecter des contraintes de volume et ne pouvait donc prétendre traiter de tous les aspects de l’entrepreneuriat innovant.
– Dans quelle mesure l’expérience de l’écosystème de Paris-Saclay a-t-il néanmoins nourri votre vision de l’entrepreneuriat ?
Faisant partie de l’Ecole Polytechnique, en charge du Master Innovation Technologique & Entrepreneuriat, je suis bien évidemment impliqué dans l’écosystème de Paris-Saclay et en saisis bien le potentiel. Pour l’heure, force est de constater qu’il est encore en construction. L’alchimie qui fera qu’un élève-ingénieur va pouvoir valoriser le résultat de recherche d’un laboratoire en trouvant les compétences et en bénéficiant d’un accompagnement pour son incubation et ses financements, se manifeste déjà comme en témoigne la création de nombreuses start-up sur le Plateau de Saclay. Mais le projet de campus n’en est pas moins encore en cours de concrétisation. C’est une œuvre de longue haleine, rendue compliquée par le fait que chaque institution participant à cet écosystème a son histoire et, donc, une personnalité propre, qui rend les coopérations encore moins naturelles qu’ailleurs. Mais nul doute que si on considère les choses dans une échelle de temps plus longue, d’une à deux décennies, la dynamique de convergence ira en s’amplifiant. Pour l’heure, on voit plus un mouvement brownien qu’une somme d’initiatives allant dans le même sens. Rien de plus normal pour un projet de cette envergure. Et puis, nous ne partons pas de rien. Des résultats ont d’ores et déjà été enregistrés. Nous donnons des cours en commun avec d’autres établissements d’enseignement supérieur de l’écosystème. Nous convions à des master-classes, des représentants de diverses institutions présentes à Paris-Saclay. Sans vous mentir quant à l’ampleur de la tâche et du temps nécessaire, je dirai qu’une dynamique est bel et bien à l’œuvre, dont résultera quelque chose de forcément positif.
– Face au mouvement brownien, sachons être braudéliens en somme…
(Rire) C’est exactement cela !
– Revenons-en à nos startuppers. A trop envisager l’entrepreneur comme un explorateur au singulier, n’escamote-t-on pas la dimension collective de la démarche entrepreneuriale ?
Cette dimension collective est bien sûr essentielle. Le startupper travaille par définition en équipe, ce que je suggère dès le début du livre. La réussite d’une démarche entrepreneuriale est directement corrélée à la diversité des personnes qui composent cette équipe. Toute seule, une personne cherchera à valider ses propres idées, sans les questionner véritablement. Le premier travail de l’entrepreneur est donc de s’entourer de personnes susceptibles d’avoir des points de vue différents et quitte à devoir admettre qu’elles sont plus douées que lui. C’est ainsi qu’il pourra faire pivoter son projet pendant qu’il en sera encore temps.
D’ordinaire, on souligne la nécessité de savoir s’entourer de compétences techniques. C’est effectivement indispensable. Mais cela ne suffit pas. Il faut savoir aussi s’entourer d’intelligences. Car l’entrepreneur a surtout besoin de problem solvers, autrement dit de personnes qui sauront réfléchir librement et exprimer leur point de vue face à un problème donné. Qui n’auront pas peur non plus de quitter leur zone de confort. Un projet entrepreneurial ne consiste en rien d’autre que cela : sortir de sa zone de confort pour explorer d’autres directions et, concrètement, identifier des briques technologiques qui lui seront utiles. Non seulement l’entrepreneur doit savoir s’entourer de problem solvers mais aussi les écouter, en gardant à l’esprit que si un interlocuteur tout autant voire plus intelligent que lui n’est pas d’accord, cela vaut la peine de comprendre les motifs du désaccord. Ce qui suppose bien plus que savoir ne pas se formaliser : avoir une réelle appétence pour la stimulation intellectuelle et le débat contradictoire. Si, donc, une autre solution est proposée, autant prendre le temps de l’examiner plutôt que de chercher à tout prix à défendre la sienne propre. C’est d’autant plus nécessaire que nous ne sommes qu’au début de l’exploration et que l’entrepreneur n’est pas encore en mesure d’être sûr de ce qui marchera ou pas.
– A vous entendre comme d’ailleurs à vous lire, on prend la mesure du fait que l’incertitude, pas plus que l’inconnu, n’est en soit un problème. C’est une réalité avec laquelle on doit composer en sachant juste bien s’entourer et savoir écouter des points de vue différents. Peut-être assèné-je des évidences, mais il me semble pas que ce soit une approche habituelle de l’incertitude inhérente à nos existences en général et à un projet entrepreneurial en particulier…
En effet, l’incertitude est partie intégrante de la vie et autant l’admettre que de faire comme si on maîtrisait en permanence la situation. Pour autant, je ne m’en remets pas à une forme de fatalisme. Le message sous-jacent à mon ouvrage est qu’il existe des stratégies pour naviguer dans un monde incertain sinon inconnu : des stratégies (d’équipe, d’exploration, etc.), qui transcendent les bonnes pratiques et les méthodes qu’on peut lire dans les manuels dédiés à l’innovation entrepreneurial et qui permettent d’avancer réellement.
– « Naviguer » dites-vous. Je comprends mieux en quel sens vous envisagez l’exploration : plus dans un environnement maritime que terrestre…
Exactement ! L’entrepreneuriat doit beaucoup à l’univers des explorations maritimes. A commencer par la notion de capital-risque, développée pour financer les expéditions. Nos startuppers sont à leur façon les explorateurs des temps modernes. Comme les navigateurs d’autrefois, ils explorent des territoires, qui, pour être virtuels, ne les confrontent pas moins à de l’incertitude et de l’inconnu. Naturellement, un écosystème bien ancré dans un territoire est aussi essentiel. Pas moins que les explorateurs d’aujourd’hui, ceux de jadis avaient d’ailleurs besoin de tout un système d’acteurs à même d’assurer non seulement le financement de l’expédition, mais encore l’acheminement des marchandises, le recrutement de l’équipage, etc. Christophe Colomb n’aurait pu naviguer et faire la découverte que l’on sait, s’il n’avait reçu toutes sortes d’appuis participant d’un vaste écosystème. Mais, une fois plongé dans le bain de la création, le startupper doit acquérir sa propre autonomie, tout comme le navigateur ayant largué les amarres.
– Au passage, on peut évoquer bien d’autres termes empruntés par les entrepreneurs sinon manageurs au champs lexical maritime : gouvernance (dérivée de gouvernail) ; réseau (du latin retis, qui signifie filet de pêche) ; surfer… A vous entendre, on pourrait aussi évoquer l’ « art de l’estime », consistant pour les navigateurs d’avant l’invention des instruments d’orientation, à identifier la proximité du littoral par la mobilisation des différents sens… Dans votre cas, cette sensibilité tient-elle à une pratique de la navigation ?
Je n’ai malheureusement plus guère le temps de m’y consacré, mais j’ai par le passé pratiquer un peu la voile, sans pour autant pouvoir prétendre être un navigateur.
– Considérez-vous que les qualités que vous mettez en avant seraient plus présentes chez les entrepreneurs masculins que leurs homologues féminins, et pourraient donc expliquer la moindre représentation des femmes parmi les startuppers ?
Le fait est, les femmes sont encore moins nombreuses à entreprendre et créer des start-up. Une réalité que je ne peux que regretter. Celles que je vois passer surperforment par rapport aux hommes ! Les intelligences que je décris comme caractéristiques de l’esprit entrepreneurial ne sont pas propres aux hommes, loin de là. Elles sont également distribuées entre les sexes. D’autres facteurs – sociologiques, culturels, éducatifs – interviennent pour expliquer les écarts enregistrés quand il s’agit de s’engager dans l’entrepreneuriat. Des facteurs conjecturels, mais à forte inertie. D’abord, à projet équivalent, il reste difficile pour une femme d’acquérir la même crédibilité qu’un homme. Inconsciemment, leurs interlocuteurs poseront sur elle un regard différent. Il lui faut donc faire preuve de davantage de talent pour être repérée et reconnue comme entrepreneure à part entière. Ensuite, les filles sont encore moins nombreuses que les garçons à s’orienter vers une filière scientifique puis une école d’ingénieurs. Elles ont donc moins de chance de faire ensuite de l’entrepreneuriat technologique. Un constat qui vaut pour une école comme l’X, qui ne compte que 12-14% de filles parmi ses élèves-ingénieurs. Or, celles qui ont une vraie vocation scientifique ont tendance à chercher à capitaliser cet avantage en faisant de la recherche plutôt que de l’entrepreneuriat. Ce qu’on ne peut que regretter car c’est une réelle perte pour l’écosystème de l’innovation entrepreneuriale.
– Depuis la première édition de votre ouvrage, un changement majeur est intervenu avec le développement du Big Data et la digitalisation de l’économie. Dans quelle mesure cela change-t-il la donne dans la manière d’envisager l’entrepreneuriat innovant ?
Cela a indéniablement changé la donne au point de faire désormais partie des briques de base de nos enseignements. En 2012, j’avais monté un workshop autour de la programmation informatique, en expliquant à mes élèves que quels que soient les champs qu’ils souhaiteraient investir, le vivant compris, ils ne pourraient prétendre être entrepreneurs s’ils n’avaient aucune notion du codage. Depuis, nous avons étendu ce raisonnement au Big Data et à l’intelligence artificielle. Tous les élèves qui suivent mon Master suivent un workshop de mise à niveau en matière de Big Data, de machine et deap learning. L’objectif n’est pas d’en faire des Mozart en la matière, mais de faire en sorte qu’ils puissent comprendre, d’une part, les enjeux de la science algorithmique et, d’autre part, dans quelle mesure cette l’intelligence artificielle va impacter plusieurs des dimensions de leur projet entrepreneurial : la dimension technologique, bien sûr, mais aussi les dimensions stratégique, managériale,… Il n’y aucun projet innovant qui ne soit impacté par la digitalisation de l’économie. Nous assistons à une vague d’innovations transversales, dont on peut convenir qu’elle est unique dans l’histoire de l’humanité. Jusqu’ici, les innovations émergeaient dans un secteur pour se diffuser ensuite, de proche en proche, selon le mécanisme bien connu de la destruction-créatrice décrit par Joseph Schumpeter. Les destructions d’emplois dans tel et tel secteur étaient compensées par les créations autrement plus nombreuses dans les nouveaux secteurs en émergence. Si l’imprimerie, pour ne prendre que cet exemple, a mis fin au travail de milliers de moines copistes, elle aura permis d’en créer d’autres en nombre bien supérieur tout en engendrant de nouvelles sources de revenus.
Pour la première fois, on assiste à une innovation transversale, qui gagne tous les secteurs simultanément : le commerce, les transports, la communication. Internet en avait été une à sa façon, mais n’avait pas transformé aussi rapidement des pans entiers de l’économie et de la société. Surtout, il n’avait pas impacté jusqu’aux fonctions cognitives de base – ce que les gens font au quotidien : lire des emails, remplir des formulaires, les forwarder – comme le fait la digitalisation. C’est indéniablement une source d’opportunités pour l’entrepreneur, mais aussi de questionnements. Que vont devenir les emplois dont l’essentiel de l’activité est de traiter de l’information ? La numérisation devrait permettre de l’automatiser massivement. Il n’est pas jusqu’aux métiers du monde juridique qui sont concernés : dès lors qu’il sera possible de faire en plus rapide et en mieux ce qui exigeait plusieurs semaines de travail à des assistants juridiques, on peut se demander ce qu’il adviendra de ces emplois qu’on pensait protégés. Le coût des machines tendant asymptotiquement vers zéro, cette tendance à l’automatisation est inéluctable. Il y a donc un enjeu à faire prendre conscience aux élèves qui s’engagent dans l’entrepreneuriat que c’est une source d’opportunités pour eux, mais un motif de réflexion sur ce que sera le travail de demain. Nul doute que la possibilité d’exploiter en temps réel des données induira l’émergence de nouveaux métiers et modèles d’organisation. Pour l’heure, la sectorialisation encore prégnante de notre société empêche de prendre la mesure de cette transversalité de l’innovation liée au digital. Raison de plus pour y sensibiliser nos élèves dès maintenant.
– En même temps, ce qui ressort de la lecture de votre livre, c’est que l’avenir de l’entrepreneuriat innovant appartiendra à ceux qui sont en mesure de déployer des formes d’intelligences proprement humaines…
On peut en effet se demander quels seront les effets de cette digitalisation généralisée sur tout ou partie de la population : contribuera-t-elle à libérer des facultés intellectuelles qui sont plus du ressort de la créativité, de l’intuition, etc. ? Sans exclure d’en reconnaître aussi aux machines elles-mêmes. AlphaGo, le programme Google DeepMind, l’a illustré à sa manière en démontrant la possibilité pour une machine d’inférer une stratégie radicalement nouvelle : aucun grand maître de go n’avait imaginé celle utilisée par AlphaGo pour l’emporter lors de la 2ème partie sur un vrai joueur. Elle fait désormais référence – en l’occurrence, elle consiste à exploiter la 5ème colonne.
– C’est-à-dire ?
Lors des 37 premiers mouvements, Alphago a placé sa pierre sur la 5ème colonne, ce qui n’a pas manqué de choquer la communauté d’experts, qui analysaient en temps réel cette confrontation historique. Depuis 3 000 ans, les stratégies les plus reconnues consistaient à jouer plutôt la 3ème colonne pour conquérir le territoire extérieur, ou la 4ème colonne, pour dominer l’espace intérieur. AlphaGo prenait le contrepied de ces pratiques millénaires en jouant, donc, la 5ème colonne. Les experts étaient persuadés qu’il s’agissait d’une erreur de jugement, car ce choix offrait trop de territoire extérieur à son opposant. Pourtant quinze mouvements plus tard, la guerre pour le contrôle du territoire s’était intensifiée, et la pierre placée par AlphaGo s’est avérée jouer un rôle crucial dans la victoire finale contre Lee Sedol. La machine avait appris de l’homme, mais elle avait également acquis la capacité à faire différemment, et – parfois – mieux.
Mais on peut aussi se dire que le jeu de go est un des seuls espaces où la machine pourra être à l’égal voire supérieure à l’homme. Plus généralement, nous pouvons considérer que nous sommes appelés à vivre à court terme une phase de transition, qui risque de se payer au prix de bouleversements importants, mais qu’à terme, on inventera des espaces d’activité et d’expression proprement humaines, moyennant une refonte de nos modèles éducatifs pour préparer les nouvelles générations à un rapport différent à l’emploi, nos activités étant appelées à être de plus en plus automatisées.
– A vous entendre, j’ai l’impression que vous ménagez la possibilité d’esquisser une 3e voie entre une vision Homme versus Machine, et une vision transhumaniste, pariant sur une transformation de l’humanité, cette 3e voie consistant en un humanisme sachant trouver des alternatives, y compris dans un monde de plus en plus numérique…
C’est exactement cela. Sans être spécialement compétent sur ces sujets, j’ai l’intuition qu’il y a un espace pour permettre à l’intelligence proprement humaine d’exploiter l’intelligence artificielle. Un espace qui permettra d’être encore plus intelligent, plus intuitif comme on le devient en étant en situation de pouvoir rebondir sur l’idée d’un autre. Le fait, donc, de transférer sur la machine certaines capacités cognitives devrait permettre à l’esprit humain d’en développer d’autres comme, par exemple, apprendre à brainstormer, interagir, collaborer avec une intelligence ultraperformante parce que numérique, et faire des choses qu’on n’imagine pas aujourd’hui. Mais tout cela n’est qu’une intuition…
– … d’explorateur navigateur qui, si on file la métaphore, vogue vers une possible terra incognita qu’il se garde de définir à l’avance…
On ne saurait mieux dire.
A lire aussi le premier entretien que Bruno Martinaud nous a accordé – pour y accéder, cliquer ici.
Journaliste
En savoir plus