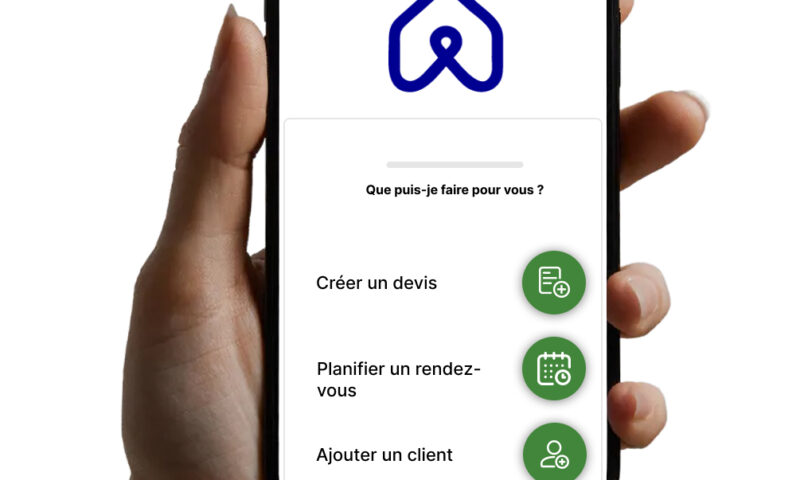Elever des insectes pour le bien de la planète.
Créé le 05/10/2017
Modifié le 09/03/2022
Cycle Farms est une des premières start-up hébergées dans ce qui ne s’appelait pas encore le Food Inn Lab d’AgroParisTech. Et à l’avenir prometteur qui la contraint à quitter… Paris-Saclay. Mais tout en y conservant des attaches. Précisions de son co-fondateur (à droite sur la photo), que nous avions rencontré une première fois lors de l’inauguration de cet incubateur, le 30 mai 2017.
– Si vous deviez de nouveau pitcher Cycle Farms…
 Cycle Farms est une start-up créée en février 2016, sur la base de deux activités. La première consiste à produire et élever des insectes – en l’occurrence la Mouche Soldat Noire (Black Soldier Fly en anglais ou encore Hermetia Illucens d’après sa désignation scientifique) pour le traitement de matières organiques. La seconde découle de la première puisqu’il s’agit d’intégrer la farine d’insecte ainsi produite dans des formulations pour de l’alimentation animale. Cette double activité nous différencie des autres sociétés françaises et européennes investissant le marché : en règle générale, elles ne vont pas au delà du stade de la production de farine d’insectes. Une autre de nos originalités consiste dans le fait que Cycle Farms n’a pas pour objectif de commercialiser ses produits sur le marché européen, du moins pour l’instant, mais de répondre d’abord aux besoins des marchés de l’Ouest africain.
Cycle Farms est une start-up créée en février 2016, sur la base de deux activités. La première consiste à produire et élever des insectes – en l’occurrence la Mouche Soldat Noire (Black Soldier Fly en anglais ou encore Hermetia Illucens d’après sa désignation scientifique) pour le traitement de matières organiques. La seconde découle de la première puisqu’il s’agit d’intégrer la farine d’insecte ainsi produite dans des formulations pour de l’alimentation animale. Cette double activité nous différencie des autres sociétés françaises et européennes investissant le marché : en règle générale, elles ne vont pas au delà du stade de la production de farine d’insectes. Une autre de nos originalités consiste dans le fait que Cycle Farms n’a pas pour objectif de commercialiser ses produits sur le marché européen, du moins pour l’instant, mais de répondre d’abord aux besoins des marchés de l’Ouest africain.
– Avant d’en venir aux perspectives de développement de votre start-up, pouvez-vous préciser comment ce projet a-t-il pu voir le jour ? Qu’est-ce qui vous a amené à innover dans ce domaine ?
Je suis ingénieur agronome de formation, diplômé d’AgroParisTech, et durant mes études je m’étais beaucoup intéressé aux enjeux de l’agriculture urbaine, qui renvoie à des systèmes de production innovants en règle générale, car les contraintes sont différentes de celles de l’agriculture classique. J’ai eu la chance d’avoir eu en guise de mentor. Christine Aubry, qui travaille beaucoup sur les problématiques de cette agriculture urbaine. Toujours dans le cadre de mes études, en 2014, j’ai fait un stage de six mois à Madagascar, qui m’a permis de travailler sur des systèmes d’agriculture urbaine low tech, à destination des bidonvilles de la capitale. Durant ce stage, j’ai retrouvé un ami de la famille, qui réfléchissait déjà sur l’intérêt de la Mouche Soldat Noire, que nous devions donc exploiter plus tard au travers de Cycle Farms. De mon côté, pour m’être un peu intéressé à l’aquaponie – ce à quoi se limitait du reste mon expérience en agriculture urbaine – j’avais identifié un problème de rentabilité de ce genre de système, qui tenait à la prise en compte insuffisante d’un chaînon dans le cycle de production, qui n’était autre que l’insecte, précisément. Ce dont je pris moi-même définitivement conscience à mon retour de Madagascar.
– Pourquoi Cycle Farms ?
Notre concept initial consiste à récupérer des bio-déchets pour nourrir des insectes, qui, transformés en farine, servent ensuite à nourrir les poissons. Au début de notre démarche, nous avions aussi imaginer d’utiliser les déjections de ces derniers pour nourrir les plantes, qui serviraient au retraitement de l’eau, non sans utiliser les autres déchets pour nourrir les insectes. Soit des principes de l’économie circulaire. De là le nom de notre société, qui s’est imposé très vite.
– C’est une chose d’avoir un concept, c’en est une autre de le traduire en un projet entrepreneurial. Qu’est-ce qui vous a déterminé ou prédisposé à franchir le pas ?
Au sortir de mes études, j’étais encore un peu dans l’expectative de ce que je voulais faire – le marché de l’agriculture urbaine dans lequel je voulais m’investir étant encore jeune. Pour y travailler, il me fallait voir du côté des start-up ou du milieu associatif. L’idée de créer ma propre entreprise s’est finalement imposée. Je m’en étais entretenu avec un de mes futurs associés, Marc-Antoine Luraschi, qui avait intégré AgroParisTech la même année que moi (nous sommes donc de la même promotion), mais qui avait fait une année de césure. Il sortait d’un stage en conseil marketing, un domaine qui ne l’intéressait pas plus que cela. Nous avons donc commencé à réfléchir à ce que nous pourrions faire du concept, qui, sur le papier, semblait intéressant à creuser. Très vite, nous avons sollicité les conseils d’autres personnes engagées dans le monde associatif ou l’entrepreneuriat. C’est ainsi que le projet de Cycle Farms a maturé, avant que nous ne nous décidions de nous y consacrer à plein temps, en septembre 2015.
– Quel a été l’apport d’AgroParisTech ?
Le projet n’aurait pas pu voir le jour sans mes études à AgroParisTech. Dès que le projet a germé dans mon esprit, j’ai pu en discuter, outre Christine Aubry, que j’ai déjà évoquée, avec Marianne Le Bail, ma maître de dominante d’approfondissement de 3e année, qui m’a fait un premier retour. Assez vite, je me suis rapproché des scientifiques et experts du secteur d’autant plus facilement qu’ils sont tous affiliés à AgroParisTech, d’une manière ou d’une autre. Je pense en particulier à Samir Mezdour et Frédéric Marion-Poll que je tiens d’ailleurs à remercier pour l’accueil qu’ils m’ont réservé. Il m’auront permis d’avoir un autre retour, cette fois sur la faisabilité technique de ce que j’envisageais de faire.
– Comment s’est fait le lien avec ce qui ne s’appelait pas encore le Food Inn Lab ?
Une fois que nous avons décidé, Marc-Antoine et moi, de nous consacrer à plein temps au projet, la question s’est naturellement posée de savoir où nous pourrions nous installer. Même si j’y avais eu peu de cours durant mes études, je connaissais le site de Massy. A l’automne 2015, nous avons donc sollicité Catherine Lecomte, qui se trouvait elle-même engagée dans une réflexion sur la manière de promouvoir l’entrepreneuriat étudiant au sein AgroParisTech [pour en savoir plus, voir l’entretien qu’elle nous a accordé ; pour y accéder, cliquer ici]. La direction donna un accord de principe pour mettre à disposition des locaux. Restait cependant à la convaincre de l’intérêt de notre projet. Après moins de deux mois de discussion sur ce que nous pouvions apporté en contrepartie – en l’occurrence, un retour d’expérience pour aider l’école à identifier les besoins des futurs startuppers qu’elle accueillerait en son sein -, nous avons pu nous installer sur le site dès janvier 2016, avant même, donc, la création du Food Inn Lab. Par chance, l’Inra était en train de quitter un bâtiment.
– Avec le recul, quel a été l’apport du Food Inn Lab, qui s’est constitué à peu près au même moment ?
Ni mon associé ni moi n’avions de fonds propres et donc les moyens de louer des locaux. S’il y a un premier apport du Food Inn Lab, c’est bien celui-ci : en avoir mis à disposition, et rapidement, moyennant ce retour d’expérience que j’évoquais. Ce qui est non négligeable dans le contexte francilien.
– Des locaux, c’est-à-dire des bureaux mais aussi des paillasses et d’autres lieux où vous pouviez vous livrer à vos tests…
Oui, exactement. Le bâtiment dispose d’une halle industrielle, avec du matériel qui a été bien utile pour nos process. Nous avons pu ainsi avancer sans avoir à procéder à d’importants investissements. Sans compter les compétences des chercheurs qui travaillant dans les laboratoires voisins. Nous pouvions les solliciter à chaque fois que nous avions des problèmes techniques. Le fait d’obtenir des réponses rapidement a certainement contribué à réduire le temps de développement et permis d’avancer peut-être plus vite que d’autres start-up. De même le fait d’être associés à AgroParisTech dans nos dossiers de subventions : cela crédibilisait un projet porté par deux jeunes diplômés sans réelle expérience professionnelle.
– Qu’est-ce qui vous a prédisposé à vous lancer dans l’entrepreneuriat ?
Mon père a été artisan depuis ses dix-huit ans. J’ignore cependant dans quelle mesure cela a pu jouer.
– Si on vous avait dit qu’un jour vous seriez entrepreneur, l’auriez-vous cru ?
Par forcément. Au sortir d’AgroParisTech, j’avais la possibilité de travailler pour de grandes entreprises de l’industrie agro-alimentaire. Il y avait bien sûr aussi l’option de rejoindre une start-up, mais la plupart n’avaient pas encore à l’époque, du moins dans le domaine de l’agriculture urbaine, les moyens de m’embaucher à plein temps. Aussi, j’ai fait le choix de travailler en free lance. Si aujourd’hui je suis startupper, je considère que c’est un peu par hasard ; je ne m’étais pas dit qu’un jour j’en deviendrais un. C’est progressivement, au cours de l’année qui a suivi l’obtention de mon diplôme, que je me suis retrouvé dans une dynamique entrepreneuriale. Mon associé y est sans doute pour quelque chose : son stage d’études ne lui ayant pas plu, il avait souhaité se consacrer à plein à notre projet pour voir ce que cela donnerat. Si j’ai pu le suivre, c’est aussi parce que j’ai pu bénéficier du soutien financier de ma famille et de ma mère en particulier. C’est ainsi que je me suis retrouvé entrepreneur, peut-être plus vite que prévu.
– Mais ce faisant, n’avez-vous pas le sentiment d’appartenir à une génération de startuppers pour laquelle l’entrepreneuriat innovant est devenu une voie naturelle, dans laquelle on s’engage sans plus avoir besoin de se revendiquer comme entrepreneur ?
Je ne sais si c’est ce que vous avez en tête, mais je n’ai pas le sentiment d’appartenir à la génération Y, X ou Z. En revanche, je pense effectivement appartenir à celle pour qui travailler dans une grande entreprise n’est pas une fin en soi ni même ce qui assure la sécurité de l’emploi, et qui préfère donc prendre le risque de créer le sien. J’ajoute que j’ai un rapport disons, un peu compliqué avec la hiérarchie…. Travailler au sein d’une grande organisation avec plusieurs chefs au dessus de moi, non merci !
– A travers le concept de votre start-up, s’est-il agi de vous inscrire dans une démarche de développement durable ?
Le développement durable a très certainement motivé notre démarche et Cycle Farms y participe clairement : en plus de réduire l’impact environnemental, nous créons des emplois et concourons au développement local. Pour autant, nous ne mettons plus en avant cette notion, car, aujourd’hui, elle nous semble prêter trop à confusion. Beaucoup s’en réclament mais sans en respecter toujours toutes les dimensions (sociale, économique et environnementale). Nous préférons donc mettre davantage en avant notre contribution à ce qu’on appelle l’ « intensification écologique » – le fait de faire mieux avec moins de ressources – et la cohérence de notre stratégie.
– Que diriez-vous à ceux qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat innovant ?
Que, bien évidemment, je ne regrette pas ce choix et que pour autant, il ne faut pas s’illusionner : créer une start-up exige beaucoup d’effort, pour un niveau de rémunération très faible, du moins les premières années. L’entrepreneuriat innovant est tout sauf un long fleuve tranquille et la vie est loin d’être toute rose dans l’univers des start-up. Cela étant dit, on n’entreprend jamais seul. Et si je n’avais qu’un conseil à donner, ce serait celui de ne jamais hésiter à discuter de son projet. Je ne sais si c’est propre aux startuppers français, mais beaucoup craignent de le faire de peur d’être plagié. C’est selon moi une erreur de jugement. Il faut plutôt partir du principe que quand on discute avec quelqu’un de son projet, ou bien son avis est positif et, dans ce cas, c’est encourageant, ou bien il est négatif, mais dans ce cas aussi, ce peut-être une bonne chose, car cela ne peut que vous aider à avancer, en vous obligeant à mieux argumenter sinon à revoir votre copie. Le risque que votre interlocuteur vous « pique » votre idée est mineur car cela supposerait qu’il se l’approprie, qu’il en maîtrise tous les aspects techniques et scientifiques. La première chose à faire est donc de parler de son projet, autour de soi, à commencer par les ingénieurs-chercheurs car ils sont à même de donner des avis pertinents au plan technique. Leur rôle a été décisif dans le cas d’une start-up comme la nôtre. Après, à chacun de poursuivre son propre parcours et de saisir les opportunités qui s’offrent à lui en termes de rencontres.
– Où en êtes vous dans votre développement ? Combien êtes-vous aujourd’hui ?
Cycle Farms a connu un développement rapide. En moins d’un an d’existence, nous sommes passés de deux à une douzaine de personnes. Entretemps, Marc-Antoine et moi avons été rejoints par deux autres associés. Le premier est ingénieur en mécanique, spécialiste des énergies renouvelables ; devenu lui-même entrepreneur (il a monté une société pour laquelle j’avais travaillé en free lance), il est entré dans le capital de notre start-up au titre de Business Angel et assume une fonction de conseil stratégique. Le second a des responsabilités plus opérationnelles : issu de l’industrie, il assure l’industrialisation de notre procédé de production. Nous avons par ailleurs recruté un entomologiste (un spécialiste de l’insecte) ; un designer industriel ; un business developer, venu des Etats-Unis ; une ingénieure agronome de formation, qui s’est orientée vers le process qualité en industrie agro-alimentaire ; enfin, un technicien d’élevage, qui gère le prototype au jour le jour. A quoi s’ajoutent des stagiaires dont deux issus d’AgroParisTech.
– Une illustration au passage du fait que le startupper n’est pas seul, qu’il joue collectif avec pour principal talent d’ailleurs, celui d’agréger les compétences dont il a besoin… Vous soulignez aussi l’importance de l’accompagnement.
En effet. Sans doute serons-nous moins accompagnés dans les années à venir, tout simplement parce que nous arrivons au bout de nos programmes d’accélérations. Mais cet accompagnement a été essentiel. Nos partenaires nous ont aidés à nous poser les bonnes questions et à développer une vision stratégique. Marc-Antoine et moi sommes des ingénieurs agronomes de formation, qui aimons a priori la techno. Comme d’autres startuppers, nous étions donc enclins à monter notre projet en mettant l’accent sur les enjeux technologiques avant d’aborder les enjeux de marché. Or, les premières questions que nous ont posées nos interlocuteurs étaient : à qui comptez-vous vendre votre techno ? Quel marché visez-vous ? Qui sont vos clients potentiels ? Des questions qui nous ont amenés à revoir notre concept, y compris dans sa dimension technique. Nous nous sommes désormais concentrés sur la production de farine d’insectes, en laissant de côté l’aquaponie et l’alimentation des plantes en charge de la régénération de l’eau. L’entrepreneuriat innovant, c’est donc cela aussi : une capacité à développer une vision stratégique, quitte à opérer des changements profonds (à pivoter, comme on dit).
– Au fond, ce dont vos premiers interlocuteurs vous ont fait prendre conscience, c’est qu’une idée a beau être ingénieuse, elle n’est pas certaine de rencontrer son marché…
Parfaitement. Trop de start-up mettent l’accent sur la technologie en omettant de s’assurer de la viabilité économique de leur projet. Or, il s’agit aussi de gagner de l’argent pour ne serait-ce que permettre de rémunérer les investisseurs, mais aussi les emplois que l’on crée.
– J’ai cependant l’impression que cette idée est désormais largement admise chez les startuppers, de plus en plus nombreux à être formés à l’entrepreneuriat innovant. De manière générale, que pensez-vous de l’écosystème français de l’innovation ?
Qu’il est très favorable au plan de l’accompagnement et du financement. C’est d’ailleurs ce qui nous incite à maintenir une structure de R&D en France. Certes, on peut s’interroger sur la démultiplication des structures d’incubation, mais on reste dans une marge de progression. En revanche, ce qui gagnerait à être renforcé en France, ce sont les capitaux risques, autrement dit les levées de fonds que les start-up ont besoin d’opérer pour financer leur développement, avant même de pouvoir faire du chiffre d’affaires. L’Etat est bien présent au stade de l’amorçage, mais au-delà, les capitaux risqueurs privés prennent insuffisamment le relais. Nous sommes loin du contexte américain où ceux-ci jouent un rôle déterminant. Si nous étions aux Etats-Unis, nous aurions, nous dit-on, déjà levé plusieurs millions de dollars. Ce qui, cependant, reste à prouver si on en juge par la situation des entreprises qui s’engagent sur le même créneau que nous. Faut-il d’ailleurs s’aligner sur le contexte américain qui n’a pas que des avantages ? Des start-up ayant bénéficié de l’apport de capitaux risqueurs sont aussi nombreuses à faire faillite. Et puis, ne sous-estimons pas le rôle des collectivités locales et des Chambres de Commerce et d’Industrie. Nous y avons rencontré à chaque fois des interlocuteurs intéressés et compétents, qui ont pris conscience du rôle des start-up dans le dynamisme de développement local.
– Où en êtes-vous d’ailleurs en terme de financement ?
Nous préparons une levée de fonds, justement. Jusqu’à présent, nous avons pu nous appuyer sur les subventions publiques que nous avons reçues et l’apport de notre Business Angel.
– Quelle est la prochaine étape ?
Malheureusement, nous nous apprêtons à quitter le Food Inn Lab où nous sommes désormais à l’étroit. Mais, après tout, nous avons pu bien profiter des locaux et équipements mis à disposition. Il nous faut maintenant laisser la place aux prochains porteurs de projet. Nous aménagerons dans un nouvel atelier de production, de 700 m2, dans le Maine-et-Loire…
– Vous quittez, donc, aussi Paris-Saclay…
Si nous quittons physiquement le site de Massy, nous ne comptons pas rompre totalement les amarres avec lui. J’ai bien l’intention de m’impliquer dans le Food Inn Lab. Depuis la création de Cycle Farms, nous avons apprécié de pouvoir intervenir auprès des élèves pour témoigner de nos parcours, aussi atypiques soient-ils. Je ne demanderais qu’à participer à des jurys de sélection des projets susceptibles d’être accueillis. Par ailleurs, nous continuerons à entretenir des liens forts avec des unités de recherche du site. Bref, nous aurons toujours un lien avec AgroParisTech et donc Paris-Saclay…
– Ne regrettez-vous pas de quitter le site de Massy, peu avant son transfert sur le Plateau de Saclay ?
De ce transfert, j’ai entendu parler dès que je suis entré à AgroParisTech. Il devait avoir lieu en 2018. Finalement, il interviendra plus tard. Toujours est-il que mes associés et moi, nous nous sommes effectivement interrogés sur la pertinence qu’il y avait à partir dans le Maine-et-Loire plutôt que le Plateau de Saclay. Finalement, plusieurs facteurs ont fait pencher la balance du côté de la première option : d’une part, le prix de l’immobilier, relativement cher ici ; d’autre part, les problématiques d’accessibilité, qui disparaîtront certes à termes, mais qui, a court terme, sont réelles pour une entreprise comme la nôtre. Nous avons donc préféré nous installer en région, pour d’autres raisons encore, à commencer par la proximité de productions maraîchères, qui constituent une de nos principales sources de bio-déchets.
Pour en savoir plus sur Cycle Farms, cliquer ici.
Journaliste
En savoir plus sur Sylvain Allemand