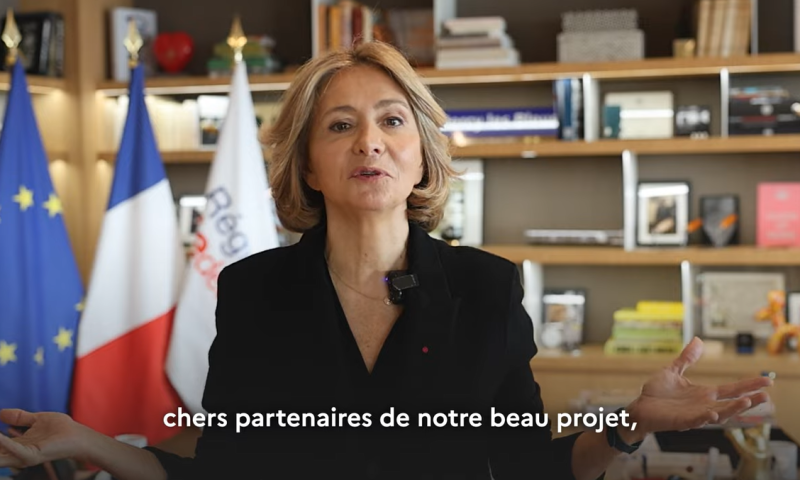Des vertus de la construction hors-site
Créé le 29/08/2025
Modifié le 02/09/2025
Entretien avec Benoît Lebeau, directeur de l'aménagement, de l'EPA Paris-Saclay
Le 4 septembre prochain, l’Association Filière Hors-Site organise une table ronde dans le cadre du Salon Immobilier Bas Carbone (SIBCA), le rendez-vous des professionnels engagés, comme son nom l’indique, dans le développement de filières de construction bas-carbone. Directeur de l’aménagement, de l’EPA Paris-Saclay, Benoît Lebeau, par ailleurs administrateur de cette association, y participera pour témoigner du rôle d’un aménageur dans la Sdes prescriptions environnementales pour les constructions hors-site.
- Le 4 septembre prochain, vous participez à une table ronde organisée dans le cadre du SIBCA par l’Association Filière Hors-Site France. Pouvez-vous, pour commencer, rappeler ce qu’il faut entendre par « hors-site » ?
Benoît Lebeau : Dans le domaine de la construction, le hors-site désigne les procédés de préfabrication de composants de bâtiments, en amont des chantiers donc. En plus de répondre aux objectifs bas-carbone, cette démarche permet d’améliorer la qualité de construction, mais aussi les conditions de travail des ouvriers du BTP – ceux-ci travaillent selon des processus plus maîtrisés parce qu’industrialisés, à l’abri, sans plus à devoir subir les intempéries.
La construction hors-site ne présente que des avantages par rapport à la construction « traditionnelle », avec ses toupies de béton coulé sur site et ses multiples sources de nuisances pour les riverains. Elle permet de limiter le recours à cet outil utilisé pour corriger ce qui a été coulé sur place ou y faire des trous – je veux parler du marteau-piqueur !
- Où en est-cette construction hors-site ?
B.L.: La construction hors-site connait un regain d’intérêt depuis quelques années, à la faveur notamment de la filière bois, pour laquelle elle est particulièrement bien adaptée : les éléments en bois sont systématiquement construits hors-site, le chantier n’étant plus qu’un lieu d’assemblage. Mais le hors-site n’exclut pas la construction en béton avec, par exemple, la mise en œuvre d’éléments préfabriques en façades.
Preuve d’un réel intérêt des professionnels de la construction, la création, en 2023, de l’Association Filière Hors-Site, qui fédère l’ensemble des acteurs concernés : aussi bien des maîtres d’ouvrage et des aménageurs que des promoteurs, des constructeurs, des architectes, tous engagés dans l’industrialisation des process de construction.
- Que dites-vous à ceux qui craindraient que le hors-site n’encourage, à force d’industrialisation des process, la standardisation des constructions ?
B.L.: C’est tout le contraire. L’industrialisation porte sur les process de fabrication des éléments entrant dans la construction d’un bâtiment ; elle ne vise en rien à brimer la création architecturale. Je dirai même qu’elle offre de nouvelles perspectives aux architectes. D’ailleurs, l’Ordre des architectes ne s’y trompe pas : il siège aussi au conseil d’administration de l’Association Filière Hors-Site.
Tout au plus, la construction hors-site exige-t-elle de la part des architectes qu’ils acquièrent des compétences nouvelles sachant que plusieurs en ont déjà l’expérience et ont déjà apporté la démonstration de leur capacité à réaliser une architecture contextualisée.
A contrario, force est de constater que les modes de construction traditionnelle – je veux dire sur site – n’ont pas empêché la production d’une architecture monotone.
- Pourriez-vous citer des exemples de constructions hors-site parmi celles réalisées dans le cadre de l’OIN Paris-Saclay ?
B.L.: Plusieurs opérations menées dans le cadre de l’OIN [Opération d’intérêt national] relèvent du hors-site. Entre autres exemples, du côté de la filière de la construction bois, on peut citer le centre international de recherche et innovation de Danone ; le Centre Teilhard de Chardin ou encore des résidences étudiantes, dont la dernière en date, la résidence Athena. Du côté de la construction en béton, citons Le Central, en cours de construction.
- Et dont les équipes de l’EPA Paris-Saclay peuvent suivre la progression, depuis le NEXT où elles ont aménagé au printemps dernier.... Quel rôle jouent les aménageurs et l’EPA Paris-Saclay en particulier, dans le développement de cette filière ?
B.L.: En tant qu’aménageur public, opérateur de l’Etat, notre rôle est d’encourager le développement de nouvelles filières bas-carbone, notamment celle des matériaux biosourcés. Parmi eux, nous sommes engagés dans la promotion des matériaux à base de terre crue, une ressource naturelle dont nous avons la chance de disposer en abondance du fait des excavations réalisées pour les besoins de nos chantiers de construction ou d’aménagement. Les qualités de ce biomatériau ne sont plus à démontrer. Nous souhaitons donc la mettre à disposition d’un industriel disposé à s’installer sur nos chantiers pour y produire des matériaux de construction. Un appel à manifestation d’intérêt (AMI) a été lancé cet été à cet effet. En tant qu’aménageur, nous avons l’avantage de pouvoir édicter les prescriptions urbaines, architecturales et environnementales à même d’encourager en amont les opérateurs immobiliers à exploiter ce type de ressource.
- Dans quelle mesure le développement de ces filières – hors-site, biomatériaux… - change-t-il les métiers mêmes de l’aménageur en plus de le confronter à d’autres interlocuteurs ?
B.L.: Cela fait effectivement évoluer nos métiers du fait du basculement de l’ingénierie des projets de l’aval vers l’amont : les éléments étant préfabriqués, ils doivent être conçus à un stade plus avancé. On évite ainsi d’autres écueils des modes de construction traditionnelle comme cette tendance des opérateurs immobiliers à se décharger sur les entreprises pour la réalisation des études d’exécution. Désormais, il importe que l’ensemble des parties prenantes soient associées le plus en amont possible. Si cela implique de consacrer plus de moyens financiers et de temps aux études, cela permet aussi de réduire les coûts et de gagner du temps dans les phases de chantier, au stade de l’exécution, puisque la construction ne consiste plus qu’en des opérations d’assemblage.
- Dans quelle mesure vous appuyez-vous sur l’écosystème d’innovation du plateau de Saclay ?
B.L.: Notre inscription dans cet écosystème est bien évidemment une chance. Celui-ci représente un vivier de partenariats avec le monde de la recherche. Entre autres illustrations, nous avons été sollicités par l’ENS Paris-Saclay pour participer au projet TRACES (pour Transformer pour Adapter l’existant : une approche multisCalairE et SystématiquE) aux côtés notamment du CNRS et d’établissements d’enseignement supérieur implantés dans d’autres campus. L’objectif scientifique de la démarche est d’identifier, à partir de neuf cas d’études en France et en Italie. les modèles d’analyse permettant de définir des trajectoires de transformation globale des territoires. Nous y apporterons nos compétences d’aménageur.
- Comment l’EPA Paris-Saclay se positionne-t-il sur cette filière, comparé à d’autres aménageurs ?
B.L.: Compte tenu des ambitions de l’OIN Paris-Saclay en matière environnementale, l’EPA Paris-Saclay est encouragé par l’État à aller toujours plus loin que la règlementation en vigueur. L’existence d’une zone de protection d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ZPNAF), nous incite à nous montrer d’autant plus vertueux en termes de durabilité et de décarbonation.
Aujourd’hui, je crois pouvoir dire que l’EPA Paris-Saclay est considéré par les opérateurs immobiliers comme un aménageur exigeant. Ce n’est évidemment pas un reproche de leur part, mais la reconnaissance du travail de nos équipes.
Cependant, nous veillons à ce que nos prescriptions environnementales ne soient pas inatteignables, mais permettent à toutes les parties prenantes de faire profiter des compétences dans lesquelles elles excellent. C’est pourquoi nous avons redéfini nos prescriptions environnementales en distinguant un socle d’ambitions raisonnables, similaire pour toutes les opérations d’une même typologie et non négociable, d’une part, des engagements complémentaires destinés à permettre à des opérateurs d’aller le plus loin possible sur les propositions qu’ils maîtrisent le mieux, d’autre part.
Journaliste
En savoir plus