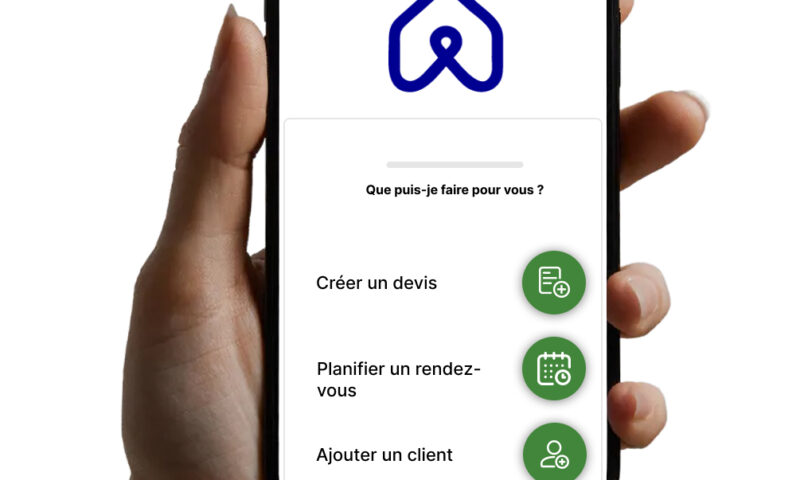De l’exploration au scale-up, les vies successives du startupper
Créé le 19/06/2023
Modifié le 06/12/2023
Entretien avec Bruno Martinaud, responsable académique entrepreneuriat à l’École Polytechnique.
Créer une start-up, c’est bien, mais lui faire changer d’échelle (scale up en anglais), c’est mieux. Comment y parvenir ? L’entrepreneur innovant qui aura procédé à la phase initiale, l’exploration du concept jusqu’au Bêta test, est-il le mieux placé pour assurer la croissance de la société qu’il a créée ? Telles sont les questions qu’aborde Bruno Martinaud, responsable académique entrepreneuriat à l’École Polytechnique (il y codirige le master spécialisé Entrepreneurs en partenariat avec HEC), dans l’ouvrage qu’il a coécrit avec Alain Bloch professeur émérite à HEC : Objectif : Mars ! Petit manuel à usage des entrepreneurs qui rêvent de conquérir le monde (Pearson, 2022). Après sa lecture, nous avons voulu en savoir plus notamment sur le rôle de l’écosystème d’innovation dans l’envol d’une start-up. Et quand nous disons écosystème d’innovation, nous pensons bien sûr à celui de Paris-Saclay !
- Comment en êtes-vous venu à écrire ce livre sur le changement d’échelle des start-up ?
BM : En tant qu’enseignant, j’ai pu voir passer beaucoup de projets intéressants portés par des étudiants de talent, mais qui n’arrivaient pas à en convertir les promesses. Naturellement, la dynamique d’innovation entrepreneuriale n’échappe pas à une sorte de sélection naturelle. Mais une autre explication vient de ce qu’on les prépare moins bien à changer d’échelle. L’environnement qu’on leur propose n’est pas forcément au niveau du sujet qu’ils ont commencé à attaquer. Tel est en tout cas le constat initial ayant conduit au projet de ce livre.
- Avant d’en venir à la manière dont une entreprise innovante peut changer d’échelle, j’aimerais que vous reveniez sur une idée suivant laquelle non seulement la vie de l’entrepreneur innovant n’est pas un long fleuve tranquille, mais encore qu’il est amené à en connaître plusieurs au fil du développement de sa société, si tant est qu’il soit encore là car, dites-vous, celui qui explore le concept n’est pas forcément celui qui assurera le changement d’échelle…
BM : Il y a en effet quelque chose de schizophrénique chez l’entrepreneur innovant qui, tout en développant son projet, va devoir s’inventer successivement de nouvelles identités car, effectivement, si le premier stade, l’exploration, exige des compétences et des aptitudes particulières, les suivants, ceux du développement et du changement d’échelle, en exigent d’autres. De sorte que celui qui explore ne sera pas forcément celui qui fera changer d’échelle à l’entreprise. Sauf à parvenir à se réinventer encore.
- N’est-ce pas cela qui ferait hésiter des entrepreneurs à aller au bout des promesses de leur projet ?
BM : C’est un facteur explicatif, mais il y en a d’autres, qui sont autant de pièges. Le premier est de sous-estimer cette nécessité de réinvention de soi. Au prétexte qu’on a été un bon explorateur, on est tenté de se dire qu’il n’y a aucune raison qu’on ne soit pas un bon bâtisseur. Le même schéma va s’appliquer quant il s’agira de changer d’échelle : pourquoi si j’ai été un bon bâtisseur, ne serais-je pas aussi le bon général conquérant ? Voici un autre piège : par nature, l’entrepreneur est toujours en avance de phase. Aucun ne reconnaîtra spontanément s’être fourvoyé au milieu de l’océan, avec un équipage ayant perdu foi dans la mission, même si c’est la réalité de la situation. Autrement dit, on a toujours envie de se projeter à l’étape suivante : en exploration, on se verra déjà en phase de conquête (d’un marché), avec tout le biais décisionnel qui peut en résulter. Or, à chaque phase, il y a des questions spécifiques à se poser : quand on est en exploration, il faut s’en poser de précises, qui ne sont pas celles qu’on devra se poser une fois engagé le développement, lesquelles seront encore différentes de celles à se poser au moment du changement d’échelle. En exploration, l’entrepreneur est exposé au risque de devoir pivoter. Plus il gardera cela à l’esprit, plus il saura gérer la phase exploratoire, fut-ce sans garantie de succès. Le propre de l’exploration, c’est d’avancer sans savoir où on va ! L’important est d’être sensible aux signaux faibles qui seront susceptibles de mettre l’entrepreneur-explorateur sur la bonne voie.
- On mesure à vous entendre la dimension psychologique de la démarche entrepreneuriale…
BM : La dimension psychologique et cognitive, ajouterais-je. C’est dire si la psychologie et les sciences cognitives nous sont des champs de recherche précieux : elles nous éclairent sur la manière dont le cerveau gère l’incertitude comme la douleur. Avec pour conséquence directe le fait qu’on sera capable de se mentir à soi-même plutôt que d’accepter le fait qu’on part d’hypothèses qui sont encore loin de s’être matérialisées. Et pour cause, nous ne sommes qu’au début de l’exploration ! Des hypothèses ne sont encore bien souvent que des intuitions.
- Dissipons un malentendu : nous parlons jusqu’ici de l’entrepreneur au singulier. En réalité, il entreprend son exploration avec des associés. Si le bât blesse, ne serait-ce pas d’ailleurs plus du côté de l’équipe ainsi constituée que des individualités et de leurs psychologies respectives ?
BM : La composition de l’équipe est bien évidemment déterminante dans la réussite d’une start-up. Mais les biais qu’on observe à l’échelle des individus n’en sont pas moins préjudiciables, car au sein d’une équipe d’explorateurs ils sont par construction consensuels. Pour créer une dynamique féconde, il importe d’introduire de la diversité au sein de l’équipe. Ce qui n’est pas forcément la pente naturelle des explorateurs : par nature, on a envie de s’associer avec ceux ou celles avec lesquels/elles on se sent des affinités, qui seront plus souvent en accord qu’en désaccord avec soi. Or, au stade de l’exploration, il faut des personnes intelligentes, mais qui appréhendent le monde différemment. Certes, cela peut engendrer des frictions, mais ce sont des frictions créatives. Il faut juste reconnaître l’intelligence des autres, de façon à ce que la confrontation de points de vue différents ne vire pas à la guerre d’ego. Finalement, rien de plus stimulant que de constater qu’une autre personne aborde le même problème, mais de manière orthogonale, que personne n’a forcément d’emblée la réponse et qu’on gagne donc à tester ensemble des hypothèses.
- Il reste que vous développez une vision martiale plus que marsienne (pour faire référence au titre de l’ouvrage) : il est beaucoup question de « conquête », de « vaincre » des concurrents potentiels etc. Pourquoi le scale up passerait-il nécessairement par l’élimination des concurrents ? Pourquoi des start-up ne s’allieraient-elles pas plutôt que de chercher à se neutraliser ou à l’emporter sur les autres ?
BM : Parce que cette vision que vous jugez par trop martiale, guerrière, reflète une bonne part de la réalité. Tout entrepreneur innovant doit garder à l’esprit que l’environnement dans lequel il est appelé à évoluer peut être hostile. Les personnes qu’il sera amené à croiser n’ont pas toutes vocation à l’aider dans un élan de pure générosité. C’est donc à lui de créer les conditions pour que l’environnement permette à son projet d’avoir un impact aussi fort que possible. Car ce qui le motive fondamentalement, ce qui in fine donne sens à sa démarche entrepreneuriale, c’est l’impact qu’il pourra avoir à travers son projet. Son challenge est donc de construire le chemin qui va maximiser la probabilité d’y parvenir. Là où s’arrête l’analogie militaire, c’est dans le fait que la réussite de l’un n’a pas pour contrepartie l’échec de l’autre. La Silicon Valley l’illustre parfaitement : si, de prime abord, c’est un univers hyperconcurrentiel, où tous les coups semblent permis, dans le même temps, la circulation des idées et des talents y prévaut : les entrepreneurs ont beau être concurrents et ne jamais l’oublier, il n’en reste pas moins qu’ils se parlent, échangent, donnent leur avis. Et il me semble que c’est la posture la plus saine qu’on puisse adopter. Certes, l’environnement reste toujours aussi hostile et sélectif, seuls quelques élus en émergeront en fin de course, mais on n’en a pas moins intérêt à continuer à échanger. Il en a toujours été ainsi. Déjà, dans les années 1950, quand la Silicon Valley était peuplée d’ingénieurs de sociétés concurrentes – Intel et autre National Semiconductor -, ceux-ci discutaient volontiers entre eux y compris de sujets confidentiels comme les recherches qu’ils menaient dans leurs laboratoires respectifs – par exemple, sur la manière d’augmenter la densité de transistors à espace constant. Sans doute que quelques rounds de Tequila devaient y aider… Avec le recul, on peut dire que c’est grâce à la possibilité de ces échanges informels que l’industrie électronique et informatique américaine a pu progresser aussi vite.
- Il sera intéressant de vous entendre sur l’écosystème de Paris-Saclay, nous dire en quoi il présente des caractéristiques comparables. Auparavant, j’aimerais vous faire réagir à une notion qui fait florès dans différents milieux, à savoir celle d’alliance. Une notion qui connote elle-même le monde militaire, mais que d’aucuns emploient en un sens plus pacifique pour désigner des rapprochements entre des acteurs différents qui gagneraient à dépasser leurs antagonismes pour mieux faire face collectivement aux défis sociétaux*. Pourquoi n’en irait-il pas de même dans le monde de l’entrepreneuriat innovant et des jeunes pousses ?
BM : C’est une question passionnante que vous me posez-là. Mais, en toute franchise, ma première réponse serait de vous dire : je n’en sais rien ! Après tout, ma vie d’entrepreneur est jalonnée d’erreurs d’appréciation. Cela étant dit, je dois encore à la vérité de vous dire que je suis a priori peu enclin à croire à la possibilité de telles alliances. Car si j’en juge par ce qui se passe dans la Silicon Valley, le dynamisme d’un écosystème entrepreneurial innovant repose davantage sur un équilibre instable entre collaboration et émulation…
- De la coopétition en somme…
BM : De la coopétition, mais jusqu’à un certain point. Car comme je le disais, la motivation première d’un entrepreneur innovant est d’avoir un réel impact sur la société et, donc, de gagner la compétition. On ne peut dissocier les deux : l’entrepreneur aura le sentiment d’avoir d’autant plus d’impact qu’il aura su imposer sa solution, son produit ou son service. Cela étant dit, j’ai bien conscience de vous livrer une conviction, qu’il me faudrait argumenter davantage. Toujours est-il que je constate que beaucoup de projets d’entrepreneuriat social échouent faute d’une motivation profonde assumée par l’entrepreneur innovant. Des porteurs de projet font preuve d’une certaine naïveté dans la manière d’adresser un problème ; il leur manque cet aiguillon de l’ambition de parvenir à produire un impact fort et, donc, la possibilité de se sentir fier de pouvoir se dire que c’est eux qui l’ont produit. Cet aiguillon est d’autant plus nécessaire que c’est lui qui incline à faire preuve de cette persévérance nécessaire à la conduite d’un projet d’entrepreneuriat innovant. Or, de la persévérance, il en faut surtout dans la phase exploratoire. Une phase d’autant plus difficile, qu’elle est tout sauf linéaire, programmable, planifiable. Il faut chercher et continuer à chercher par itérations successives, jusqu’à ce que, enfin, la bonne solution émerge, si elle émerge ! À chaque fois qu’on s’arrête pour dresser un bilan d’étape, tout concourt à vous faire jeter l’éponge. Il faut donc accepter que la motivation de l’entrepreneur puisse paraître irrationnelle, qu’elle participe à l’expression d’un ego entièrement voué à la poursuite d’un projet. Il faut qu’il ait foi dans ce qu’il fait, qu’il soit convaincu de pouvoir y arriver car les motifs d’arrêter, de tout abandonner pour aller chercher un job dans une entreprise en valorisant son expérience d’entrepreneur dans son CV, ne manquent pas.
- « Avoir la foi », avez-vous dit. Je ne résiste pas à l’envie d’évoquer ce que le philosophe des sciences, Michael Polany** disait de l’engagement du chercheur, à savoir qu’il devait revêtir une dimension « fiduciaire », autrement dit de l’ordre de la foi… Je vois à votre réaction que cette évocation fait sens…
BM : Oui, car une autre des idées que je défends est qu’à bien des égards, l’entrepreneur innovant est exactement comme le chercheur dans son laboratoire, avec toutefois une différence qui tient au fait que le second a moins de pression que le premier qui, lui, va devoir lutter pour sa survie – le chercheur est tout au plus « pressé » de devoir publier, ce qui au demeurant est aussi un bon aiguillon…
- Dissipons un autre malentendu : si vous soulignez l’esprit conquérant de l’entrepreneur, pour autant vous ne réduisez pas son ambition à la seule quête de profitabilité…
BM : Non, en effet. Et c’est le sens que nous avons voulu donner au chapitre sur la dimension culturelle de la démarche entrepreneuriale : l’entrepreneur se lance d’abord dans une quête porteuse de sens pour lui ; il va structurer son projet en fonction de valeurs qui vont déterminer ses comportements, ses actions et ses décisions. Des valeurs qui vont devoir être partagées par l’ensemble de l’équipe car c’est elles qui vont insuffler l’énergie nécessaire à son engagement. La profitabilité est davantage une nécessité qu’une finalité. Si sa start-up n’offre pas la perspective de réaliser des profits, l’entrepreneur sait bien qu’il va devoir renoncer à son projet plus tôt que prévu. Autrement dit, la profitabilité est une contrainte volontaire. Mais il n’y a pas de raison que les projets à impact ne trouvent pas une viabilité économique, au prétexte qu’ils serviraient l’intérêt général.
- Pour autant, ainsi que vous l’écrivez également, l’échec n’est pas rédhibitoire. Il ne signifie pas que le projet manquait de viabilité en soi, mais que le chemin emprunté n’était pas le bon…
BM : Effectivement. J’ajouterai cette nécessité d’accepter de trouver ce qu’on n’avait pas cherché.
- Soit le principe de la sérendipité, au sens strict du terme !
BM : En effet. Et je trouve fascinant de voir comment l’exploration va entraîner le projet au-delà de ses intentions initiales, de ses premières ambitions, sans en renier les drivers fondamentaux. Je pense en particulier à un groupe d’anciens étudiants proprement fantastiques : au début, ils travaillaient sur l’idée d’aider à la gestion des tâches manuelles dans les processus de production (pour réduire les risques d’erreur ou d’approximation), à partir d’un système de caméra permettant d’analyser les mouvements, de détecter d’éventuelles erreurs. Deux ans plus tard – soit la durée moyenne d’une exploration, soulignons-le au passage -, ils utilisent désormais leur technologie pour piloter en temps réel des robots. Ainsi, alors qu’ils étaient partis d’une situation où ils n’envisageaient pas d’en utiliser, où les tâches étaient censées rester strictement manuelles, ils sont parvenus à une situation diamétralement inverse en utilisant le cœur de la technologie qu’ils ont développées. Des histoires comme celles-ci, je pourrais vous en raconter de nombreuses. D’ailleurs, le livre en relate plusieurs.
- Une illustration de ce qu’explorer veut-dire et que vous aviez déjà soulignée dans un précédent entretien en usant de la métaphore des « terras incognitas ». De mon côté, j’ai mesuré à la lecture de vos récits d’entrepreneurs explorateurs, à quel point la notion d’exploration est heuristique pour décrire le processus d’innovation comme d’ailleurs la production des connaissances scientifiques. On en revient à ce parallèle entre entrepreneur et chercheur…
BM : Oui et c’est précisément parce que mon coauteur et moi en sommes convaincus que nous avons introduit l’ouvrage en citant Christophe Colomb. Depuis lors, j’ai eu l’occasion de redécouvrir le destin de Magellan, autre grand explorateur s’il en est. On y retrouve tous les ingrédients nécessaires à l’exploration de l’entrepreneur et les risques qui vont avec : une déconnection entre le leader avec le reste de son équipage, obsédé qu’il est par sa quête du Graal, une innovation à fort impact…
- En filant la métaphore des navigateurs explorateurs, on pourrait ajouter aussi cet « art de l’estime » qui, transposé à l’entrepreneuriat innovant, consiste à s’appuyer sur la moindre opportunité pour tracer sa route, son chemin. Ou encore cette idée qu’une exploration en appelle d’autres : on ne découvre pas une terra incognita du premier coup ; d’une exploration, on peut encore rapporter des spécimens qui permettront à d’autres d’enrichir la connaissance…
BM : Exactement ! L’entrepreneur innovant fait plus que porter son projet : il ouvre les portes sur un monde nouveau que d’autres pourront explorer, investir à leur tour. On pourrait, je crois, multiplier les analogies tant l’univers de l’entrepreneuriat innovant est riche et complexe, et entretient des affinités avec des univers en apparence totalement étrangers les uns aux autres. Je suis d’ailleurs en train de terminer un livre sur l’analogie comme mécanisme de base de la construction des connaissances. Un domaine dont je ne suis pas expert, mais auquel me conduit mon intérêt pour l’entrepreneuriat innovant.
- S’il est un domaine dont vous êtes expert, c’est bien celui-ci, comme en témoigne ce livre et les précédents, et ce master coanimé avec HEC. Une expertise acquise aussi au travers de vos propres expériences de « serial entrepreneur » ainsi que vous vous définissez. De là cette autre question : quelle est la part de ce que vous avez appris des ces expériences et celle capitalisée au fil de vos années d’enseignement, auprès de vos étudiants ?
BM : Les deux m’ont beaucoup appris, mais à des degrés différents. Rétrospectivement, je me rends compte, et c’est le sens de mon engagement dans l’enseignement, que j’aurai vécu ma vie d’entrepreneur sans rien en comprendre en vérité ! Et que si j’en suis sorti, c’est un peu par hasard ! Il était donc plus que temps pour moi de passer à autre chose. Je ne me sentais plus à ma place à la tête d’un projet. Une conjonction astrale, si je puis dire, a fait que j’ai pu en sortir de manière plutôt heureuse. Mais je me rends compte combien il aurait pu en être autrement.
A contrario, les interactions avec des projets portés par des étudiants me stimulent beaucoup. Pas seulement parce qu’on paraît toujours plus intelligent, plus pertinent dans ses remarques, ses feedbacks, quand on est en situation d’observation. La posture même de l’enseignement – et c’est quelque chose que j’avais déjà pu observer quand j’ai commencé à enseigner au début de ma carrière – force à structurer sa pensée, a fortiori quand on la couche sur le papier d’un livre ou d’un article. Autant vous pouvez entretenir un flou artistique quand vous intervenez dans le cadre d’un cours, autant il vous faut être rigoureux en dégageant les principes et la trame qui sous-tendent votre propos. Les cours ont cependant leur utilité : ils permettent d’affiner une pensée de manière itérative au travers des interactions, des questionnements des étudiants. Le processus qui conduit ensuite de l’oralité à l’écrit est une boucle on ne peut plus féconde pour maîtriser des sujets qu’on entreprend d’explorer plus avant. L’écrit oblige à aller au fond des choses sans pouvoir s’autoriser la moindre approximation. À cet égard, les cours en ligne et autres Mooks sont des exercices qui font aussi gagner en rigueur : des approximations intellectuelles susceptibles de passer inaperçues à l’oral sautent aux yeux quand elles sont énoncées dans ce type de support, face caméra.
- Est-ce à dire, pour en revenir à votre livre, que son écriture vous a permis d’y voir plus clair dans ce que recouvre le scale up ?
BM : Oui, absolument. L’épreuve du passage à l’écrit m’a fait comprendre avec plus d’évidence ses défis et ses enjeux. Le simple fait d’être revenu vers mes étudiants ayant eu une expérience entrepreneuriale et de es avoir invités à me raconter de nouveau leur histoire, en disposant de plus de temps pour cela, puis de faire le même exercice avec des entrepreneurs étrangers, a été une expérience enrichissante
- Michael Polany que je citais fait le distinguo entre la « connaissance focale », sur laquelle on porte son attention, et la « connaissance subsidiaire », c’est-à-dire implicite, indispensable pour parvenir à la première…
BM : On ne saurait mieux théoriser les connaissances sinon les savoirs mobilisés par les entrepreneurs. Le danger est que par solution de confort ou sous la pression des nécessités du quotidien, on reste toujours à ce niveau de connaissance subsidiaire, qui procure le sentiment d’avoir les idées claires, alors qu’elles ne le sont pas ou alors juste ce qu’il faut pour donner l’impression qu’on avance.
- Dans votre livre, vous faites peu de cas de l’inscription dans un écosystème, de l’intérêt d’un encrage territorial…
BM : C’est pourtant, j’en suis convaincu, une dimension importante. La dynamique d’innovation débute le plus souvent à partir d’un lieu. Plus de cinquante ans d’histoire de la Silicon Valley en atteste : ce cluster s’est construit dans un territoire particulier dans lequel circulaient librement les talents et les idées.
- J’en viens donc à la question annoncée plus haut : en quoi celui de Paris-Saclay vous paraît-il bénéfique, à même de favoriser non seulement l’émergence de start-up mais encore leur scale up ?
BM : L’écosystème Paris-Saclay est bien pourvu : de gens de talents, tant du côté de la recherche que de l’innovation, d’institutions pour accompagner les start-up et autres entreprises innovantes. Les ingrédients sont là pour que la réaction chimique se produise. Gardons cependant à l’esprit que c’est d’abord le succès des projets qui va contribuer à faire celui de l’écosystème. Si une start-up décide de le quitter pour partir aux États-Unis ou ailleurs, il ne faut chercher forcément à la retenir, mais se demander pourquoi elle en est arrivée à prendre cette décision – sachant qu’elle peut avoir de bonnes raisons de le faire. Aurait-on pu faire quelque chose pour la retenir ou est-ce dans sa trajectoire naturelle ? Dès lors que la start-up estime qu’un autre marché – américain, asiatique, africain… – est le plus prometteur, n’est-il pas cohérent qu’elle cherche à s’y installer ? Dans ce cas, la question à se poser est celle-ci : comment faire pour conserver une partie de la valeur créée par cette start-up sans l’entraver dans sa quête d’internationalisation ?
J’ajouterai encore ceci : il ne faut pas voir dans l’éclatement du projet universitaire en deux entités (Université Paris-Saclay et Institut Polytechnique de Paris) un handicap. Après tout, les universités de Berkeley et de Stanford savent collaborer étroitement entre elles tout en étant en concurrence. Inspirons-nous de cette vision pragmatique pour servir au mieux les projets qui émergent dans l’écosystème de Paris-Saclay. Car, encore une fois, c’est le succès des projets qui va nourrir le dynamisme de ce dernier !
* À titre d’exemples, Jean-Guy Henckel, le fondateur du Réseau de Cocagne, dont le siège se situe sur le plateau de Saclay, parle d’ « Alliance inédite » ; l’association Le Rameau invite entreprises et associations à faire alliance à travers des projets territoriaux ; enfin, dans Nous ne sommes pas seuls (Seuil, 2019), Léna Balaud et Antoine Chopot dressent une typologie d’alliances possibles entre humains et non humains pour articuler la question sociale à la question écologique…
** Chimiste de formation, ce chercheur [1891-1976] s’est ouvert à la philosophie et aux SHS pour développer une approche de la connaissance scientifique qui rende justice à sa dimension tout à la fois personnelle, contextuelle et fiduciaire. Pour en savoir plus, lire l’ouvrage que lui a consacré Gilles Lemaître, lui-même immunologiste, Michael Polany. Le chercheur qui voulait réenchanter le monde (EPFL Press).
Journaliste
En savoir plus