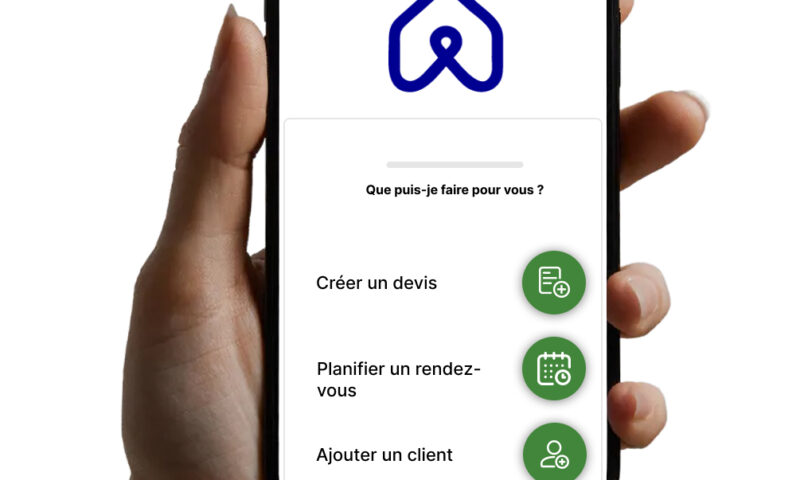A cheval sur la recherche et l’entrepreneuriat.
Créé le 02/06/2016
Modifié le 05/01/2022
Après avoir consacré sa thèse à la « contribution des informations visuelles dans le contrôle postural des cavaliers », Agnès Olivier poursuit des recherches fondamentales en appréhendant, cette fois, l’ensemble des informations sensorielles en vue d’une « optimisation de l’interaction cavalier-cheval ». Non sans mettre à profit son expérience de la compétition équestre. Ni développer une approche entrepreneuriale.
– Si vous deviez commencer par présenter vos travaux de recherche ?
Mes premiers travaux de recherche, réalisés dans le cadre de ma thèse à l’UFR STAPS de l’Université de Caen, ont porté sur la contribution des informations visuelles dans le contrôle postural du cavalier. Ces travaux se sont appuyés sur plusieurs études expérimentales allant de tests posturologiques classiques sur plate-forme de force à des tests posturaux spécifiques sur simulateur, en passant par d’autres expériences perceptives et d’exploration visuelle en laboratoire. Cette graduation d’expériences m’a permis de mieux circonscrire l’expertise chez le cavalier : la manière dont il garde la tête stable, sa stratégie visuelle, etc. Ces études permettent d’ouvrir de nombreuses perspectives de recherches fondamentales et appliquées au plan de l’apprentissage et de l’entraînement.
– Comment en êtes-vous venue à ce champ de recherche ?
Depuis toute petite, je monte à cheval. J’ai fait également de la compétition. L’environnement dans lequel j’ai grandi y était favorable : j’ai grandi en Normandie, « le pays du cheval ». Après le bac, et dans l’idée de me ménager des perspectives professionnelles, je me suis donc inscrite en filière STAPS, à l’Université de Caen, qui proposait pour la première fois une option équitation. Au début, je n’avais pas spécialement l’intention de devenir chercheuse. Mais, à l’issue de mon master 2, ma directrice de thèse et son mari m’ont proposé de faire un doctorat. Une thèse avait le mérite d’allier ma passion à une perspective d’emploi. C’est du moins ce que je pensais ! L’idée de faire de la recherche me trottait dans la tête, si je puis dire. Je m’investissais toujours plus dans le travail personnel que dans l’amélioration de mes contenus de cours et le bachotage.
Ensuite et surtout, il y avait encore tout un domaine peu exploré, à savoir : le cavalier. Aussi curieux que cela puisse paraître, la recherche portait davantage sur le cheval. Certains chercheurs s’étaient, certes, intéressés aux cavaliers, mais du point de vue biomécanique, pas sous un angle neuro-sensoriel, qui est, il est vrai, plus difficile à adopter. Reste que l’équitation est avant tout une discipline « interactive » entre deux êtres où les systèmes sensoriels (auditif, visuel, proprioceptif, tactile) jouent un rôle prépondérant dans leur communication et l’optimisation de leur couplage. Le cavalier, bipède, va devoir passer d’un état d’équilibre naturel sur ses pieds, lors de la marche, à un état d’équilibre « subi » sur son bassin, une fois qu’il se retrouve à cheval. Bref, il y avait une niche à prendre et surtout un vide à combler, non sans démystifier au passage le modèle du « centaure ».
– Comment expliquez-vous le fait qu’on se soit aussi peu intéressé au cavalier ?
Il y a plusieurs raisons à cela. Une première est d’ordre technologique : jusqu’à une période récente, on ne disposait pas d’outils permettant de mesurer efficacement le comportement du cavalier, in situ. Ensuite et surtout, aux yeux des chercheurs – du moins ceux de la filière STAPS – celui-ci n’était pas considéré comme un vrai sportif. Pourtant, l’équitation représente la 3e fédération sportive en termes de nombre de licenciés et la France est le 1er pays organisateur de compétitions équestres ! Pour moi, il y avait donc un véritable terrain à investiguer.
Une troisième raison est d’ordre financière. Ce n’est que depuis la réforme des Haras Nationaux et la création de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) que le comité scientifique a commencé à financer des projets centrés sur les « cavaliers ». Ainsi, à l’issue de mon doctorat, j’ai pu bénéficier d’un des premiers financements de ce type. Auparavant, le financement privilégiait les recherches vétérinaires, et donc sur le cheval, sa performance, y compris génétique. Le rôle du cavalier paraissait secondaire. Qu’il fît peu de cas de son hygiène de vie importait peu, semblait-on penser. Pour avoir fait de la compétition, je savais qu’il devait en réalité, lui aussi, être au top. D’autant qu’en plus de devoir s’occuper de son cheval, il doit coacher ses élèves, faire vivre sa petite entreprise. Autrement dit, en plus d’être un bon sportif, il doit être un bon pédagogue et un bon manager.
Loin de me décourager, cette situation m’a confortée dans l’idée d’investir cette « niche », qui concerne tout de même des milliers de personnes rien qu’en France.
– Comment s’est déroulée votre thèse ?
A l’issue de mon master 2, déjà inscrite en thèse, j’ai passé mon Brevet d’Etat d’équitation, de façon à avoir une carte professionnelle et être reconnue comme une spécialiste au sein des STAPS. Ce Brevet d’Etat en poche, j’ai eu la chance d’être embauchée dans mon centre de formation à la Société Hippique Urbaine de Caen (SHUC) auprès d’Eric Chaudet, instructeur et technicien hors pair. Cet emploi m’a permis de financer ma thèse, à défaut de bourse, et de parfaire mes connaissances du milieu équestre. Pendant plus de trois ans, j’ai oscillé ainsi entre enseignement universitaire et travail de thèse, entre terrain et recherche fondamentale, ce qui s’est révélé plutôt un atout.
– Vous évoquiez un obstacle technologique susceptible d’expliquer le retard de la recherche sur la posture du cavalier. Etait-il levé au moment où vous engagiez vos recherches ?
Non, au sein de mon laboratoire, nous ne disposions pas de dispositifs d’analyse du mouvement embarqué, ni de simulateur équestre. J’ai pu cependant disposer d’un des tout premiers simulateurs conçus en France, Persival. Il l’a été dans le cadre d’un important projet de recherche, mené dans les années 85-90, à l’Ecole Nationale d’Equitation (ENE) de Saumur, avec des écoles d’ingénieurs comme l’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA). Il m’a permis de m’exonérer du recours au cheval, en étudiant le comportement de cavaliers sur la base du même protocole de recherche, ce qui est un avantage indéniable par rapport aux mesures faites à partir de vrais chevaux. Je remercie encore le soutien de l’ENE envers une jeune thésarde. Les résultats de l’étude menée sur Persival ont permis la rédaction du projet que je mène actuellement à Orsay.
– Qu’est-ce que vos recherches doctorales ont-elles donné ?
Elles m’ont notamment amenée à remettre en question des modèles théoriques sur lesquels je m’étais moi-même appuyée durant mes études. Des modèles qui ont tendance à utiliser des expériences pour conforter une théorie, et non l’inverse : partir du terrain pour théoriser ensuite, comme mon activité professionnelle m’a permis de le faire. Résultat : ces allers-retours théories-terrain au cours de mes années de recherche doctorale se sont révélés passionnants et ont même débouché sur un prix de l’innovation. Tant et si bien qu’une fois ma thèse soutenue, en 2012, j’ai eu envie d’aller plus loin, en m’intéressant à l’ensemble du couple cavalier-cheval sous le double angle de la recherche et de l’innovation. Non sans ajouter à la complexité puisque cela revient à considérer simultanément deux systèmes multiarticulés. L’enjeu est d’identifier les déterminants du couplage multisensoriel cavalier-cheval. Ce qui est loin d’être simple compte tenu de la variété des configurations possibles selon la taille de l’un et de l’autre. Pour mener à bien ces recherches, je me suis rapprochée de Brice Isableu, maître de conférences HDR à Paris-Sud, qui travaille depuis plusieurs années sur les différences interindividuelles dans le contrôle de l’équilibre et de l’orientation spatiale. Son approche scientifique colle parfaitement au sujet et a nourri mes travaux de thèse. Il était évident pour moi de me tourner vers lui, à l’issue de mon doctorat. Son approche scientifique mais aussi son expérience sur le brevet et son goût pour les relations université-entreprise privée qu’il a su développer au sein de l’Unité de Recherche CIAMS, sont parmi les principaux motifs m’ayant convaincue de venir ici.
Cet élargissement de mon champ de recherche m’a également amenée à m’associer à d’autres compétences, aussi bien en France – celles d’ostéopathes et de podologues-posturologues, par exemple, qui s’intéressaient aux morphotypes et asymétries posturales – mais aussi à l’étranger – celles en l’occurrence de Lars Roepstorff [à droite, sur la photo], Professeur vétérinaire à l’Université Uppsala (Suède), spécialiste de la locomotion équine. Ainsi, de proche en proche, mon projet a-t-il pris de l’ampleur. Il n’y a plus qu’à espérer que tout cela ne retombe pas comme un soufflet !
Les retombées pratiques de mes recherches m’ont par ailleurs amenée à collaborer avec une start-up, HorseCom, pour la mise au point d’un dispositif de communication embarqué pour le cavalier et le cheval.
– Etiez-vous prédisposée à vous intéresser à l’innovation ?
Depuis le recours à Persival, je m’étais intéressée aux produits mis au point par des start-up. Pendant ma dernière année de thèse, j’ai eu l’opportunité de participer aux Doctoriales de Caen [une manifestation d’une semaine destinée à réunir les doctorants d’un même campus]. Un cours était consacré à l’innovation. Un concours d’idées innovantes était également organisé. Les doctorants ont été répartis en différentes équipes dont la composition était aléatoire. C’est ainsi que je me suis retrouvée avec un ingénieur, un sociologue… J’ai proposé de réfléchir sur une idée de selle innovante provenant de mon expérience de terrain, en tant que monitrice. L’idée a aussitôt suscité l’adhésion. Nous avons donc planché ensemble et, au final, c’est notre projet, qui a emporté le premier prix ! Cela m’a confortée dans l’idée d’aller au-delà de simples allers-retours entre recherche fondamentale et terrain, en adoptant une démarche plus entrepreneuriale.
– Au point d’être tentée de créer votre propre start-up ?
Naturellement, l’idée m’a trotté dans la tête. Normandie incubateur s’était dit prêt à incuber un premier projet. Mais je n’étais pas pressée. J’étais convaincue que mes travaux de recherche pouvaient m’inspirer bien d’autres idées. Et puis, je souhaitais pouvoir m’appuyer sur des personnes qui avaient l’expérience de l’entrepreneuriat innovant sinon de la valorisation de la recherche. Ma thèse et ce premier prix du projet innovant en poche, j’ai donc rejoint l’Université Paris-Sud, le 1er octobre 2012 et le laboratoire CIAMS. Brice Isableu a tout de suite soutenu et enrichi mon projet initial donnant ainsi naissance au projet OptiSens (optimisation de l’interaction cavalier-cheval) sur lequel nous travaillons actuellement. Mais, aujourd’hui encore, je préfère attendre avant de m’engager dans la création d’une start-up.
– Avec le recul, ne regrettez-vous pas votre départ de Normandie, une région favorable avec sa filière équine ?
Je ferai une réponse de Normande : oui et non ! J’y garde des attaches. Au plan professionnel, je suis rattachée au Pôle de Compétitivité Hippolia : situé en Normandie, il me permet de rester connectée avec les innovations dans la filière équine. C’est d’ailleurs grâce à ce Pôle que j’ai pu être mise en relation avec HorseCom et bénéficier de stagiaires venant d’autres universités (du Master Chambery « Ergonomie des activités physique, ingénierie et conception de produits », par exemple).
Outre les motifs déjà évoqués de ma venue à l’Université Paris-Sud, j’ajoute que son UFR STAPS est le seul à disposer d’un centre équestre attenant au laboratoire de recherche. Et puis la Région d’Ile-de-France concentre bien plus de cavaliers et de professionnels que la Normandie. Je dis d’ailleurs souvent que mon projet a pris naissance dans le pays du cheval et se développe dans le pays des cavaliers. Pour les besoins de mes recherches, j’ai pu mobilier ceux de la Garde Républicaine ou encore du Haras de Jardy, à Marne la Coquette, le premier centre équestre en France, pour le nombre de licenciés mais aussi le centre équestre de Polytechnique pour certains tests techniques auprès du commandant Guichard.
– Comment avez-vous convaincu les cavaliers de la Garde Républicaine ?
J’ai sollicité le Colonel Puligny, qui a réagi très positivement. C’est un vrai luxe que de pouvoir travailler avec eux. De manière efficace, j’ai pu collecter un grand nombre de données précieuses. En parallèle, j’ai pu mobiliser des cavaliers amateurs et des non cavaliers pour mettre au jour l’efficience de la posture des cavaliers professionnels.
A peine trois mois après mon arrivée sur le campus d’Orsay, j’obtenais déjà des résultats plus qu’intéressants tant au plan de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée. Mais mon contrat universitaire n’ayant pas été renouvelé, je me suis retrouvée une première fois au chômage. J’ai donc prospecté, du côté de Maisons-Alfort notamment, qui compte une équipe de recherche sur la locomotion du cheval. Par chance, la demande de financement que j’avais soumise en parallèle pour les besoins d’un nouveau projet a été acceptée par l’IFCE. Forte de mon expérience de l’appel à projets, j’ai pu compléter ce financement.
– Et près de quatre ans après votre arrivée, quelle est votre situation ?
Elle reste celle d’une post-doc, avec toute la précarité que cela signifie : j’enchaîne les CDD et donc des périodes de chômage. On met à disposition un bureau et les équipements, charge à moi de trouver mes propres financements. Ce qui n’est pas sans ralentir le rythme de mes productions scientifiques et de me peser aussi parfois. Mais, comme pour une start-up, j’ai le sentiment d’avoir franchi un cap fatidique : je suis dans cette situation depuis près de quatre ans et l’envie de faire de la recherche est intacte. Et c’est bien ici que j’ai envie de poursuivre mes projets : l’écosystème correspond bien à ce que je recherchais, avec son encadrement de la recherche fondamentale et ses équipements. Si limite il y a, elle réside dans les moyens de financement. Hormis Brice Isableu, l’UFR STAPS n’a pas l’expérience des réponses aux appels à projets, en tout cas sur mes thématiques de recherche.
– Comment réagissez-vous au sentiment d’apparaître comme un être hybride, à la fois chercheur et entrepreneur ?
Je ne m’étais jamais décrite ainsi, mais je me retrouve bien dans cette notion. Le fait d’être hybride est à la fois très propice à la poursuite de recherches originales et en même temps difficile, parfois, à gérer. Le temps que je mets à chercher des financements, c’est autant de temps en moins que je consacre à la recherche. Aux yeux des autres, on n’est pas tout à fait chercheur ni tout à fait entrepreneur. Le système d’évaluation académique n’est pas conçu pour favoriser des démarches aussi hybrides.
– Dans quelle mesure l’écosystème Paris-Saclay vous paraît-il néanmoins favorable à la poursuite de vos projets de recherche ?
Le fait est, l’écosystème est favorable. Depuis que je suis arrivée ici, mes projets sont expertisés par le Service d’Activités Industrielles et Commerciales de l’Université de Paris-Saclay (SAIC) et ce, dans un sens de plus en plus favorable : il assure la négociation et la gestion des contrats et, surtout, la protection des résultats. En tant que jeune chercheur, on ne se rend pas compte du travail que cela représente. Lors des réunions de co-pilotage que j’organise autour de mon projet, le SAIC comme l’Université de Paris-Sud répondent présent pour ne serait-ce que m’aider à remplir les documents relatifs aux clauses de confidentialité ou à la propriété intellectuelle. Bref, les choses ont évolué favorablement, peut-être pas aussi vite que je l’aurais souhaité, mais cela va dans le bon sens.
Des associations ont par ailleurs vu le jour, qui accompagnent les jeunes chercheurs dans leur démarche de valorisation. De manière très naturelle, je me suis retrouvée à fréquenter un lieu comme le PROTO204, d’autant plus qu’il est situé à quelques pas de mon laboratoire. J’y rencontre des personnes qui ont à peu près le même profil que moi. A défaut de pouvoir m’y rendre, je m’informe de ce qui s’y passe.
– Qu’est-ce qui vous retient encore dans la création d’une start-up ?
Je pense être déjà dans une démarche entrepreneuriale, avec toute la prise de risque que cela suppose. Aujourd’hui encore, je m’autofinance. Qu’est-ce qui m’empêcherait donc à créer une start-up, me direz-vous. Je crois que j’ai encore trop une âme de chercheuse pour me consacrer à de la gestion et du management.
– Pourtant l’équitation ne vous prédispose-t-elle pas à affronter les affres de l’entrepreneuriat, qui métaphoriquement parlant, est aussi une course d’obstacles…
(Sourire). Je n’avais pas pensé à ce rapprochement, mais le fait est, il y aussi un peu de cela dans l’entrepreneuriat. J’ai en outre un vécu d’athlète, d’un niveau suffisant pour avoir cultivé un esprit de compétition. En outre, l’équitation vous incline à appréhender les risques, à vous adapter en permanence, ne serait-ce qu’avec l’animal. Comparée à d’autres disciplines, elle vous enseigne aussi l’humilité. Si performance il y a, elle réside dans le bon couplage entre deux êtres très différents (un homme ou une femme, et un cheval), en jouant sur les qualités de l’un et de l’autre. Autant de vertus qu’on retrouve chez l’entrepreneur innovant.
J’ajoute que, dans les faits, un cavalier professionnel est déjà en soi un entrepreneur. Là où un coureur de Formule 1 dispose d’un manager et de toute une équipe, lui doit souvent faire vivre sa petite entreprise, tout en coachant ses élèves et sa propre carrière sportive.
– Au plan familial, qu’est-ce qui vous a prédisposée à cette approche entrepreneuriale de la recherche ?
L’environnement familial m’y a certainement prédisposée. Mes parents ne sont pas à proprement parler entrepreneurs, mais agriculteurs. A ce titre, ils doivent en permanence avoir des perspectives de développement à long terme, tout en devant s’adapter à court terme, aux saisons, aux aléas météorologiques ou de bien d’autres natures… Il faut être persévérant pour réussir dans ce domaine. Je ne pense pas procéder autrement. Et puis la campagne cultive la créativité et/ou le sens de l’observation. Ce qui est essentiel quand vous êtes chercheur comme, d’ailleurs, enseignant en équitation, ne serait-ce que pour faire profiter à son élève du maximum de recommandations.
En sus de son activité d’agriculteur mon père est maire de sa commune depuis plusieurs mandats et son propre père a été sénateur. Ce qui suppose un sens du contact, du relationnel. Quelque chose qu’ils m’ont, semble-t-il, transmis et dont je mesure l’importance dans mes démarches entrepreneuriales. Sans doute que la fratrie entretenue avec plusieurs cousins joue-t-elle aussi. Deux d’entre eux sont ingénieurs dans la plasturgie : l’un travaille dans la R&D – je lui rends prochainement visite, à New York, où il vit ; un autre, son frère, vient de se lancer dans la création d’une start-up à Toulouse… Cela entretient forcément une saine émulation entre nous.
A propos de la photo illustrant cet article, en voici le commentaire d’Agnès : « La personne qui se trouve à gauche est Yann Bebelmann, l’entraîneur national de l’équipe de France Dressage ; à droite, c’est Lars Roepstorff, le Professeur vétérinaire sur la locomotion du cheval à l’université Uppsala (Suède) dont je vous ai parlé. Cette photo a été prise lors de mon dernier protocole sur le rôle de la musique et du rythme dans l’optimisation de l’interaction cavalier-cheval. Lars était venu de Suède me donner un coup de main. L’expérience se déroulait au Pôle Européen du Cheval au Mans en décembre 2015. »
A suivre : un entretien avec Krystel Vilain, une jeune cavalière, par ailleurs étudiante à Paris-Sud, qui témoigne de l’intérêt des recherches d’Agnès Olivier, auxquelles elle participe.
Journaliste
En savoir plus